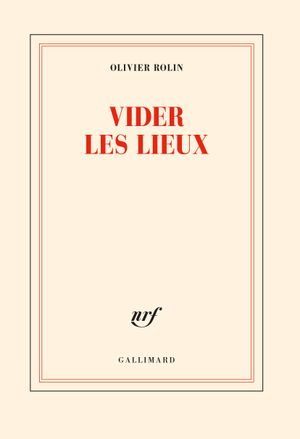En mars 2020, alors que chacun se repliait sur son chez-soi, Olivier Rolin était obligé de quitter son appartement de la rue de l’Odéon, vendu par les héritiers du précédent propriétaire. Il faisait alors une croix sur près de quarante ans passés dans ces murs, autant dire une vie.
Vider les lieux est le livre issu de cet événement terminal, cette « fin du monde au petit pied » comme le dit Michel Leiris, cité en exergue. Rolin y fait le récit oblique de ces quarante années de vie dans une rue profondément empreinte de littérature - Joyce ou Hemingway l’ont fréquentée longuement, à l’époque où y siégeaient Shakespeare & co et la librairie d’Adrienne Monnier, deux hauts lieux du Paris littéraire des années 20 - et de la vaste entreprise qu’est la mise en cartons d’une bibliothèque d’environ 6000 livres. Ce faisant, c’est une sorte d’autobiographie littéraire qu’esquisse Olivier Rolin, chaque livre suscitant souvenirs de lecture, d’amours ou de voyages. C’est le genre de livres que j’aime beaucoup en général : au portrait d’une rue, semblable à celui que fait Lydia Flem de la rue Férou dans Paris fantasme, succède un récit plutôt lâche, seulement guidé par le plaisir de faire renaître des plaisirs de lecture, de Tchekhov à Zamiatine, de Woolf à Proust. L’ensemble est nécessairement inégal, mais souvent plaisant.
Dommage que Rolin se complaise dans une posture prodigieusement agaçante de vieux con qui ne comprend rien au monde moderne et se plaint de l’évolution des sensibilités (pour résumer le propos : « on peut plus rien dire » et, en plus, plus personne ne lit les auteurs latins. O tempora, o mores, etc.), allant jusqu’à transfigurer dans un sursaut de présomption sa mise à la porte en une sorte de signe terminal du déclin de la littérature dans la société - puisqu’après Joyce et Sylvia Beach, lui aussi doit quitter la rue de l’Odéon.