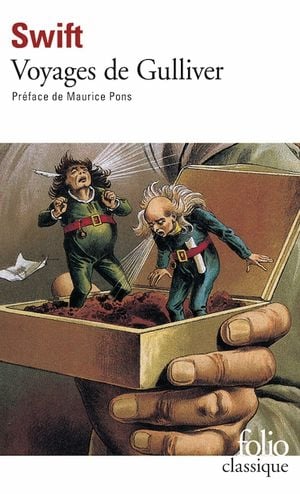Les Voyages de Gulliver est un roman multiple, dense. Le lecteur peut y retrouver une parodie des romans de voyages, réels ou imaginaires, à la mode en ce début de XVIIIème siècle (rappelons que Robinson Crusoë est paru juste deux ans avant le roman de Swift), une attaque contre les moeurs anglaises de son temps, ainsi qu’une critique politique féroce, qui se termine par un véritable traité de misanthropie. Sur le plan politique, le roman propose plusieurs régimes imaginaires qui permettent à Jonathan Swift, derrière la candeur de son personnage, de mettre en lumière les dysfonctionnements du système politique britannique. Ces royaumes imaginaires entrent aussi bien dans la catégorie de l’utopie que de la dystopie.
Selon un procédé littéraire déjà connu et qui sera employé par la suite de nombreuses fois, le voyage et la découverte de nouvelles cultures permettent de relativiser notre culture. Swift se permet ainsi d’inventer des peuples qui n’ont jamais entendu parler des Anglais. Les Lilliputiens refusent d’admettre qu’un pays de “géants” puisse exister. Après avoir été un géant à Lilliput, voilà que Gulliver est minuscule à Brobdingnag, passant ainsi de l’orgueil à l’humilité. Mais le plus grand coup porté à l’orgueil anglais se trouve sans doute dans la quatrième et dernière partie, dans laquelle Gulliver arrive au pays des Houyhnhnms, qui sont des chevaux intelligents vivant en société. Dans ce pays, ce sont les humains qui sont réduits à l’état bestial, ne sachant pas lire, écrire ou parler. L’humain, un animal comme les autres ? Et encore, semble répondre Swift : l’homme est un animal peu doué, sans grandes qualités…
Ce que Gulliver découvre surtout au fil de ses voyages, ce sont d’autres façons de gouverner. Cela permet à Swift à la fois de se moquer de la politique britannique, et en même temps de placer quelques unes de ses idées.
Son idée principale est exprimée aussi bien chez les Lilliputiens qu’à Brobdingnag : il n’existe aucune “science politique”, et être politiciens n’est pas un métier à part entière, qui nécessiterait un savoir (ou un savoir-faire) particulier. Au contraire, ce qui devrait être requis d’un dirigeant politique, c’est du bon sens, de la raison, et du sens moral.
Ainsi :
“Le gouvernement des hommes étant en effet une nécessité naturelle, ils [les Lilliputiens] supposent qu’une intelligence normale sera toujours à la hauteur de son rôle et que la Providence n’eut jamais le dessein de rendre la conduite des affaires publiques si mystérieuse et si difficile qu’on la dût réserver à quelques rares génies - tels qu’il n’en naît guère que deux ou trois par siècle. Ils pensent au contraire que la loyauté, la justice, la tempérance et autres vertus sont à la portée de tous, et que la pratique de ces vertus, aidée de quelque expérience et d’une intention honnête, peut donner à tout citoyen capacité pour servir son pays, sauf aux postes qui exigent des connaissances spéciales.” (partie 1, chapitre 6)
Derrière ce propos, il est facile de voir l’attaque dirigée contre la noblesse britannique (ou n’importe quel régime aristocratique, d’ailleurs) qui prétend qu’une éducation particulière est nécessaire pour savoir diriger les affaires publiques.
Le contre-exemple politique, la “dystopie” absolue selon Swift, se trouve à Laputa et Balnibarbi, dans la troisième partie du roman. Laputa est une île flottante, et cette situation est fortement symbolique : les habitants de Laputa sont, comme on le dirait de nos jours, “hors sol”, complètement coupés de la terre, c’est-à-dire de la réalité. Les habitants de Laputa, qui forment une classe sociale fermée, sont des grands théoriciens. Ils n’ont que mépris pour tout ce qui est pratique, pragmatique. Leur esprit est tout le temps tourné vers l’abstraction la plus élevée. Ils sont d’ailleurs tellement absorbés dans ces réflexions qu’ils ne parviennent même pas à suivre une conversation ordinaire. Cette distraction est d’ailleurs une des caractéristiques cocasses des Laputiens : n’étant jamais attentif à ce qui se trouve face à eux, ils parviennent toujours à perdre leur chemin, et ils sont tous cocus...
Pire : le résultat de leurs réflexions est toujours strictement du domaine de l’abstraction et ne peut connaître aucune application pratique. De fait, les habitants de Laputa sont incapables de coudre un vêtement ou de construire un bâtiment, puisque tout ce qui est pratique leur est étranger.
Ce sont toujours les théories fumeuses qui sont à l’origine des ennuis rencontrés par la population de Balnibarbi, la partie continentale de Laputa. C’était un pays plutôt bien géré et qui, auparavant, fonctionnait bien, lorsque les “experts” sont arrivés avec leurs théories, toutes issues de recherches en laboratoires. Ordre était donné d’appliquer ces théories dans la réalité. Ces idées révolutionnaires bouleversent le pays et, avec les experts, plus rien de fonctionne.Derrière l’humour débridé de ces chapitres, on peut ressentir une amertume chez Swift, et l’attaque porte toujours ses fruits…
L’utopie, quant à elle, se trouve en partie chez le roi juste et plein de raison de Brobdingnag, mais surtout chez les Houyhnhnms. Ces chevaux doués de raison ont construit un état basé sur la raison et l’éducation, dépourvu de grandes théories stériles, mais ne connaissant ni le mensonge, ni l’hypocrisie. Même en étant considéré comme un être inférieur, proche des Yahoos (les humains retournés à la bestialité), Gulliver se sentira tellement bien là-bas qu’il n’en voudra partir que sous la contrainte, et sans vouloir retourner dans une société humaine.
Entre les mises en lumière des dysfonctionnement de la politique britannique, et l’annonce des idées de Swift, Les Voyages de Gulliver se dressent en un formidable roman politique, utilisant souvent l’arme d’un humour qui cache mal les aigreurs de l’auteur.
Article à retrouver sur LeMagDuCiné