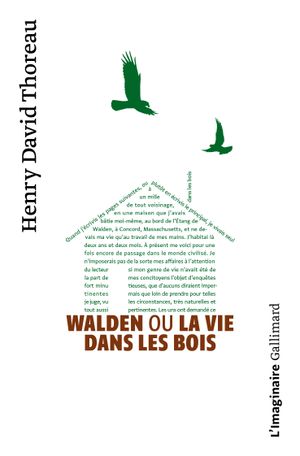On voit communément en Thoreau une sorte de précurseur, un visionnaire de la pensée écologiste. C’est en naturaliste qu’il justifie ses choix ― jusqu’à détailler les calculs de ses dépenses dans un premier chapitre « Économie » peut-être un peu long et ennuyeux ― en naturaliste aussi qu’il parle de Walden et ses environs, s’appuyant sur des connaissances scientifiques pour décrire ces lieux. Mais en l’occurrence sa vision naturaliste se double de celle d’un poète. Si son journal est prodigue en considérations philosophiques voire politiques, on sent que tout cet ouvrage tient sur une autre intention première, distincte de celle d’un doctrinaire : Ouvrir grand sa porte au lecteur pour lui laisser voir son univers, en une quinzaine de chapitres, comme autant de fenêtres, de tableaux successifs. Ses réflexions sont transmises au lecteur dans un souci de partager une manière de vivre, une manière de sentir.
Un lac est le trait le plus beau et le plus expressif du paysage. C’est l’œil de la terre, où le spectateur, en y plongeant le sien, sonde la profondeur de sa propre nature. Les arbres fluviatiles voisins de la rive sont les cils délicats qui le frangent, et les collines et rochers boisés qui l’entourent, le sourcil qui le surplombe. [...]
La Terre n’est pas un simple fragment d’histoire morte, strate sur strate comme les feuilles d’un livre destiné surtout à l’étude des géologues et des antiquaires, mais de la poésie vivante comme les feuilles d’un arbre, qui précèdent fleurs et fruits, ― non pas une terre fossile, mais une terre vivante ; comparée à la grande vie centrale de laquelle toute vie animale et végétale n’est que parasitaire.
Ses comparaisons, ses métaphores, forment de façon harmonieuse et très crédible une sorte d’acte de foi poétique. On constate souvent, en littérature, une participation de l’environnement aux motifs émotionnels ou psychologiques, où les personnages font en quelque sorte corps avec lui. Thoreau explique ce curieux phénomène à sa façon. Ses inspirations, pour imaginer toute une cosmogonie peuvent provenir de ses lectures ― il se présente dans « Lecture » comme intellectuellement nourri de littérature antique et de spiritualités orientales, notamment hindoues ― elles peuvent aussi provenir de sa manière d’observer la nature, d’arpenter les forêts et les bords de son étang ; en fait Thoreau joue continuellement sur le rapport étroit, voire de symbiose, entre le vivant et le monde : l’eau, le ciel, la terre. "Si chaque saison à son tour nous semble la meilleure, l’arrivée du printemps est comme la création du Cosmos sorti du Chaos, et la réalisation de l’Âge d’Or." Étant de plus en plus intrigué par l’expérience visuelle que constitue le Calendrier dans Les Très Riches Heures du Duc de Berry (clic et re-clic), je n’ai pu m’empêcher de voir plusieurs rapports entre cette autre succession de tableaux ― des portes ouvertes sur le monde médiéval ― et Walden ou la vie dans les bois. Les chapitres de Walden sont des entrées thématiques, des entrées menant, comme dans le Calendrier à l’image des différentes saisons, à la représentations des différents paysages.
Chaque hiver la surface liquide et tremblante de l’étang, si sensible au moins souffle, où il n’était lumière ni ombre qui ne se reflétât, se fait solide à la profondeur d’un pied ou d’un pied et demi, au point qu’elle supportera les plus lourds attelages ; et si, comme il se peut, la neige la recouvre d’une épaisseur égale, on ne la distinguera de nul champ à son niveau. Pareil aux marmottes des montagnes environnantes, il clôt les paupières et s’assoupit pour trois mois d’hiver au moins. Les pieds sur la pleine couverte de neige, comme dans un pâturage au milieu des montagnes, je me fais jour d’abord à travers la couche de neige, puis une couche de glace, et ouvre là en bas une fenêtre, où, en m’agenouillant pour boire, je plonge les yeux dans le tranquille salon des poissons, pénétré d’une lumière qu’on dirait tamisée par une fenêtre de verre dépoli, avec son brillant plancher sablé tout comme en été ; là règne une continue et impassible sérénité rappelant le ciel d’ambre du crépuscule, qui correspond au tempérament froid et égal des habitants. Le ciel est sous nos pieds tout autant que sur nos têtes.
C’est un autre point de vue sur la solitude qu’il exprime également pour nuancer quelques peu l’idée que l’on s’était faite sur sa retraite. Quitter la civilisation ― dont il critique par ailleurs l’industrialisation effrénée ―, certes, non pas quitter les hommes. « Je ne me suis jamais senti solitaire, dit-il, ou tout au moins oppressé par un sentiment de solitude […] pas plus solitaire que le plongeon de l’étang, ou que l’Étang lui-même. » et de railler gentiment village et journaux en les comparant aux bruissement des feuilles, aux pépiement des grenouilles. Construire sa maison, travailler la terre, vivre dans une indépendance presque absolue, étaient déjà des objectifs en soi.
Lecture du 27 août au 1er septembre 2019. Traduit de l'anglais par L. Fabulet. 377 pages ― L'Imaginaire (Gallimard)