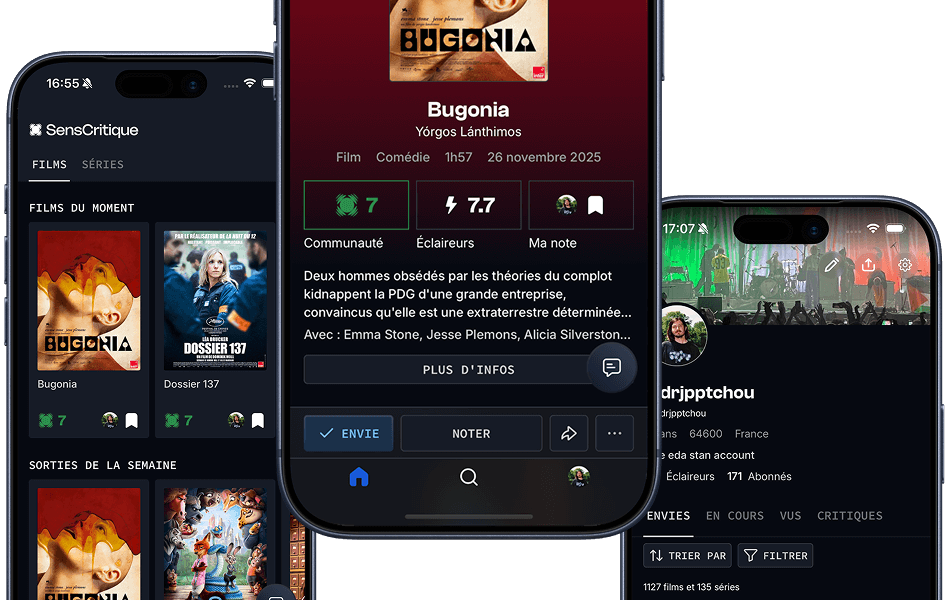1er juin 1940.
Le week-end s'annonce radieux. Il fait chaud et le soleil scintille sur les eaux froides des Flandres. Mais l'armée française est en pleine débâcle, enfermée dans la poche de Dunkerque avec les quelques 300 000 soldats du British Expeditionary Corps qui, après une campagne désastreuse caractérisée par un manque flagrant de coopération avec les autres puissances alliées, préféra quitter le navire (ou l'inverse) et retourner en Angleterre sans prévenir personne, jetant aux oubliettes les projets de contre-attaque de l'État-major français et précipitant la reddition de la Belgique qui, de toutes façons, abandonnée par les Anglais, ne tenait plus que quelques kilomètres de son territoire autour de Courtrai, où les Chasseurs ardennais tiennent héroïquement en échec les Allemands à Vinkt avec leurs trois petits chars T-13 et T-15.
Alors Français et Anglais se retrouvèrent pêle-mêle à camper sur la plage, entre Dunkerque et Bray-Dunes, en attendant leur providentiel départ vers l'Angleterre. Des tonnes de matériel sont abandonnées sur la plage et dans les environs. Camions, chars, canons en tous genres, bidons d'essence, caisses de munitions, ambulances, mitrailleuses et fusils antichars — les fameux Boys anglais — gisent dans la plus grande confusion sur le sable et dans les champs. Les dunes de Dunkerque sont encore aujourd'hui remplies de bouts de ceinture et d'éclats d'obus. La première victime des guerres modernes, c'est bien souvent la nature... Il faut dire que l'artillerie et l'aviation allemande avaient pilonné sans cesse les malheureux soldats, tant bien que mal protégés par la DCA et la RAF.
Or, l'envers du décor, c'est le sacrifice de l'armée française qui, mise devant le fait accompli, se donna quand même pour mission de protéger à tout prix la retraite de leur « allié », avec un sens exemplaire du devoir. Le livre de Robert Merle en parle-t-il ? Pas du tout. Le film de Verneuil ajoute au moins une réplique : « Là-bas, sur le canal, les gars tiennent toujours ! Ils se battent comme des lions ! »
À quelques kilomètres de là, en effet, les Français se battent férocement. Malgré le repli des soldats Anglais, la ville fortifiée de Bergues ne capitule pas. Les Allemands sont bien parvenus à franchir le canal de la Basse Colme pendant la nuit. Mais le lendemain, le 2 juin, le reste de chars Somua et Hotchkiss que parviennent encore à aligner les Français lancent une contre-attaque acharnée sur la plaine inondée — les canaux ont été démolis — entre Teteghem et Bergues. Dépourvus d'armes antiaériennes, ils n'ont aucune chance contre les Stuka, tandis que l'infanterie est livrée sans répit au feu des mitrailleuses sur le terrain parfaitement plat et dépourvu de végétation. Les pertes sont colossales mais les Allemands n'ont pas avancé d'un pouce. Peut-on encore comprendre, de nos jours, l'acharnement héroïque de ces Français du quotidien qui luttent sans espoir à un contre dix ?
Pas toujours et ce genre de livre nous explique pourquoi.
Week-end à Zuydcoote, c'est le récit d'un pauvre hère qui se pose des questions. Julien Maillat (Belmondo dans le film) est sergent-chef. Mais ça, il en a rien à cirer. C'est plutôt un fonctionnaire, ou quelque chose comme ça, menant une vie douillette avec un confortable salaire dans une petite maison avec son petit jardin dans la banlieue du Havre ou de Dieppe. Mais voilà, il se pose beaucoup de questions. Pourquoi l'amour ? Pourquoi les femmes ? Pourquoi la guerre ? Pourquoi la vie ? Pourquoi la mort ? Pourquoi la souffrance ? Pourquoi pourquoi ?
Je lisais à l'instant le témoignage d'un vétéran de Dunkerque qui faisait remarquer que, contrairement aux personnages de Week-end à Zuydcoote, les soldats de 1940 avaient d'autres chats à fouetter que de discuter de questions existentielles en regardant l'horizon.
C'est ce que pense l'abbé Pierson (Marielle). D'après Maillat, c'est un « fayot », parce qu'il en connaît un peu sur la guerre et sur l'art militaire. La guerre, lui, il la prend au sérieux. Ce que Maillat est incapable de comprendre : la guerre lui est simplement absurde, comme un peu tout au final. Pour Pierson, Maillat se pose trop de questions. Dieu nous a mis ici à ce moment-là, voilà tout, c'est comme ça. Il ne reste qu'à agir du mieux qu'on peut et à endurer vaillamment ces instants tragiques. C'est ce qu'enseignait déjà le père des poètes et l'éducateur de notre civilisation, Homère, qui incitait les héros antiques à poursuivre le bien et le bon malgré les détours cruels du destin retors.
Ce qui oppose les deux hommes, c'est Dieu. Enfin, en apparence. Maillat est incapable d'y croire. Pierson a la foi. Maillat a besoin de certitudes éprouvées pour croire. Pierson a simplement la foi et c'est tout.
Tout se joue véritablement sur la question de la certitude. Maillat veut des certitudes : il veut être certain que la guerre ait un sens, il veut être certain que combattre les Allemands ait un sens, il veut être certain que souffrir ou que mourir aient un sens. Pierson, lui, n'en demande pas tant. Il est certain de l'incertitude qui est caractéristique de l'existence humaine, ce qui fait de la certitude une question sans objet. Alors il faut se raccrocher à des choses plus simples et plus immédiates. Dans l'immédiat, les Allemands envahissent la France et c'est le sort de millions de personnes qui est en jeu ; des millions de personnes qui pourraient bien perdre du jour au lendemain leur liberté.
L'enjeu est pourtant simple. À condition qu'il ne soit pas encombré de questions qui, de toutes façons, ne peuvent pas avoir de réponse. Le désir de certitude de Maillat le mine. Il ne comprend pas pourquoi les hommes peuvent être aussi banalement mauvais, et pourtant obstinés dans le courage et l'héroïsme, quitte à arroser en vain les Stuka avec son précieux FM calé dans les bras. Il ne comprend pas pourquoi l'on souffre, pourquoi les guerres éclatent entre les peuples, pourquoi, d'ailleurs, il faudrait se battre pour un peuple. Disons-le clairement : l'horizon de Maillat ne dépasse pas son nombril. Et quand il a de la considération pour autrui, c'est encore pour voir en eux les souffrances qu'il craint pour lui-même, dans une sorte d'humanisme pathétique qui confine à l'absurde lorsqu'il s'interroge sur la légitimité à tuer un violeur pourtant pris sur le fait. C'est que, si le monde ne peut qu'être compris que dans la certitude d'une vérité « en tant que la sécurité de l'existence dans son évaluable machinabilité », alors la représentation du monde ne peut que sombrer dans des absolus parfaits qui sont la négation du monde dans son intrinsèque complexité. Le mal ne peut plus être compris comme étant nécessaire au bien. Donc la souffrance ne peut plus être comprise comme un mal nécessaire au bien. Or, la souffrance, plus encore que la mort, terrorise Maillat.
Je ne sais si c'était réellement l'intention de Robert Merle mais, en opposant ces deux personnages, il parvient à mettre le doigt sur l'écueil fondamental de la philosophie moderne.
Or, en 1940, les Allemands, les Italiens et les Japonais étaient tous convaincus que la faiblesse des démocraties reposait précisément sur cette peur-panique de la souffrance. En conséquence, ils pensaient que les hommes « supérieurs » forgés par le fascisme parviendraient à imposer une défaite qui ébranleraient les douillets amoindris par l'idéologie bourgeoise à ce point qu'ils perdraient le peu de volonté de combattre qu'ils avaient et accepteraient volontiers le joug de l'impérialisme. Les sous-hommes doivent être dominés par les sur-hommes.
Fort heureusement, ils se sont trompés sur toute la ligne. Ou presque.
Car si le pacifisme, en répandant des images d'effroi de la guerre et de terreur face à la souffrance, avait bel et bien joué un grand rôle dans l'inaction du Royaume-Uni, de la France et des États-Unis vis-à-vis de l'Allemagne nazie, conduisant à la défaite de la France (on préférait se convaincre que Hitler était pacifiste plutôt que d'envisager les heures tragiques de la guerre), les agressions belliqueuses des régimes fascistes ont soulevé un immense réveil patriotique. En France comme en Angleterre, les hommes ont partout fait face avec héroïsme, même dans les situations les plus désespérées. C'est encore ce patriotisme qui a sauvé in extremis l'URSS, les farouches paysans slaves préférant encore défendre leurs oppresseurs, aussi monstrueux soient-ils, plutôt que de subir leur propre extermination qu'avaient planifiée les nazis.
Pour ces hommes — et aussi ces femmes, dans les mouvements de résistance —, leur liberté, aussi médiocre et limitée soit-elle, valait bien les plus grands sacrifices, même s'il fallait mettre sa propre vie en jeu.
Or, un tel calcul devient impossible lorsqu'on attache une importance démesurée à la souffrance et à la mort. Maillat refuse de souffrir et de mourir. Pourtant, sa vie n'a aucun sens. Il erre en amours vaines, multiplie les relations qui ne mènent à rien, il s'ennuie au travail et dans la vie en général. Rien ne le satisfait, rien ne le divertit, rien ne l'occupe. Mais il préfère encore conserver cet ersatz de vie plutôt que d'abandonner l'idéal d'absolue perfection qu'il poursuit en vain.
Il se pourrait bien qu'un jour les hommes soient à ce point obnubilés par le rêve d'un bien absolu qu'ils préfèrent encore renoncer à leur liberté et à celle de leurs enfants que consentir à souffrir et à mourir — c'est-à-dire, consentir à renoncer à cet absolu du bien. Il suffirait alors pour leurs dirigeants d'agiter une petite frayeur — un virus de rien du tout, quelques terroristes, un ou deux « fascistes », ou quelque chose comme ça — pour obtenir le consentement aux pires oppressions et le renoncement à toutes les libertés, au peu de liberté que la nature cruelle nous autorise d'avoir.
Je ne sais si c'était peu ou prou l'idée du livre de Robert Merle. Mais bien qu'il parvienne à faire ressortir une réflexion dans ce goût-là, et bien qu'il soit très bien écrit, Week-end à Zuydcoote a quelque chose de démoralisant et de déprimant, comme toute cette littérature défaitiste typiquement française d'intellectuels dépressifs et idéalistes.