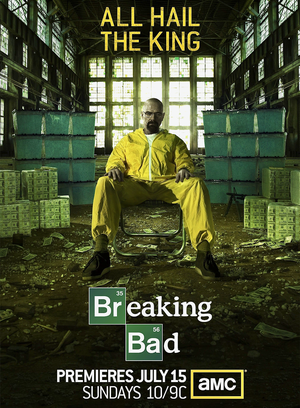Tout. Tout a été dit sur cette série instantanément culte, propulsée au panthéon de l’excellence avant même son aboutissement. J’aimerais pourtant revenir sur un point qu’il me semble à éclaircir. Un élément que j’ai longtemps considéré comme un manque, une zone d’ombre de cette série, alors qu’il n’en rend le propos que plus pertinent.
Celui donc des désirs et de l’intimité des personnages, traités ici d’une bien curieuse manière. Jusque-là, je pensais qu’une bonne série dramatique se devait de rentrer longuement dans l’intimité de ses personnages, sonder leurs profonds désirs et évoquer leur assouvissement de manière plus ou moins frontale pour que le spectateur fasse corps avec ceux qu’il accompagne durant tout ce temps. Dans « Breaking Bad », les scènes intimistes se font bien rares, et clairement déroutantes. Lorsque Jesse déprime, il remplit sa maison de junkies gesticulant sur du bruit à fond les ballons. Pas très baudelairiennes, la dépression. Quant à Walter, l’attirance qu’il ne cesse jamais d’avoir pour sa femme n’est assouvie que très rarement à l’écran, puis plus du tout par la suite.
Tout cela entraîne une frustration chez le spectateur, qui a l’impression qu’on passe sous silence les moments les plus intenses émotionnellement que traversent les personnages. Mais cette frustration n’est que le reflet de celle de Jesse et Walter : en sombrant dans le crime, ils ne perdent pas seulement leur intégrité, mais aussi leur intimité. Dès lors, plus aucune jouissance, aucun bonheur partagé n’est possible et tout espoir du contraire n’est que chimère condamnée à s’évaporer rapidement. Comme si l’homme, à prendre des risques démesurés pour améliorer sa condition, en devait alors oublier l’essentiel pour se contenter d’une survie se ressentant finalement comme une régression. Il y a toujours le plaisir de la transgression, et celui de bâtir sa propre légende « Say my name ! ». Mais cela est finalement bien futile.
En tout cas, rien de moraliste là-dedans. Seulement le mécanisme implacable d’une perte de repères, d’espoirs et de valeurs non pas provoquée à l’origine par la plongée dans le trafic de drogue, mais bien par le cancer de Walter. C’est ce qui fait de « Breaking Bad » un récit si pessimiste et d’une noirceur contrebalancée par une lumière omniprésente et des couleurs chaudes. Rares sont les moments où le cadre s’attarde sur l’ombre, Walter et Jesse sont montrés au grand jour, et leur vie ne se résume qu’à repousser l’échéance. En cela, la série se rapproche fortement du film « Fargo », avec moins de cynisme et plus de tragique dans la recette. Ces étendues désertiques du Nouveau-Mexique ne sont d'ailleurs pas sans rappeler les plaines enneigées du thriller des frères Coen.
Le summum de cette épopée castratrice réside dans la séquence où Walter, brièvement, assouvit ses pulsions sexuelles et violentes sur sa femme, à peine voir pas du tout consentante. Tel Robert de Niro aka « Noodles » se jetant à corps perdu sur la robe de Deborah en larmes à l’arrière de cette voiture de « Il était une fois en Amérique », Walter prend conscience ce jour-là que ce fut la dernière fois, et peut-être la pire, qu’il assouvissait ses désirs les plus primaires. Maintenant plus rien ne sera comme avant, et le voici réduit à la condition de bête sauvage, traquée et traqueuse. Capable des pires abominations, des pires manipulations pour arriver à ses fins, c'est-à-dire survivre dans cette jungle constellée de « blue meth », de cadavres et de vies déchirées à jamais. Et tout cela malgré lui, car sa bonhomie de prof' de chimie ne s'est jamais éteinte, enfouie tout au fond de lui. La vision d’une société qui, à force de refuser l’évidence, de se détourner de la mort, en oublie que seule la simplicité peut conduire à un bonheur durable.