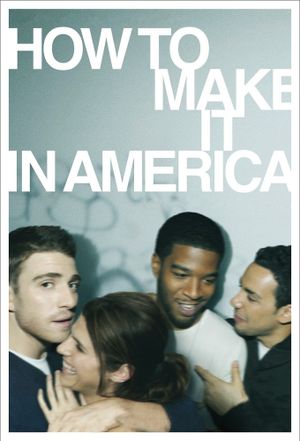Existe-t-il une série plus in, une série plus tendance et une série plus cool que How to make it in America ? Rien qu’en regardant cette série, t’as l’air cool même en étant un gros loser. Ici c’est simple, c’est plus cool, tu meurs (d’une overdose de cool, sans doute). Tout le monde est cool (même le générique est cool), tout le monde s’habille cool, traîne dans des endroits cool, le soundtrack est cool (un vrai truc de malade : que du pointu, que du lourd, que du bon) et les soirées sont cool. C’est le New York bigarré/négligé/chic du nouveau millénaire qui semble vouloir faire revivre, de façon plus standard, l’effervescence sociale et artistique des années underground de la Factory avec Warhol, Blondie, Basquiat, Haring et Cie.
Tout le monde s’appelle bro’, man ou dude, les gens sont créateurs de mode, décorateurs, dealers, traders, designers, photographes, promeneurs de chiens, publicitaires, rédacteurs, mannequins, bref le top du top du trendy au cœur de Big Apple. Réplique d’Entourage estampillé "côte Est" (Mark Wahlberg a produit les deux séries), How to make it in America célèbre New York comme Entourage célébrait L.A. : les amis, les filles, la beuh, les parties (vernissages, boîtes, anniversaires, etc.), du bon son et la ville en long, en large et en travers. Du Bronx au Village en passant par la 5e et l’Upper East Side, How to make it in America est une déclaration d’amour à New York (à l’instar de Sex and the city, la doyenne) parvenant à saisir les multiples identités (ethniques, géographiques et esthétiques) de la plus célèbre des plus célèbres métropoles mondiales.
Au milieu de tout ça, Ben et Cam évoluent comme des poissons dans l’eau, semblent connaître tout le monde (du videur du dernier club où il faut être vu au vendeur de sandwichs sur Broadway Avenue), batifolent, se bidonnent et se lancent à la poursuite de l’éternel rêve américain (et de l’éternel amour aussi, Ben ne pouvant oublier son ex Rachel avec qui rien ne paraît terminé). Bien décidés à créer leur propre ligne de jeans inspirée des 70’s ("Crisp, mother fuckers"), puis finalement de T-Shirts et de sweats sérigraphiés, les deux compères (un grand feuj réfléchi et un latino riquiqui roi de la tchatche : "Ben is sweet, I’m scandalous") tentent de s’imposer au sein d’un microcosme où tout va vite et tout s’affole, où les modes se font et se défont en à peine un after dans une discothèque branchée.
Entre coups de chance et coups du sort, coups d’un soir et coups fourrés, combines et galères, cousin gangster, skater fou et ancien pote de classe devenu magouilleur à Wall Street, Ben et Cam tentent de trouver leur place dans ce monde sans pitié qu’est celui de la fripe (les nouveaux Melinda Gloss, Adam Kimmel ou Raf Simons, ce sont eux ?), du capitalisme sauvage et des quinze minutes de gloire promises à chacun. C’est profiter de la vie, cartonner dans son travail, croire en l’amour et dans ses idéaux, être d’abord qui on veut tout en espérant y parvenir (du moins en se donnant les moyens d’y parvenir : pas évident le truc).
Joli message utopique (libéral ?) en ces temps de crise financière mondiale où lever son propre biz’ a tout de la bérézina commerciale ; j’imagine les Grecs ou les Espagnols, fuyant leur pays, qui tombent sur cette série entre deux manifs d’indignés dans la rue, où même sur Hung qui, elle, prônait la prostitution comme éventuel remède à la faillite économique… Victor Rasuk et Bryan Greenberg, le très boy next door qui se tapait Uma Thurman dans Petites confidences (à ma psy), insufflent énergie et belle complicité à leur duo de gentils garçons guidés par la hype. Enlevée, futile (donc indispensable), du style et de la banane, How to make it in America, en seulement deux petites saisons (8 épisodes de 25 minutes chacun ; dommage pour la suite), prouve une fois encore l’indécente suprématie créative d’HBO (depuis Oz) en montrant/démontant les mille et une débrouilles d’un possible rêve balancé jusqu’aux portes du succès.