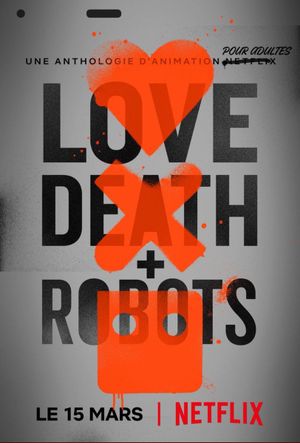Une bande annonce explosive et pulsionnelle, Tim Miller comme créateur, David Fincher comme producteur, la nouvelle série anthologique de Netflix, Love Death + Robots, contenait tous les ingrédients pour égratigner les rétines et servir un spectacle adulte et jouissif au possible. Verdict final: la série arrive à relever le pari, mais non sans défauts.
Love Death and Robots est à l’image de son trailer original : une série qui va vite et qui ne se pose pas trop de questions. Avec ses 18 épisodes, qui durent de 7 à 17 minutes, on assiste sous nos yeux, parfois ébahis, à une mosaïque pharaonique d’animation allant de la 2D à la cinématique, du photo réalisme au cartoon, du cel shading aux CGI impressionnants jusqu’à la de prise de vue réelle. Comme son nom l’indique, Love Death + Robots utilisera l’animation et ses multiples composites, pour matérialiser à de nombreuses reprises ses thématiques principales à savoir celles de la violence, du sexe et de la SF. Violence gore, sanguinolente et qui ne se donne aucune limite dans sa représentation : tête coupée, démembrement, arme à feu, monstre, explosion etc… Violence qui rappelle celle du réalisateur de Deadpool, Tim Miller. Dès le premier épisode, «L’avantage de Sonnie », le ton est donné et la marque de fabrique de la nouvelle série Netflix semble toute trouvée.
Dans un monde futuriste, des hommes et des femmes prennent possession de corps de monstres vociférants pour se battre dans des arènes souterraines. Avec son personnage principal féminin aux traits ressemblants à ceux de Lisbeth Salander et son environnement à la Pacific Rim, ce premier épisode est une première claque d’animation, qui à l’image de la série, va droit au but et s’avère être un divertissement efficace, futuriste et assez trash. Love Death + Robots est une série qui base son matériau sur sa rapidité d’exécution, une direction artistique bluffante, son mélange des genres (anticipation, monstre, fantastique, SF) et sa capacité à changer de visage à chaque épisode : ce qui donne parfois un exercice de style qui ne se donne pas souvent le temps de contextualiser son cadre, ni même de donner corps aux véritables motivations de ses personnages, et qui tombe parfois dans la piège de la superficialité. La série fonctionne comme une peinture grinçante qui donnerait vie, à un instant donné, à un futur loin d’être idyllique, lieu propice à ce que l’animation fasse sortir les armes et fasse gicler le sang, à l’instar d’un Beat them all dans la sphère du jeu vidéo : comme l’atteste l’épisode « angle mort » avec ses faux airs de Mad Max fait de cyborgs ou même avec « une guerre secrète » où des soldats sibériens se battent contre une armée de monstres. C’est le genre d’épisodes récréatifs où il n’y a pas de temps mort, chose qui donne naissance à un divertissement assez juvénile et carnassier.
D’un épisode à un autre, on passe d’un monde post apo à l’univers claustrophobe d’un vaisseau ou même d’une forêt enneigée de Sibérie. Mais de cette violence, de cette nudité parfois frontale, nait aussi une certaine vision de la SF : sombre, moribonde où l’homme devient une proie et une entité bien faible face à ce qui l’attend, comme nous le prouvent deux épisodes marginaux du reste de la série, extrêmement drôles, et presque enfantins : « la revanche du yaourt » et « les trois robots ». Deux épisodes, qui de manière très succincte et humoristique, montre d’une part l’absurdité de la faiblesse biologique et écologique de l’homme et d’autre part, son autodestruction maladive et son incapacité à se diriger avec pérennité et réflexion. Même si certains épisodes poussent à la réflexion, que ça soit sur l’imaginaire lovecraftien orchestré par la technologie (« derrière la faille »), la mutation vorace des armées (« Métamorphes »), notre manière de concevoir l’art et son commerce artificiel (« l’oeuvre de zima ») ou les violences faites aux femmes (« le témoin », « l’avantage de Sonnie » et « bonne chasse »), Love Death + Robots n’est pas une série comme peut l’être Black Mirror qui laisse entrevoir le questionnement habituel sur notre quotidien, nos addictions et notre lien à la technologie. Plus régressive et instinctive, plus proche de l’aspect ludique et nerveux de l’univers du jeux vidéos que de la thèse philosophique, sexualisant parfois l’humain à outrance (notamment la femme et ses courbes), la série est une suite d’épisodes autant débordante d’imagination que parfois engoncée dans ses propres références (celle de Gravity dans « le coup de main »).
La diversité des visuels et des cultures, la pluralité des tonalités où l’on passe du rire à l’action pure, cette volonté de se renouveler à chaque épisode et de créer une déferlante de lieux plus grandiloquents les uns que les autres font aussi le charme d’une série, qui certes, ne va pas révolutionner la SF et son évolution. Elle pourra au pire, amuser certains devant cet alliage parfois très réussi de gore, d’horreur, d’humour (« un vieux démon »), faire saisir l’essence même du rêve et de la liberté (« les esprits de la nuit »), et au mieux subjuguer par son aspect iconique, son inventivité visuelle et sa maitrise incroyable du médium de l’animation : « le témoin » réalisé par Alberto Mielgo et « bonne chasse » d’Oliver Thomas en sont les deux meilleurs symboles. Deux épisodes, très distincts, magistraux, mais qui mériteraient presque de devenir des longs métrages. « Le témoin » est une course poursuite où l’on suit une femme qui essaye d’échapper à un homme. Dans des ruelles dignes de Ghost in the shell entrecoupées par des confusions de personnalités à la Perfect Blue, cet épisode impressionne par son visuel, sa nudité organisme, sa tension et son découpage. Pour « bonne chasse », on croirait voir un film d’animation Disney qui se verrait taché de sang par l’ambition et la violence de l’homme: la place de la femme, la mécanisation de notre quotidien moderne, les cultures ancestrales et le nouveau visage de nos désirs charnels sont des thématiques qui font de « Bonne chasse » un bijou d’animation.
A travers ce magma de courts métrages intenses et efficaces, cette action gore et cet amour pour les codes du fantastique, Love Death + Robots fait rapidement penser à ces quelques courts métrages réalisés par Neil Blomkamp pour Oats Studios (« Rakka »): la même envie de s’amuser et de dépoussiérer le spectre de la SF avec passion.
Article original sur LeMagducine