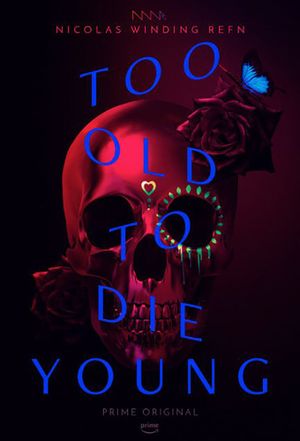Adepte des films courts, Nicolas Winding Refn semble sortir de sa zone de confort en passant au très long format, mais les premières minutes laissent en fait plutôt penser qu’il s’agit pour lui d’une opportunité de radicaliser son système. Le film doit durer dix fois plus longtemps ? Alors les plans aussi. L’introduction est frappante de ce point de vue-là : deux policiers figés comme des statues de cire, le regard perdu dans la nuit, tandis que seule la caméra, par un lent panoramique, fait preuve de mouvement. Nonobstant les bruits de la rue au loin, on pourrait croire à une nature morte. Même la musique de Cliff Martinez, qui tient souvent lieu de distraction quand les plans s’étirent et les silences se prolongent, est désormais quasiment absente. De toute évidence, Refn a décidé d’abandonner tout ses appâts, ne cherchant plus à séduire son public mais plutôt à le mettre mal à l’aise. Les dialogues sont alors secs et brutaux, chaque échange ressemblant à une tentative d’instaurer un rapport de force, procédé qui ne détonne en rien dans un univers aussi urbain, où la violence est aussi crue. On pense à Wrong Cops de Quentin Dupieux devant ces flics corrompus à l’esprit malade, mais un Wrong Cops débarrassé de tout humour, ne laissant plus qu’un malaise intense. On n’est ni dans le Los Angeles du Français, dystopique et déviant, mais d’une déviance salvatrice puisque l’idiotie des forces de l’ordre ne faisait que souligner leur humanité, ni dans celui que Refn avait dépeint dans Drive, une ville de conte de fées, ni même dans celui de The Neon Demon, ce labyrinthe occulte peuplé de sorcières et de cannibales ; le L.A. qui nous est présenté au début de Too Old to Die Young semble tristement réel, un monde de gangs, où la violence omniprésente peut faire des victimes collatérales parmi n’importe quel passant. Pas si loin de Bangkok telle qu’on le voyait dans Only God Forgives, donc.
Puis on passe la frontière mexicaine. Changement d’atmosphère, changement de langue, changement de personnages, mais une radicalité qui ne s’amoindrit pas, loin de là. L’intrigue paraît typique d’un film d’action, une prise de pouvoir au sein d’un cartel, mais celle-ci se fait sans éclat, ni avec les poings ni avec les armes, mais au rythme de la lente agonie de son patriarche. Les plans s’étirent donc plus que jamais, traçant un parallèle entre l’état de déliquescence de Don Ricardo et celui de son organisation, tandis que les dialogues révèlent quels seront les thèmes centraux de l’œuvre : la soif de conquête de la jeunesse contre le consensus mou des aînés, la figure maternelle comme source de toutes les obsessions du fils. Sexe et violence. Et au milieu de tout ça, une lueur de mystère : Yaritza, mutique silhouette féminine aux allures de sainte qui semble toiser de haut ce nid de vipères, jamais impressionnée par le concours de virilité que son entourage lui impose. Il suffit de peu de scènes pour la rattacher à ces autres personnages mystiques qui émaillent la récente filmographie de Refn : le Borgne du Guerrier silencieux, Chang dans Only God Forgives, Jesse dans The Neon Demon, et dans une moindre mesure le conducteur de Drive. Et quand bien même elle aurait moins de temps de présence à l’écran que Martin, on se doute rapidement que, à l’instar de Chang pour Only God Forgives, il y a des chances qu’on la retienne comme le véritable personnage principal de Too Old to Die Young. Après l’Ange de la Vengeance, la Haute Prêtresse de la Mort. Déjà la perspective d’explorer une réalité crue semble s’estomper : il y aura bien des sorcières dans ce Los Angeles.
Et la suite montre bien que le dénuement de la double introduction n’était que faux-semblants. Enfin la musique occupe une place prépondérante, tandis que Martin, ce policier aux silences insaisissables, intègre une organisation criminelle, l’intrigue se parant ainsi d’attributs plus romanesques. Les différents gangs qu’on croise dans les bas-fonds de la Cité des Anges ont désormais un caractère exotique rappelant par exemple l’orientalisme de la fin de Drive, et c’est bien de Drive que la partie suivante se rapproche, les épisodes 3 à 5 constituant presque un long-métrage qui se suffirait à lui-même, sorte de thriller néo-noir facilement séduisant – pas étonnant donc que les épisodes 4 et 5 aient été diffusés à Cannes, le 3 se présentant surtout comme une introduction pas forcément nécessaire à la compréhension.
Et enfin jusqu’à la fin les ambiances varient, jusqu’à faire de Too Old to Die Young une sorte de somme et d’achèvement des trois ou quatre derniers films de Refn, dont les thématiques comme les motifs stylistiques se voient tour à tour repris : on alterne entre un lyrisme emphatique (Only God Forgives, Le Guerrier Silencieux) et une sorte de romantisme moderne parfois teinté d’ironie (Drive), en passant par une érotisation des corps via des formes publicitaires (The Neon Demon) ; on sombre dans des histoires criminelles (Drive, Only God Forgives), on explore les bas-fonds secrets d’un Los Angeles fantasmé (The Neon Demon), les épaules des personnages ploient sous le poids d’une vengeance se parant d’accents œdipiens (Only God Forgives), on s’interroge sur la vacuité et l’individualisme dans lesquels l’Amérique s’engouffre (The Neon Demon)… Et surtout l’esprit de sérieux se dissipe peu à peu, laissant même la place à l’œuvre la plus drôle de Refn, exorcisant l’introduction du premier épisode, ce Wrong Cops dénué d’humour.
L’humour n’est certes pas tout le temps présent, mais lorsqu’il explose il n’est jamais gratuit. En effet, là est la grande nouveauté dans le cinéma de Refn : pour la première fois s’invite la politique, et le réalisateur n’y va pas par quatre chemins pour partager sa vision des États-Unis, en adoptant un registre foncièrement caricatural. En partie conçu en réaction à l’élection de Trump, Too Old to Die Young dépeint une Amérique perverse et décadente, peuplée de violeurs et de pédophiles. Les représentants de l’autorité y sont des idiots finis glorifiant le fascisme et éructant des « Fake news! » et « Democracy is my bitch », les avatars de Trump se multiplient à la radio et dans la rue pour répandre leurs idées complotistes, les classes supérieures sont infectées par la vulgarité et par une arrogance nouveau riche, retirant toute leur confiance en l’éducation pour l’injecter dans l’argent et dans les fausses valeurs artistiques… La plupart des figures de pouvoir sont chargées de défauts, mais ce qui pourrait passer pour un manque de subtilité constitue au contraire une des qualités les plus impressionnantes de cette œuvre, c’est-à-dire le refus de toute concession pouvant entraver la vision de Refn, qui clame haut et fort sa haine de l’Amérique de Trump, cloaque répugnant et condamné qu’il finit même par assassiner littéralement, en compagnie de tous ses symboles – la scène clé dont il parlait au cours de la conférence de presse cannoise ?
Car c’est bien l’Amérique qui est « trop vieille pour mourir jeune » : prospère, elle s’est laissée vivre, s’est empâtée, s’est décatie, et a perdu tout ce qui faisait sa vigueur et son lustre. Quand un groupe de musique ânonne les figures passées de son âge d’or (Elvis, Marylin, James Dean…), certains Mexicains applaudissent, d’autres restent indifférents, mais enthousiastes ou non tous voient dans cette énumération une simple curiosité folklorique, que les paroles de la chanson dans sa version intégrale ne démentent même pas : « The 50’s are the best, forget the rest ». Les États-Unis vivent encore, mais ils sont comme morts, n’ayant plus que le passé pour maintenir une illusion de faste. Make America Great Again, mais en régressant dans le temps, non en allant de l’avant, ce qui n’a aucun sens pour la jeunesse mexicaine. Ne restent plus que des corps répugnants, uniquement bons à cracher, renifler, éructer : des Néandertaliens sans grâce, des organismes presque frigides obligés de s’aider de la technologie pour jouir, des mourants dont les parents vivent encore, eux-mêmes mourants, et qui ne mourront sans doute pas avant longtemps.
Et à l’opposé de cette vile société qui n’a plus rien à se raccrocher que « a Bible and a gun », Refn fait du Mexique une terre de fantasmes, ceux de l’Amérique bigote qui ne voit en ses voisins qu’une source de dégénérescence. Trump a peur des Mexicains ? Alors ceux du film seront bel et bien menaçants, réclamant toujours plus de viols et toujours plus de violence, voués à réduire les États-Unis en cendres. Et quand les corps des Américains sont flasques et ridicules, les Mexicains sont hyper-érotisés, beaux comme des dieux grecs, dans l’idée que la beauté extérieure est un signe de hauteur morale. Car si les cartels sont meurtriers, Refn semble bien considérer que ce sont eux qui représentent le bien, ou en tout cas le couple Jesus-Yaritza, dans le sens où, tout violents soient-ils, leur violence est dirigée contre ce qu’ils considèrent comme le mal, comme la décadence. Leur opposition au couple Viggo-Diana, qui eux aussi combattent le mal par la mort et la violence, qui eux aussi haïssent ce que devient l’Amérique, semble presque contradictoire, uniquement affaire de principes, mais elle représente pourtant la lutte entre le passé et l’avenir. Quand bien même leur combat est le même, Viggo et Diana sont les représentants d’un monde déchu, avec leurs corps vieillis, leur impuissance et leur statut de parias, tandis que Jesus et Yaritza, si prompts à jouir (on l’oublie souvent mais si le sexe est une pulsion qui irrigue de façon implicite la plupart des films de Refn il le représente rarement de façon frontale, or il n’a ici aucune gêne à le faire), sont beaux, jeunes, en bonne santé et adulés de tous. Les premiers espèrent remettre les États-Unis sur de bons rails, les seconds veulent tout simplement les détruire, pour les remplacer par une nouvelle société vertueuse, un monde foncièrement violent, mais cette fois-ci matriarcal. Car en plus de dépeindre la revanche du Mexique sur les États-Unis, Too Old to Die Young montre la reconquête du pouvoir par les femmes et leur emprise sur les hommes : Jesus est maquillé, pénétré, infantilisé, érotisé de la façon dont on le fait plutôt des femmes, et tout ça de son plein gré (un des travellings latéraux sur le couple est même illustré par une chanson à la gloire du fist-fucking).
Cette jonction entre la violence et l’érotisme pourrait moralement poser problème, et pourtant – et c’est une de ses plus grandes réussites – le réalisateur arrive à conjuguer les deux sans que l’esthétisation des meurtres ne diminue leur horreur. En fait il s’agit là de quelque chose d’inédit à mes yeux, que je n’avais même jamais conçu par la pensée : à une époque, la découverte de Matrix des Wachowski et d’Elephant de Gus Van Sant lors de la même journée avait beaucoup influencé ma vision du traitement de la violence au cinéma, jusqu’à créer dans mon esprit une grille de lecture dans laquelle Too Old to Die Young n’entre manifestement pas. Après avoir vu Elephant donc, je ne pouvais plus concevoir les morts à foison de Matrix sans qu’elles me paraissent profondément indécentes, puisqu’elles étaient traitées comme des événements banals, sans incidence, ce qui prouvait que la vie n’avait aucune valeur dans les blockbusters américains (bien sûr, l’expérience aurait été la même avec des milliers de films autres que Matrix). Ainsi donc on pouvait représenter la mort soit comme l’étape définitive de la vie et une de ses plus importantes, un jalon tragique et terrifiant mais pourtant inéluctable, soit au contraire comme un non-événement, un simple élément de scénario qui n’a d’effet sur personne quand elle concerne un des antagonistes, puisque ceux-ci n’ont aucune existence propre : ils sont nés pour mourir sous les armes des héros. Bien sûr j’ai intégré diverses nuances à ce tableau au cours de mes découvertes cinématographiques, et surtout pu distinguer une troisième voie (parmi d’autres peut-être, y compris l’angle comique), celle de l’esthétisation de la mort, ou le meurtre vu comme une œuvre d’art. Là aussi on peut se poser des questions sur la valeur morale d’un tel traitement, mais le fait est que sans se pourvoir d’une coloration tragique il lui permet de regagner son caractère événementiel. Néanmoins je ne voyais pas comment associer une vision fataliste de la mort, cette espèce de peur du vide qui peut m’étreindre à la vue d’Elephant, avec la fascination éprouvée devant un meurtre esthétisé (sans même parler des morts anecdotiques des blockbusters), et c’est pourtant ce que Refn parvient à faire ici. Cela paraît presque impossible à concevoir : la violence est belle, constamment magnifiée, comme Refn le fait souvent dans ses films, et pourtant elle possède bel et bien ce caractère fatal, effroyable et définitif, renvoyant le spectateur à sa propre mort à chaque fois qu’un des personnages disparaît. Encore une fois je ne m’explique pas comment il parvient à ce résultat, mais c’est l’effet produit en moi et je ne crois pas me souvenir d’autres œuvres dans ce cas.
Et ce seul élément suffit à faire de Too Old to Die Young une réussite majeure, et peut-être le plus beau travail de son auteur ; une œuvre foisonnante multipliant les pistes et les idées, faisant cohabiter des intrigues parallèles jusqu’à non pas qu’elles se rejoignent mais qu’elles se consument les unes les autres – belle adéquation entre la forme et le fond. Refn semble avoir mis tout ce qu’il avait dedans, au risque de la contradiction, mais il aboutit à un véritable monstre d’une honnêteté fulgurante, à l’opposé de l’étiquette de cinéaste de la vacuité et de la pose qu’on lui accole souvent. Oui d’un point de vue formel c’est toujours très soigné, avec des expérimentations permanentes sur les lumières et les couleurs, toujours liés à l’état émotionnel des protagonistes (cf. la bouleversante scène finale de l’épisode 9, avec un des verts les plus marquants depuis Sueurs froides, ou la coloration progressive de l’image lors de la scène de masturbation de Diana, répondant à son propre plaisir : du bleu au rouge, puis retour au bleu), mais il ne s’agit aucunement d’une simple façade destinée à décorer un scénario rachitique. Le réalisateur a mille choses à dire et il les dit, alternant entre sérieux et humour, réalisme cru et hallucination venimeuse, sans hésiter à couper court à tout développement inutile. À une occasion précise (la fin de l’épisode 8), il parvient même à susciter, lors d’une très courte séquence, un paroxysme de terreur abstraite digne du Lynch de Rabbits : il suffit de l’apparition d’une brume rougeâtre accompagnée de hurlements fantomatiques pour que le monde qu’il crée entrouvre les portes de l’enfer. La fin est ouverte, au bout d’une demi-heure qui peut aussi bien être considérée comme une transition avant une nouvelle saison de série (comment Diana va échapper à Yaritza) que comme l’épilogue d’un vaste film (tout est déjà joué, et la prêtresse n’a plus qu’à cueillir sa nemesis, qui profite de ses derniers instants de vie en déplorant son échec à restaurer la pureté morale de l’Amérique sans savoir que l’ombre qui se dirige vers elle est celle qui y parviendra). Mais qu’il y ait suite ou non il y a déjà mille raisons de se replonger dans la noirceur de ces treize heures de fantasme éveillé.