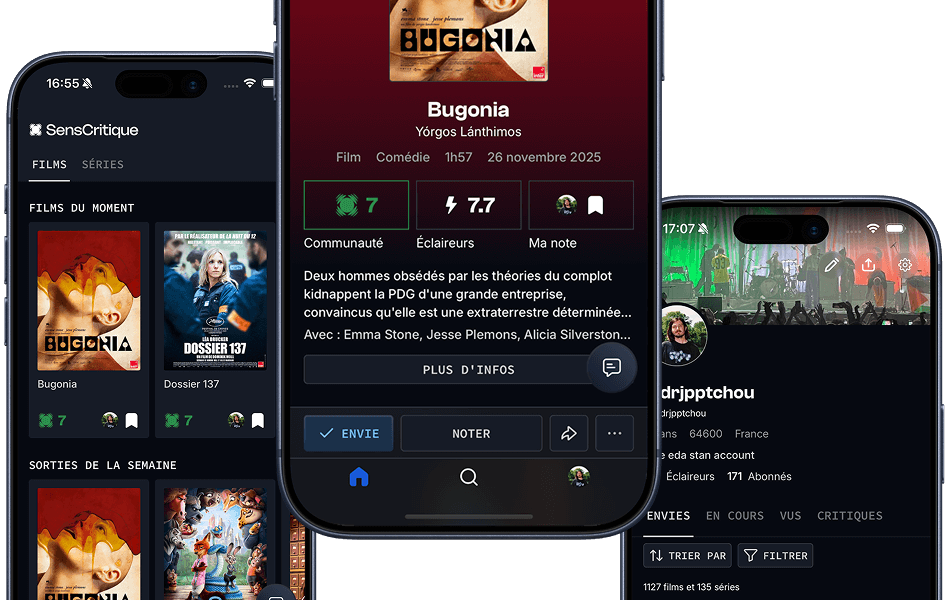En 1967, Brel vient de quitter la scène, pour vivre sa vie et de nouvelles expériences. Il vient de sortir "Les risques du métier", le premier film où il est la vedette. En parallèle, il prend des cours d'aviation, où il s'avère être un putain de doué (sur son test d'aviation, il arrive à réussir autant de points qu'un pilote professionnel atteint au bout d'une troisième évaluation). Dans ce contexte de découvertes assoiffées, d’insatisfactions vitales qu'il combat, il semble logique qu'il ait revu plusieurs fois, en flash-back, les racines de cette perpétuelle remise en question de ses désirs ; "l'Enfance" s'impose en ouverture. La chanson la plus longue du Grand Jacques, avec ses 5 minutes 37 qui résonnent comme une pièce musicale, narre l'ennui déclencheur. Les vers retranscrivent, en crescendo, une carte postale bourgeoise toute en nuances, avec son style qui virevolte (J'avais l’œil du berger, mais le cœur de l'agneau" ; "Je voulais prendre un train, que je n'ai jamais pris" - là il évoque ses rêves de journalisme). L'accompagnement musical, dans un premier temps grisonnant, dans un deuxième amplifié par des cordes, dans un troisième brutal avec des cuivres théâtrales : une vraie métaphore de sa vie d'adulte à ce moment-là. Un contraste qui veut tout dire. "Le cheval" est dans un registre plus en dérision. J'ai jamais compris comment on pouvait rapprocher son visage de celui d'un cheval, Fernandel oui mais Brel... Comme ce disque parle particulièrement de lui, la référence à "Ne me quitte pas" (qui n'est tout de même pas aussi salée que celle à "Amsterdam" dans "Vieillir") est clairement significative sur ce qu'il craint de devenir, et ce qu'il espère fuir justement en esquivant Madame, qui serait donc la Scène Musicale. Par contre, niveau arrangements musicaux, ceux de la chanson ne m'ont jamais transcendé. "Mon père disait", qui souhaite à l'évidence succéder au véritable étendard sublime qu'était "Le plat pays", n'arrive pas à sa cheville malheureusement. Pour le coup, pourtant, c'est la musique que je préfère : la préciosité des cordes fait penser au vent sur les plages du Nord, la guitare à l'intimité et au dérisoire de l'individu qui est face à la mer. Mais les paroles, je n'y ai jamais adhéré, parce que j'ai l'impression que Brel force ses images : il n'est jamais aussi bon qu'en les laissant respirer, s'induire d'elles-mêmes dans l'imaginaire de l'auditeur. "La...La...La..." est une chanson comique ! C'est dommage, à titre posthume, que Brel soit catalogué chanteur triste, alors qu'il a toujours fait l'équilibre sur ses albums... J'ai toujours bien aimé ce morceau ! On le sent qu'il s'amuse, à peindre ce portrait pathétique, à se foutre à nouveau de la gueule des Flamingants, et la musique pétée le suit dans ce délire alcoolique. Et je mourirai cerné de rigolos / En me disant qu'il était chouette Voltaire / Et qu'si en a des qui ont une plume au chapeau / Y en a des qui ont une plume dans l' derrière : c'est n'importe quoi mais c'est génial. "Les cœurs tendres", issu du film "Un idiot à Paris" : un bijou. Je glisse une anecdote cinématographique peu connue : Louis de Funès était fan du film, au point qu'il le regardait au moins une fois par mois chez lui. C'est cela qui a déclenché sa rencontre avec Serge Korber, le réalisateur, et qui aboutira à deux ovnis dans sa carrière, qui lui ressemblaient beaucoup : "Sur un arbre perché" et "L'homme orchestre". "Les cœurs tendres" est juste adorable : les paroles sont près de la perfection (Ils ont le cœur si large / Qu'on n'en voit que la moitié : c'est tout simple, et tout est dit), la musique appuie la rêverie par un accordéon distrait lui-même, et l'interprétation amplifie ce qui semble être presque une affaire personnelle, comme si Brel s'interdisait de se tromper sur ce sujet. "Fils de...", par contre, j'ai jamais pu aimer. Jacques Brel a toujours eu des grandes aspirations de comédies musicales, bien avant "Don Quichotte", et il en a conservé jusqu'à la fin de sa vie (la moitié des titres des "Marquises" sont notées "pour la comédie musicale Arlequin", dont il n'existe même pas une ligne). Ici, c'est clairement ce qu'il veut comme traitement, et pourquoi pas, je peux aimer ça ("Le bon Dieu"). Mais là, c'est pathos au possible, aucune subtilité dans l'orchestration, tout ce que j'entends c'est que Brel aurait voulu insérer cette chanson dans une séquence où il devrait rassurer un personnage à propos de paternité. Et ça m'énerve. "Les bonbons 67", retour à l'humour ! Là, c'est une suite directe, une nouvelle auto-référence pour symboliser qu'il pense commencer à finir le tour. De nouveau, c'est pas digne du brio du premier, mais j'aime quand même beaucoup cette relecture où le protagoniste a décidé de devenir une "personne respectable", un mouton bien sociable, et qui "rechute" à cause des bonbons. La pente fatale. Vieilli dans le bon sens du terme sur la forme (le Paix au Vietnam ! acclamé par son public fait toujours plaise), le fond semble être voué à rester dans l'intemporel. Et on s'amuse bien. Renversement, on passe à "La chanson des vieux amants". Et là, c'est l'émotion pure et absolue, une de ses plus belles chansons. Tout va : paroles à chialer (Mais n'est-il pas pire piège, que de vivre en paix pour des amants ?), musique à dimension hivernale (notamment avec ce basson qui joue les notes du dernier vers comme un requiem qui s'éteint), interprétation bouleversante. La première fois que je l'ai écoutée, j'ai pleuré, parce que rien ne nous prépare à une telle claque... Incontestablement la meilleure. Je recommande aussi la reprise de Juliette Gréco, sortie quasiment en même temps, et qui est pour le moment la seule reprise de Brel que j'aime. On est encore à tenter de se ressaisir, qu'on bascule de nouveau dans un tout autre registre : un sketch chanté. "A jeun", bien que mal placé objectivement (juste après "la chanson des vieux amants", quand même, niveau transition...), est intéressant, mais surtout pour la poussée de l'envie de Brel pour jouer la comédie. Ça en devient le principal atout de la chanson. Avec une référence inattendue pour Nino Ferrer ! L'album se finit sur le tout aussi surprenant "Le gaz". J'avoue que j'ai pris un bon moment à comprendre où il voulait en venir... Là, le principal intérêt de la chanson est dans le sous-entendu. D'où le titre : le gaz, ça réchauffe. Mais le gaz, en lui-même, on s'en fout. C'est pareil pour la Madame, et c'est pour cette raison que tout le monde se pousse au portillon... Encore une fois très amusant, bien qu'abrupte comme final.
"67" a un intérêt davantage pour ce qu'il dit sur Brel à cette période particulière de sa vie, parce qu'artistiquement, il souffre d'être entre "Ces gens-là" et "J'arrive", deux mastodontes quasi-parfaits. Là, on a que trois chansons qui sont à la hauteur de ces deux albums ("Mon enfance", "Les cœurs tendres" et surtout "La chanson des vieux amants"). Mais je l'aime beaucoup quand même. Ce sont les dernières chansons chantées sur scène. Ce sont les premières où il exprime à ce point ses désirs de comédie musicale et de comédien. Et, finalement, cette proéminence de chansons amusantes témoigne de son implication sur ce qu'il fait à côté, et qui le rend heureux : il n'a pas la tête à chanter la mort ici. Il commence par la résignée "Mon enfance", et finit par la pleinement assurée "Le gaz". Etant donné que j'aime autant Brel l'homme que Brel l'artiste, et que les deux ici sont en parfaite communion, cet équilibre personnel me fait plaisir à être retranscrit. Un dernier soir avant une nouvelle aube, tous deux d'une aussi grande beauté, ça reste un événement.