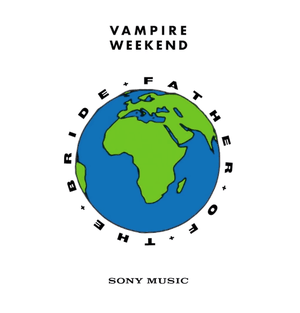J'ai longtemps détesté Vampire Weekend. Oh, par principe, comprenez bien : ces gens-là m'ont toujours paru au mieux fades et au pire passablement irritants. Cette voix suraiguë et surexcitée, ces chansons excessivement sautillantes... Tout cela puait le groupe estival branchouille, trop niais et enthousiaste pour être honnête. Je me serais bien contenté de les ignorer, cordialement, sans rancunes, mais ce serait oublier qu'en 2008 et jusqu'en 2010, les bougres étaient partout. Impossible donc, pour le moins de 20 ans que j'étais alors, de ne pas radicaliser mon opinion. Ces gars, je les ai détestés, c'est comme ça. Pour ne rien gâcher, ils étaient riches comme tout, nés avec une cuillère d'argent dans la bouche comme le chantait ce prolo de Roger Daltrey sur "Substitute". Ça ne rendait mon ressentiment que plus légitime, n'est-ce pas ? Et puis. Et puis on grandit, les années passent, la haine gratuite s'étiole naturellement en indifférence. Je rencontre quelques types dont j'estime les goûts et qui tiennent le groupe en haute estime... mmh ok... je réalise que c'est un des groupes préférés de ma copine... ça commence à faire beaucoup, peut-être serait-il temps de sortir ma tête d'autruche de son petit trou douillet pour m'offrir une séance d'UV en riche compagnie. Juste histoire de ne pas mourir idiot hein. Ça, c'était il y a 3, 4 mois. Depuis, ce qui devait arriver arriva : j'adore Vampire Weekend.
Vous pouvez m'appeler "La Girouette", c'est de bonne guerre, mais que voulez-vous. L'être que je suis devenu est parfaitement incapable de résister à des chansons pop si parfaitement bien faites, riches et concises à la fois, regorgeant d'accroches mélodiques toutes plus entêtantes les unes que les autres, aux arrangements terriblement ingénieux et à ce flair naturel dans l'inclusion d'influences ""du monde"" dans leur solide formule pop. Je ne peux même pas crier à l'appropriation culturelle (nombreux sont les social justice warriors qui s'y sont fourvoyés) tant ces influences sont autant de lettres d'amour candides adressées à leurs maîtres. C'est bien simple : ils ont sortis 3 albums qui sont autant de glorieuses réussites. J'ai bien une petite préférence pour Contra, leur second, et je regrette un poil qu'ils aient troqué un peu de leur fougue juvénile contre une mélancolie classieuse sur Modern Vampires of the City, mais tout ça c'est du pinaillage. Je ne trouve rien de sérieux à redire à leur musique jusqu'à présent.
Mais parlons-en un peu, du présent. Depuis 2013, le groupe n'avait pas donné de nouvelles, si ce n'est pour annoncer le départ de Rostam Batmanglij, claviériste, arrangeur et producteur de talent (ouch!). Alors 6 ans plus tard, avec tout le poids des attentes d'un public qui lui est resté fidèle (et qui n'a fait que croître depuis que le mature Modern Vampires leur a conféré un statut plus respectable) ; Ezra Koenig, sous la pression, décide de voir plus grand. Et plus long. Au diable les 10, 11, 12 chansons habituelles, cet album sera double et en contiendra 18. Oh, Rostam s'est barré ? Qu'à-cela-ne-tienne, Ezra ramène sa nouvelle pote Danielle Haim (une des trois soeurs du groupe Haim) pour faire trois featurings et une tonne de chœurs, ainsi qu'une armée de producteurs, co-compositeurs et autres musiciens de studio (Steve Lacy, Ariel Rechtshaid, Mark Ronson, Sam Gendel, Ludwig Göransson, DJ Dahi et même Rostam qui au fond n'est pas autant parti qu'il aimerait le faire croire, bref j'en passe). Avec tout cela, il élabore une double galette sur laquelle il se permet deux choses.
Premièrement : s'amuser. Après un Modern Vampires très classieux et bien coiffé, Ezra remet de la couleur dans sa musique et s'autorise à ponctuer sa tracklist de fulgurances stylistiques inédites. Je citerai l'espèce de flamenco rockabilly de "Sympathy", le baggy extatique de "Harmony Hall", la sunshine funk de "Sunflower" et son scat obsédant, le trio country-pop avec miss Haim, la bluette Calypso lo-fi de "Rich Man", ou encore les touches électroniques de "Jerusalem, New York, Berlin" si discrètes et massives à la fois qu'on dirait que SOPHIE est en train de mixer à 1km de là... et je m'arrêterai là pour ne pas barber mon pauvre lectorat. Mais je pourrais continuer, car il semble évident que sur chacun de ces morceaux, Ezra a voulu se remettre en question pour leur conférer un écrin unique. Et c'est clairement la plus grande force de cet album : sa diversité et le soin méticuleux apporté aux arrangements et à la production. Le périple de Father of the Bride est celui d'un safari en HD, ce qui peut décontenancer au premier abord pour sûr mais garantit (pour ma part en tout cas) un album long en bouche, qui ne cessera de révéler ses richesses au compte-goutte. À vrai dire, plus je l'écoute en boucle en écrivant ces lignes, plus je revois à la hausse certaines des pistes que je croyais plus faibles...
Deuxièmement : politiser. Et ça, ça n'est pas non plus tout à fait étranger au groupe. Ezra, son master d'anglais sous le coude, a toujours fait la chronique de l'upper class auquel il appartient avec un œil critique. Mais là il y va plus frontalement, sans dissimuler autant qu'avant son propos derrière des références plus ou moins opaques. Quand on se penche un peu sur les paroles, c'est assez clair ; violences raciales, critique de l'institution du mariage, commentaires sur l'animosité entre religions et la désignation d'un bouc émissaire, rêve américain déboulonné et migrants désillusionnés, le désormais inévitable taquet à l'administration Trump (faut dire que Ezra tournait avec Bernie Sanders), le rêve d'une main tendue... Ce qui cache en revanche ces thématiques, ce ne sont pas les paroles, plus claires qu'elle ne l'ont jamais été chez Vampire Weekend, mais plutôt la musique elle-même. On est souvent surpris à la lecture du texte de réaliser que ce petit air souriant, ces mélodies bon enfant, ce groove sautillant, sont en train causer sérieux. C'est là sans doute un point faible du disque, qui présente un déséquilibre certain entre ses commentaires politiques, ces récits amoureux et son ton somme toute très léger et détendu - pour ce qui est de la musique tout du moins.
Alors dans la balance, Father of the Bride est-il une déception ? Pas du tout. Il a certes les inévitables défauts de ses qualités, ses inégalités allant de pair avec son ambition. Mais en voulant faire tant, Ezra Koenig a avant tout créé avant toute chose un album généreux, qui met du temps à se dévoiler au même titre qu'il a pris du temps à être conçu, et qui se savoure paisiblement alors que le printemps menace doucement de devenir estival. Un album qui, quitte à s'amuser un peu, me fait penser à la rencontre pas si improbable que ça entre le White Album des Beatles (pour le fourre tout qui se réinvente en permanence, et le talent d'Ezra pour le pastiche sublimé qui n'est pas sans rappeler un certain Paulo) et le Man of the Woods de Justin Timberlake (pour le côté jeune père qui se découvre une conscience politique et pour les embardées stylistiques urbano-champêtres). Faites-en ce que vous voulez, pendant ce temps je vais aller me resservir un Martini Schweppes.
Chronique provenant de XSilence