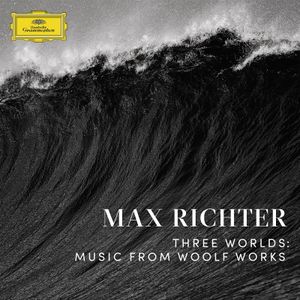Deux voix dissonantes se sont manifestées en France lors de la sortie de Three Worlds : Music from Woolf Work de Max Richter, pape stakhanoviste du néo-classique et du post-minimalisme. Francis Dordor des Inrocks laisse entendre que le compositeur germano-britannique « commence à montrer des signes de fatigue », tandis que la charge est beaucoup plus lourde du côté de Libération : selon Olivier Lam et Guillaume Tion, Max Richter serait carrément « l’équivalent de Marc Lévy en matière de musique ».
Max Richter, c’est entendu, fait les mêmes disques depuis quinze ans, c’est-à-dire la parution du magnifique Memoryhouse, condensé de mélancolie grisâtre. Pourquoi les Inrocks lui tombent-ils alors dessus à bras raccourcis aujourd’hui, quand ils encensaient il y a encore peu son travail (Valse avec Bachir et Sleep) ? Ne serait-ce pas, après tout, son public, qui pourrait commencer à fatiguer ? Car dès les premières notes de Three Worlds : Music from Woolf Work, cette impression tenace de déjà-vu, ou plutôt de déjà-entendu, peut parasiter les premières écoutes. Il est vrai que Max Richter fonce chaque fois tête baissée dans ses marottes : « une nappe de synthé, des pains d’infrabasses, un arpège de piano tandis qu’un violoncelle saute d’une octave à l’autre sur un tempo à 60 » (Libération toujours). Tion et Lam renchérissent même, sans nuances : Richter serait « le nouveau maestro d’une musique contemporaine en quête de repères (et de lucrativité »), et ses compositions du «litron de musique-au-mètre anonyme ». A sens unique, les deux journalistes cèdent finalement à la sentence couperet : la musique de Richter pâtirait d’« un déficit criant d’innovation », quand ils soutiennent, eux, que « le «progrès» demeure une valeur artistique largement partagée ».
Problème : si l’on devait condamner tous les artistes ou les genres qui recourent à des formules, la musique, entre autres arts, fermerait boutique. Richter n’invente rien, soit. Il s’auto-plagie, soit. Quant à cet aphorisme sur le progrès : dès lors que l’on prend un petit peu de recul, on pourrait le balayer d’un revers de main, tant les carrières fabuleuses d’artistes, tous genres confondus, et qui n’ont jamais remis en cause leur son, sont finalement bien nombreuses (exemples au débotté et en vrac, Bob Dylan, Neil Young, Grandaddy, Nirvana, The Field, Leonard Cohen, Chris Clark…). Ce que Lam et Tion oublient dans leur texte à charge, c’est d’évoquer le pouvoir émotionnel de la musique de Richter, un pouvoir qu’ils résument un peu vite à « une eau tiède néo-tonale ». Osons prétendre, au contraire, que sa musique est images, tristesse et universalité. D’où le recours fréquent à ses services par des réalisateurs de tous horizons géographiques, et aux aspirations narratives très diverses. Rappelons simplement que si les bouleversants Valse avec Bachir et Le Congrès sont aussi émouvants, c’est en grande partie du au travail de Richter et ce qu’il dit sur l’affliction.
La question de l’autosuffisance de Richter, qui pourrait se poser du fait de la redondance de son œuvre, s’abîme dans Three Worlds : Music from Woolf Work : car ce dernier disque révèle en creux le secret Richter, où beauté formelle et puissance évocatrice ne font qu’un. Ce secret c’est cette obstination de la part d’un compositeur qui croit en sa capacité à redonner à l’adjectif « lacrymal » sa signification première, loin de la sensiblerie affectée qu’on aimerait lui prêter ici : un mystère physiologique.