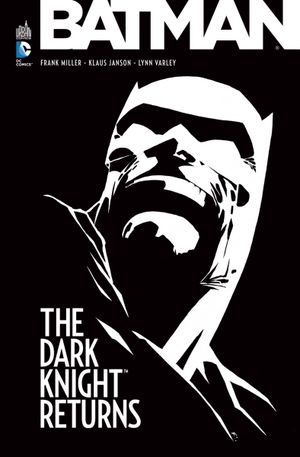Critique publiée sur Kultur & Konfitur.
L’idée de départ est tout bonnement excellente. Après des années d’inactivité, Bruce Wayne fait le choix de rendosser le costume du Batman. Il semble avoir vécu ces dix ans mal dans sa peau, hors de lui-même, sans être celui qu’il doit être. Le crime reprend lui aussi du service, dans une amère critique de la nature humaine qui répète ses schémas de violence ultra-individualiste de l’homme envers l’homme. Partant ce cette situation initiale qui pose déjà beaucoup de questions (le vieillissement de Wayne/Batman, sa capacité à faire face à un nouveau banditisme moins individualisé, plus banalisé), le scénario de The Dark Knight Returns manque malheureusement de cohérence et tend à s’éparpiller, sans trouver de vraie ligne directrice. En tant que lecteur, on est finalement un peu perdus, rien n’est réellement approfondi. Je suis un grand défenseur du bris de la narration classique qui donne toute réponse, mais ici j’ai juste l’impression que Miller lui-même ne sait pas trop où aller et qu’au fond il s’en fiche un peu. On passe des mutants à Superman, à travers la manipulation politique en pleine guerre froide et le retour du Joker.
Bruce se lit
Le style graphique, lui aussi, va dans cette direction d’éclatement et de patchwork. Le pari est osé et il faut lui reconnaître cette audace, mais on se perd un peu entre vignettes télévisées simplistes, planches beaucoup plus détaillées et « classiques », plus sombres aussi, pages où c’est un joyeux bordel… Il manque une vraie cohérence là aussi pour rester accroché sur l’ensemble du récit, on se pose souvent la question des choix graphiques.
Mais peu importe, car tout cela est au service de la vraie force de ce retour de Batman. Le récit et le visuel est éclaté, chaotique, mais cela n’est que le reflet du chaos qui règne dans Gotham, d’une société qui perd ses repères et cette fameuse cohérence, pour s’effondrer dans la somme des individualités. Si le choix peut dérouter, il est parfaitement cohérent, cette fois, avec l’idée force de Miller qui est de pourfendre cette société américaine des années 80 où il place les médias comme opium du peuple, et les politiques comme corrompus et intouchables. Face à cette décadence de la société américaine renaît un Batman qui n’est prêt à aucun compromis. S’il faut des sacrifices, s’il faut tailler dans le lard, tant pis, on est allés trop loin. Gand-Alf a très judicieusement comparé ce Batman au « Dirty Harry » incarné par Eastwood (1). C’est exactement ça, et si la confrontation à Superman peut apparaître saugrenue et tombant un peu comme un cheveu sur la soupe, elle sert surtout à faire s’opposer deux visions de la justice et de l’humanité. D’un côté, Superman croît en l’humain et en sa capacité à élaborer des lois qui font fonctionner la cité, lois auxquelles il décide de se soumettre sans jamais les remettre en cause. En face, « Dirty Bruce », pour reprendre le titre de la chronique de TotoroM se fout de lois qui n’ont plus lieu d’être dans les mains des dirigeants qui les usent à leur guise. Il faut dépasser ces lois pour rétablir la justice. L’homme a perverti ce sentiment pour lui ultime, et Batman est prêt à tout, même au pire, pour le rétablir, quitte à se mettre à dos le monde entier. Pour arriver à son but, il dépasse même la nature, son vieillissement, peu importe les séquelles, seule la volonté compte.
Miller dresse un critique féroce de sa société contemporaine, comme il a pu le faire plus tard dans Sin City ou, en gardant la même cible principale (les médias), dans The Dark Knight Strikes Back, où le récit et le visuel sont encore plus éclatés et bordéliques, où le compromis est encore plus faible, la nuance encore moins présente. Malgré les quelques réserves que j’ai pu émettre au sujet des choix graphiques et du manque de lisibilité, il faut bien avouer que Miller a très bien su exploiter son idée de départ en lui donnant une vraie profondeur et en en faisant le tremplin d’une vraie ambition, d’une vraie vision personnelle.
(1) : http://www.senscritique.com/bd/Batman_The_Dark_Knight_Returns/critique/12051197