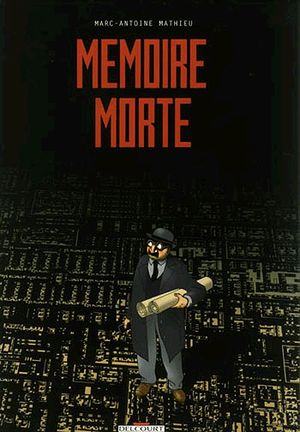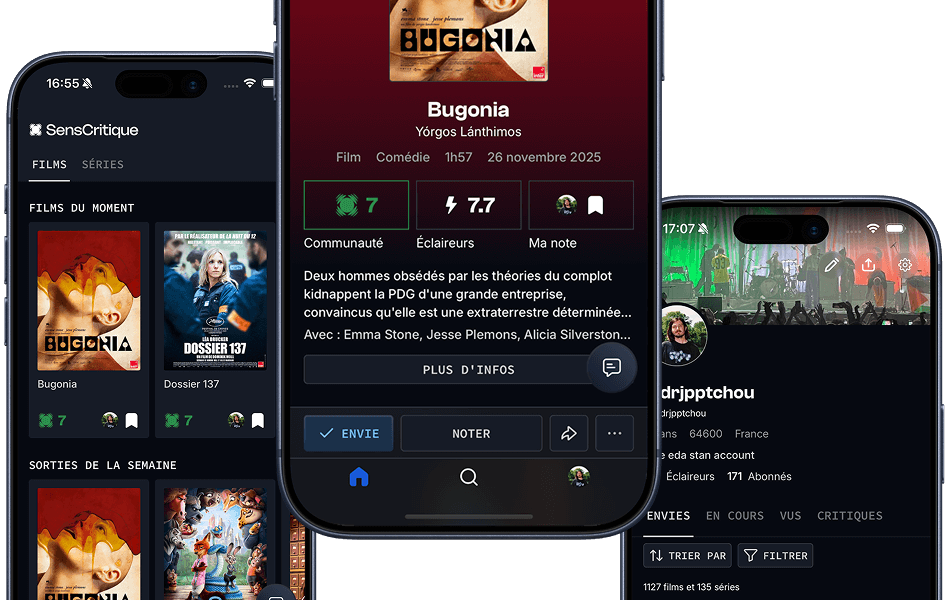J’ignore si ça signifie quelque chose, mais au moment où j’écris ces lignes, Mémoire morte a presque dix-neuf ans. Si l’on admet que les récits d’anticipation, et plus précisément, comme ici, de dystopie, ont tendance à vieillir plus vite et plus mal que les autres fictions, cela donne la mesure de la qualité de l’album, publié après le quatrième volume de la série des Julius Corentin Acquefacques, dont il pourrait constituer un side project. D’ailleurs, à un moment, le personnage principal rêve.
Acquefacques, donc Kafka, est cité, sous le nom de « J. Akfak, qui est à l’arpentage pour les services du bâtiment » (p. 9). (Dans mes souvenirs, le personnage principal du Château est « arpenteur ». Voir encore le « réveil en sursaut de la page 43, qui évoque la Métamorphose.) Du reste, on retrouve le même univers en noir et blanc, « un monde sans nature, peuplé uniquement d’hommes adultes blancs, des embouteillages piétonniers (!), une promiscuité de chaque instant, une ville entièrement consacrée à l’administration – wieder merci, Franz ! – et dont l’architecture ferait passer le palais de justice de Bruxelles pour une cahute… » (oui, je cite ma propre critique de l’Origine).
La dystopie était déjà en germe dans les « JCA ». Ici, elle se déploie sous forme d’un récit, qui suit le parcours de Firmin Houffe (parent du Igor Ouffe de l’Origine ?), fonctionnaire moyen au service cadastral, au moment où la cité aborde une crise que les autorités semblent décidé à ne pas traiter – d’où de jolies variations sur le thème il est urgent d’attendre, façon « commission pour l’observation du phénomène en vue de l’élaboration d’une analyse » (p. 34). Sans trop dévoiler la nature exacte de cette crise, on peut dire qu’elle se traduit par une disparition progressive et conjointe de la mémoire et des mots.
Elle est surtout l’occasion de dresser le tableau d’une société ultra-urbanisée qui a confié, c’est-à-dire abandonné, une partie de ses décisions et de sa mémoire à Rom, une sorte d’ordinateur géant, « fruit d’amours incongrues entre le culot de la rêverie et l’ingénuité de la science (ou l’inverse ?…) » (p. 49) qui, dans l’album, a des petits airs de Kaaba. Rom raconte : « Au début, lorsque vous m’avez créé, l’enjeu paraissait équilibré : j’analysais les données que vous me donniez, je vous livrais des réponses pratiques, disons matérielles. […] Mais insidieusement, un déséquilibre s’est produit : vous vous êtes laissés aller au confort de mes réponses (toujours justes car si conformes à vos désirs !…) » (p. 53).
Cette société est tout entière marquée par la communication et l’information. Pas seulement la publicité. (Dans Mémoire morte, toutes les publicités font la publicité… de l’information !…) Elle est « Un monde immatériel, constitué de communication pure, sans actes. | Réel ou irréel ? Il semblait bien exister pourtant. Comme si ce monde avait supplanté l’autre… » (p. 42). Aucun rapport avec nos métropoles de 2018, évidemment…
On aurait pu craindre que l’auteur vienne tout foutre en l’air avec ses gros sabots, transformant son œuvre en réquisitoire, comme cela se produit trop souvent dans les récits dystopiques. Or, ce n’est pas le cas. D’une part, le propos n’est jamais explicitement politique – ce qui permet d’éviter la pauvreté intellectuelle d’un Matin brun, par exemple –, l’une des caractéristiques de la Cité étant précisément son apolitisme absolu, tout semblant être une question d’administration. Là encore, rien à voir avec 2018, où tout pousse à croire que rien n’est politique…
D’autre part, l’auteur n’oublie jamais qu’il fait une bande dessinée – ce qui permet d’éviter la pauvreté littéraire d’un 1984, par exemple. Aucune insistance – quelques cases disséminées dans le récit – sur la « boîte noire » dont tout Citoyen est pourvu. Et le récit est formidablement construit, avec ce goût du détail signifiant qui caractérise le travail de Marc-Antoine Mathieu. (Un bémol pour quelques cases des pages 22-23, illisibles d’un point de vue narratif.) On pourrait certes regretter la voix off un peu lourde – mais l’intérêt de cette voix off réside aussi dans l’identité de celui dont elle est l’émanation.
Et la fin – qui rejoint le début – a quelque chose de presque niais, je l’admets, et de démonstratif, ce qui était sans doute le prix à payer pour mêler, dans une même séquence, un rapprochement entre la tour de Babel, la Cité de Mémoire morte et la carte-mère – ou quelque chose comme ça – d’un ordinateur.
P.S. – Dire que j’avais l’impression de voir du Borges un peu partout dans les Julius Corentin Acquefacques… Je me disais qu’avec Mémoire morte, ça passerait. Mais le prologue s’intitule « les Ruines rectilignes » et l’épilogue « les Fondations circulaires » – or, une nouvelle de Borges s’intitule « les Ruines circulaires »…