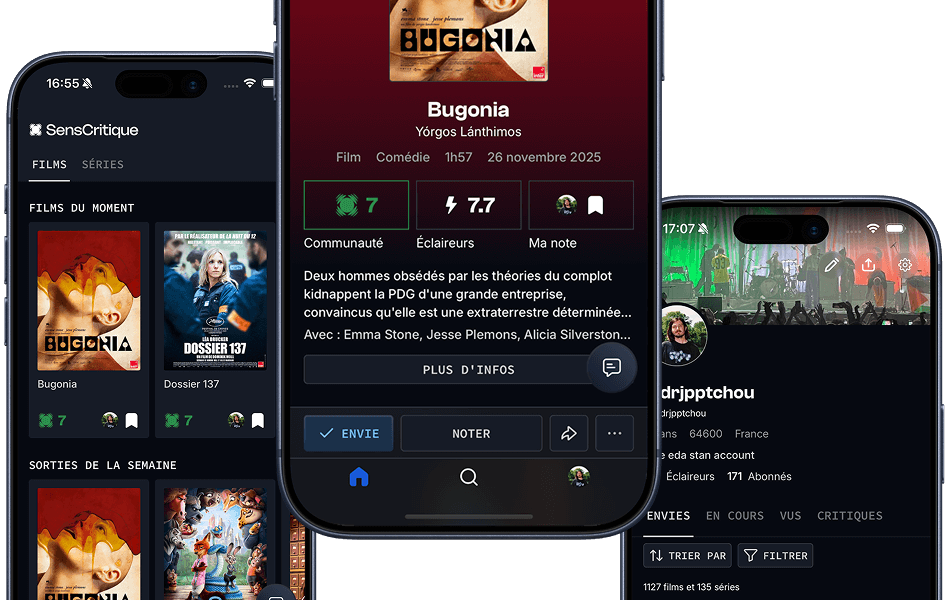Sandinistes en quête d'identité
Nicaragua, 1976. Le dictateur Somoza, soutenu par les Etats-Unis, voit des communistes partout dans son propre pays. Sa garde nationale traque les suspects dans les villes et les campagnes, entre autres ceux qui utilisent des briquets, symbole de résistance et d'opposition depuis que le gouvernement a imposé l'usage d'allumettes « nationales ».
Sur cet arrière-plan historique où se dessine l'émergence d'un archipel de résistants sandinistes anti-Somoza, Emmanuel Lepage introduit son héros et sa dramaturgie. Ce Gabriel, mignon petit séminariste au visage lisse, qui trouve le moyen d'être sexy même quand il porte la soutane, débarque dans un bourg assez perdu, appelé San Juan. Sa mission est de peindre une grande fresque religieuse dans l'église de l'agglomération. Gabriel, bénéficiant d'une sorte d'immunité en raison de sa condition ecclésiastique et de son origine familiale (belle et riche famille), va découvrir les réalités de l'oppression somoziste.
Lepage soigne la dramaturgie au moyen de personnages dotés de fortes problématiques : le curé de San Juan est réputé « mal penser », c'est-à-dire soutenir les sandinistes (ce que confirment les trafics bizarres qui se trament dans son église). Un Indien, Buenaventura, serviable et peureux, rêve de sortir de sa misère en s'engageant dans la Garde Nationale, qui pourtant ajoute le racisme anti-indien à sa haine du rouge. Concepcion, une fille publique assez sympa, se rit de la naïveté du puceau ensoutané qui débarque.
Une mise en abyme discrète s'installe au long du récit : Lepage dessine Gabriel qui dessine et peint le peuple. Comme tout véritable artiste, Gabriel s'exerce à réaliser des croquis pris sur le vif, et ses œuvres ont l'étrange pouvoir de révéler à de pauvres Indiens l'image qu'ils présentent aux autres. Loin d'être un croquis anecdotique de foire rurale brossé par un étudiant en Beaux-Arts quêtant quelque obole, le dessin de Gabriel aide en quelque sorte les « Indios » à prendre conscience de leur identité sociale au moment même où la revendication sandiniste se structure. Une fillette s'obstine d'ailleurs à voler le portrait que Gabriel a fait d'elle.
La lutte des classes n'est pas discrète : Gabriel, (presque) intouchable parce que fils de privilégié de la fortune, se fait agresser par un jeune paysan, qui rejette toute forme d'art au nom de la misère qu'elle représente. Et, quand Gabriel tombe par hasard en possession d'un briquet, le « comandante » local et le père de Gabriel ne sont pas vraiment contents, mais c'est en homme libre que Gabriel choisit de revenir parmi les paysans.
Les scènes de vie quotidienne (plus ou moins misérables) du petit peuple rural nicaraguayen courent à travers tout le récit : morphologies souvent grassouillettes et bedonnantes des ruraux, scènes de marché, écoles rurales plus que sommaires, cuisines domestiques sur un foyer au feu de bois, jeux d'enfants et d'adolescents dans la boue et les flaques de la dernière pluie, toilette nocturne près d'un gros bidon d'eau de pluie ; ferveur religieuse de cérémonies en plein air dans ce pays qui sait faire coexister de solides traditions indiennes parfaitement païennes et un catholicisme ardent, nudité extérieure et intérieure des églises, dont les différents locaux font plutôt figure de remise que de lieu sacré ; et bien sûr le gallo pinto, pour les moments où les bruits de bottes s'apaisent. L'amour du petit peuple nicaraguayen, si séduisant dans l'entièreté de ses croyances et de ses passions, est bien saisi par Lepage.
La technique du dessin est composite : les formes restent dessinées au moyen d'un trait fin, plus souvent brun que noir. Mais Lepage donne la priorité à la couleur, souvent magnifiée par des effets de contraste lumineux accentués. On appréciera la gamme des verts sombres et phosphorescents évoluant vers le jaune au gré de l'éclairage dans les scènes de jungle (planches 1 et 2) ; le vert ambiant contamine des visages qui, en toute logique, relèvent d'une autre couleur. Dans les scènes d'obscurité règne le bleu, qui se mue dans des ocres orangés dès qu'un éclairage précaire troue la pénombre. Les ciels constamment brumeux et indistincts rendent bien la saturation de l'atmosphère en humidité et la diffusion de la luminosité dans des directions imprécises (le cauchemar des photographes en milieu tropical humide). Les dégradés de luminosité peuvent se révéler doux et progressifs (page 9) ou plus rudes dans des rais de lumière (page 15).
Le tome 2 surprend un peu par son unité d'action soutenue : il s'agit de la fuite d'un groupe sandiniste à travers la jungle nicaraguayenne. Le héros, Gabriel, y désespère de pouvoir dissimuler son identité aristocratique à ses compagnons guerrilleros ; mais visiblement, pas mal de gens sont déjà au courant.
Encore plus surprenant, voire superfétatoire, le thème homosexuel qui se précise au cours du récit. D'accord, Gabriel est mignon comme une fille, mais enfin il trouve sans trop de problème des partenaires dans ce groupe minuscule. On peut toujours disserter sur la socio-psychologie d'un adolescent perdu dans une forêt où il n'a pas trop le choix. N'empêche qu'on ne voit pas trop ce que ces enlacements mâles apportent au récit.
Les interactions entre sandinistes fuyards, tous très typés (un homme crachant ses poumons, un quadragénaire un peu vantard, se targuant d'avoir fait ses classes avec Che Guevara, et une femme, bien sûr).
Très réussi : les images de la jungle. Ces branches et lianes de tous diamètres, qui s'enchevêtrent comme une toile arachnéenne suintante de moisissures et de parasites, les rais lourdement embrumés de la rare lumière qui parvient jusqu'à hauteur d'homme. Chaque feuille, chaque tige porte les stigmates de ses aventures et des agressions subies. Les ficus géants des planches 50 et 51 confortent la dimension supra-humaine de cette végétation.
Les hommes pataugent dans cette répugnante succession de marécages obscurs, pas trop embêtés par les sales bêtes, si l'on excepte les sangsues qui dévorent les jambes sexy de Gabriel, ou les crabes confortables qui me rappellent l'inoubliable « Punche de Oro » des légendes managuayennes. L'embrasement jaune et orangé d'un incendie de village troue subitement d'une chaleur sèche l'atmosphère liquide que l'on respire et dans laquelle on s'englue. Cette jungle obscure, c'est la nuit de l'Être dans laquelle le héros combat ses démons (son identité doublement honteuse : aristocrate et homosexuel) ; en ce sens, le récit intègre de classiques structures mythiques.
Les verts plus ou moins lumineux des sous-bois contrastent avec les bleus pâles des scènes de nuit, parfois érotiques, le violet angoissé d'une scène de traque nocturne, les ocres lumineux vite dégradés des scènes autour d'un feu.
On se doute que ce minuscule groupe d'éclopés sympathiques et rêveurs ne pouvait prétendre à renverser Somoza. Aussi l'épilogue situe-t-il la dernière action juste après le triomphe de la Révolution, quand fleurissent les célèbres fresques murales de Managua, quand les voisins du Nicaragua sont confirmés dans leurs aspirations à la libération, mais aussi quand les jeunes adultes de l'odyssée sauvage ont précisé leurs choix politiques, sexuels et sentimentaux.
Lumineux récit d'initiation, qui a le bon goût de ne pas imposer la localisation du Bien et du Mal. La discussion politique des planches 15 à 17, assez basique, est empreinte d'une espèce de retenue courtoise qu'on n'attend pas trop en cet endroit.