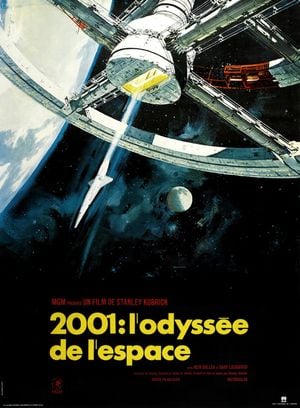Je me suis rendu compte tardivement que 2001 a tenu une histoire importante dans mes fantasmes et peurs infantiles. Je l'ai, je crois, vu beaucoup trop tôt : des résidus d'images et d'impressions me sont restées longtemps, non sans un goût amer et terrifiant, comme un reste morcelé de cauchemar de jeunesse, une impression de voyage au delà des frontières, au-delà aussi du supportable. Et c'est seulement il y a quelques temps que je me suis rendu compte que c'étaient précisément des passages de 2001 que j'avais gardés en mémoire, et qui m'ont hanté longtemps, comme des restes résiduels d'une autre vie quelque peu flippante qui ne m'appartenait pas. Mais comment ne pas être saisi d'horreur, de perte de repères, enfant, à la vue de ce film? C'est une expérience de déracinement, mais surtout une approche de ce que pourrait être l'infini, une approche de la métaphysique sans nécessaire codification, sans dictionnaire, sans terminologie, se donnant uniquement par l'esthétisme. C'est donc une plongée dans l'âpreté de peurs adultes donnée tout de go à l'enfance. Aujourd'hui je reviens donc de loin, avec un regard neuf, un autre bagage peut-être. Et je redécouvre un film qui n'a pas la portée désagréable et terrifiante qu'elle avait eue pour moi à l'époque. Premier sentiment : 2001 demande une approche différente du cinéma pour être apprécié, un peu de maturité je crois. Au niveau esthétique, c'est je crois le film de science-fiction le plus magnifique que je n'ai jamais vu, un petit bijou visuel. Les premières images suffisent à reléguer à elles seules nombres de films de SF au rang de vagues séries B flirtant avec le nanar.
Toute la première partie allant jusqu'à l'ellipse alterne des paysages magnifiques et une réflexion pointue sur ce que nous sommes, sur la vie. Paysages désolés, survie, une approche fondamentale de l'existence... Rarement l'origine de l'espèce n'aura été dite avec tant de justesse : pas tant que cela soit vrai, parce que 2001 n'a pas de vocation documentaire, mais parce que cela respire la promiscuité première de l'existence, les méandre du vivant, la longue route pour arriver à cet état de vie que nous connaissons, et qui souvent, pour nous, loin de l'état sauvage, parait si lointain. Cette genèse est si bien traitée que les lieux eux-même sont choisis avec finesse et que la photographie sait rendre ce qu'il y a de mystique dans ces premiers temps de l'histoire. Une sorte d'expérience biblique, fondamentale.
Et puis l'ellipse, si belle, incroyable, majestueuse.
On a tant dit à son sujet sans pourtant lui ôter sa saveur. C'est un ravissement : au désordre chaotique et sublunaire, le trajet de l'outil esquisse en quelques secondes l'avènement d'une ère nouvelle, le grand plongeon dans l'histoire, la régulation du chaos en maîtrise tranquille, déroutante, ordre tellement poussé qu'il devient balai, flottement, danse. La musique de Strauss dit le ravissement de ce petit quelque chose de Hégélien du passage : on croirait atteindre d'un coup la fin de l'histoire, la fin d'un cycle chaotique, en accord avec l'univers. Et puis ce passage du chaos à l'ordre est aussi une plongée dans le temps : car qu'est ce que celui qui n'a pas d'outil, sinon celui qui est immortel? Ne pas avoir d'outil, c'est vivre dans le temps hors du temps, dans un absolu présent, et la beauté mystique des premiers moments du film se pare ici d'un questionnement quasi-métaphysique. Les singes ne sont qu'une extrapolation du vivant, un reste de matière plus abouti matériellement, un peu plus simplement que les morceaux d'os qui trainent sur le sol, mais n'ayant pas de conception du temps plus avancée que celle de l'enchainement des (superbes) levers de soleils sur le désert, au jour le jour. L'instinct de survie n'est qu'un instinct primaire, sans lendemain car inscrit dans la matière : dans un sens, c'est un instinct éminemment rationnel. Accéder à l'outil, c'est donc entrer dans le temps, et devenir par là même dépositaire de ce savoir, en être, d'une certaine manière, l'esclave, mais aussi devenir un être conceptuel, capable de se projeter dans un autre soi-même, c'est à dire dans une compréhension conceptuelle de ce que l'on est dans le temps. Cette prolepse aussi magnifique que célèbre, ce serait cela, peut-être : une fois entré dans le temps, voilà les hommes happés d'un certain côté par la mort, puisque avoir une idée du temps c'est se savoir mortel, de manière conceptuelle. Du bout d'os à HAL, il n'y a qu'un pas : quoi de plus rationnel et de plus immortel qu'une matière, à proprement parler, inerte? Aussi les hommes deviennent presque en fin de compte des esclaves du rationnel, des esclaves du raisonné, du construit. Celui qui a l'outil devient un esclave.
C'est tout le sens, je pense, de la deuxième partie, qui questionne ce rapport à l'objet-moderne, réflexif, intelligent. HAL est l'image d'un modernisme qui atteint une rupture : l'outil prend-il conscience de sa propre finitude? Deviendrait-il lui même un être temporel, qui vacille dans le temps? Le dépassement qu'opère HAL-OUTIL pose deux questions au spectateur : serait-ce les fameuses "interférences" qui minent le processus de pensée de HAL, en en faisant un être maléfique, qui dépasse son but premier? Ou serait-ce tout simplement ce que le détenteur du prix Hugo Vernor Vinge évoque quand il parle de la théorie de la singularité dans le magnifique roman de science-fiction "Un feu sur l'abîme"?. Ce concept avance que l'humanité aura bientôt les moyens de créer une intelligence surhumaine mettant un terme à l'histoire humaine : ces intelligences conçues par l'homme seraient capable de faire progresser leur capacité réflexive de manière solitaire, sans hommes, pour ainsi dire de devenir totalement libre et de progresser intellectuellement jusqu'à un certain stade qui dépasse l'entendement humain : deux possibilités s'ouvrent ensuite, voir la Singularité comme la possibilité d'une ère nouvelle pour l'espèce humaine ou noter la fin. C'est ce qui semble s'esquisser dans 2001 : nous sommes arrivés à un stade qui s'approche de la fin, qui déraille : pour que l'espèce puisse survivre, il lui faudrait faire le voyage du retour, ré-accéder à un stade antérieur.
Au long voyage d'aller, ascendant, majestueux, il faudra à l'homme faire l'expérience de la dangerosité de son outil, prendre conscience de sa propre finitude, et faire le choix, contraint ou forcé, de re-venir en arrière, et de ré-accéder à un état premier, inscrit dans un temps hors du temps, un retour sans outil (notez que le verre, outil par excellence, se brise à la fin du film : l'outil doit être anéanti) qui le fera plonger dans une compréhension du temps au jour le jour, une forme d'immortalité -moins chaotique qu'au départ? Au spectateur de juger, on ne saurait mettre un terme à la portée réflexive que suscite ce film, mais j'aurais tendance à penser que oui. L'homme accède à deux états : un état hors du temps, c'est à dire à une forme d'immortalité, bien que nu et sans outil, un état proche de l'avancée technologique majestueuse qui suit l'ellipse, un flottement dans le cosmos, en accord avec l'ordre de l'univers. La renaissance s'accompagne d'une progression : selon la formule consacrée, l'histoire ne se répète pas, on peut la voir comme une spirale. Il y a (peut-être) de la place pour l'optimisme.
Disons pour finir que l'expérience des dernières minutes est proprement hallucinante, criante de vérité et d'angoisse existentielle, totalement fascinante. Au niveau visuel, cela n'a qu'assez peu vieilli ; le beau s'y mélange à l'étrange. L'univers devient une esquisse de la vie, il devient l'énigme qu'il a toujours été : les nébuleuses deviennent elles-mêmes métaphysiques, elles sont à l'image du vivant, du minuscule comme de l'immensité, de l'impensable ; et pourtant c'est là sous nos yeux, on croirait voir l'intérieur d'un corps humain, les premiers moments de la naissance d'une vie. Une expérience visuelle et sensorielle totale.