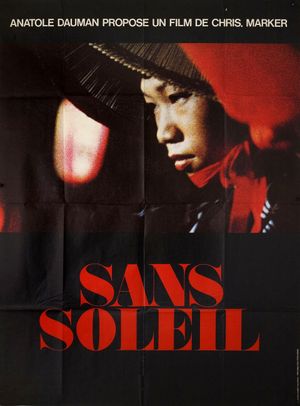Sans soleil est un objet visuel étonnant, aussi simple que complexe, une grande toile où des pistes semblent lancées dans tous les sens, des réflexions, des ponts multiples entre thématiques, lieux et époques... mais où tout semble tourner en cercle concentrique autour d'un message central. C'est une belle énigme, fascinante, qui met très vite le spectateur dans une position instable et peu commune : une voix-off qui fait penser à un roman commente des images réelles, nous plonge dans une sorte de fiction-documentaire ou documentaire-fiction dont le propos est d'une profondeur rare, d'une emprise réelle et envoûtante.
Difficile de rester passifs. Nous voilà happés, tissant du sens pour garder prise et ne pas se noyer dans ce flot jaillissant, s'accrochant aux bribes de sens, prenant ce qu'il y a à prendre pour avancer... Est-ce dire que c'est une œuvre incompréhensible et chaotique? Non, au contraire, c'est un plaisir réel : on se prête à l'exercice parce que le message subjugue et que le chemin à parcourir semble atterrir quelque part. Tout au moins faudrait-il avouer que c'est une œuvre exigeante, surtout parce qu'elle demande qu'on s'y laisse entrainer comme sur une houle. Sorte de miracle si on la regarde ainsi : rien n'est poussif, on s'y prête avec un bonheur naïf, comme un de ces enfants islandais. Voilà qui semble contradictoire : que peut bien être cette œuvre où il faudrait être à la fois attentif et exigeant, être actif et "tisser du sens", et en même temps se laisser finalement porter comme une houle, simplement, sans heurt?
Cela tient peut-être à la dualité intrinsèque de cet objet filmique, qui joue sur le passif et l'actif, le passé et le présent, le virtuel et le réel, la complexité et la simplicité. La première citation opaque nous donne d'emblée le ton : "L'éloignement des pays répare en quelque sorte la trop grande proximité des temps". Humeur dubitative... Après visionnage, quelques pistes, pourtant, s'éclairent : qu'est ce que "la trop grande proximité des temps", sinon des couches de culture qui s'entremêlent trop vite dans la mémoire des hommes?
Car, nous dit Marker, l'histoire humaine est un torrent : un torrent d'hommes, un torrent de faits, un torrent de cultures, un torrent d'histoire, mais dont l'eau n'est autre que du temps. Aussi ce flot de savoir et d'histoire pris en charge dans la trame du temps n'est, intrinsèquement, qu'un flot d'oubli en puissance. Y répondre, semble dire Marker, ce serait peut-être en y mettant des images, en les faisant parler. La culture humaine est une culture de vie et de mort, d'apparition comme d'effacement. Vite né, vite oublié. Le temps est un gouffre à travers lequel nous avons le devoir de prélever des images pour qu'elle luisent un peu plus longtemps. Mais pourquoi diable cet élan?
La réponse semble tissée dans le matériau même du film, c'est une sorte philanthropie faisant corps avec un art : Marker regarde les hommes avant tout parce qu'il sait que son art sait faire parler ceux qui n'ont pas de voix. Les corps entremêlés se mettent à parler, les dormeurs, dans les bus, disent leurs errances. Comme le flot d'image à la télévision doit pouvoir parler lui aussi, dire quelque chose, les femmes sur les marchés se risquent à nous jeter un regard, à nous dire qu'elle ont une voix. On comprend pourquoi la culture japonaise, à laquelle l'auteur rend un hommage appuyé, se prête bien à ce petit jeu : peuple du mouvement et de l'immobilité, il oscille toujours entre minimalisme (la prière, par exemple, et les quelques images d'une tribu vouée à disparaitre) et excès (fureur de la télévision, de la foule, des images, fureur des jeux vidéos, des bruits...) et permet à Marker de chercher à donner un visage et une voix à ce qui semble s'évaporer dans le temps.