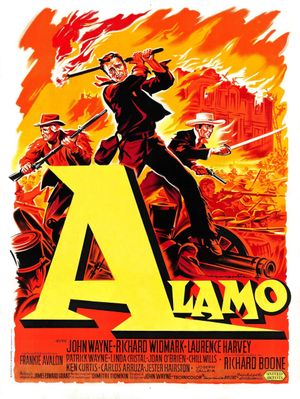L’originalité qu’offre The Alamo dans le paysage du western américain réside dans son mélange des registres, alliant le tragique inhérent au sacrifice de ces quelque deux cents hommes au comique résultat de la vie en communauté de lascars au caractère tout à la fois distinct et bien trempé. John Wayne pousse le burlesque plus loin que ne le faisait John Ford, quoique ce dernier n’hésitât pas à y recourir allégrement – pensons au sublime She Wore a Yellow Ribbon (1950) – comme vecteur d’adhésion du public au spectacle patriotique représenté.
Dans le film qui nous intéresse, le burlesque repose sur une série de situations farfelues qui prolongent en souterrain la thèse défendue : soit traiter de la foi en la république, modèle d’intégration et de préservation des libertés, tant par le dialogue (la longue tirade de Davy Crockett dans la Cantina : « La République… j’aime le son de ce mot » etc.) que par un ensemble de ressorts comiques dignes de la commedia dell’arte : la protection de la femme et de l’enfant mute en rivalité entre deux hommes avec entrées et sorties de la chambre, coups à la porte répétés encore et encore, confrontation de caractères opposant deux rapports à l’union et au mariage ; de la même façon, la querelle idéologique entre William Travis et Davy Crockett passe par un décalage, l’échange verbal prenant place dans un lieu marqué par des bagarres d’ivrognes au grand cœur.
La soûlerie généralisée se transforme en garantie de dévouement à la cause républicaine, au contraire de la rigueur sectaire d’un Travis bureaucrate incapable de communiquer avec son environnement ; ainsi, Wayne construit un héroïsme tranquille et populaire, loin de la grandiloquence des mythes propres sur eux. Les deux premières heures, scandées par quelques affrontements, visent donc à brosser le portrait de personnages hauts en couleur auxquels s’attacher une fois l’assaut donné. Derrière la caméra, John Wayne témoigne d’une foi placée en l’acteur : il offre à ses comédiens un espace de jeu fort appréciable et sait les diriger. Il signe ainsi une œuvre foisonnante et vibrante d’humanité, portée par le souffle musical majestueux de Dimitri Tiomkin.