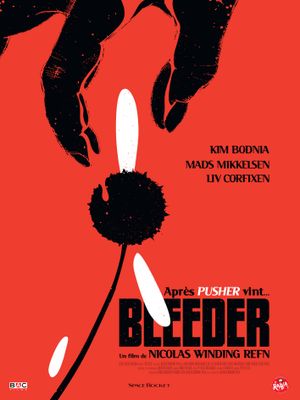Dans les rues étouffantes de Copenhague, où chaque ruelle semble se rétrécir comme un piège mécanique, Bleeder déploie une fresque suffocante de vies invisibles, condamnées à s'entrecroiser sans jamais s'atteindre. Refn peint ici un univers où les personnages, englués dans leur propre inertie, se débattent comme des insectes sous un verre – chacun reclus dans une prison qu'il a lui-même forgée, en gestes répétitifs et en silences lourds.
Léo, ce protagoniste que l’on ne peut vraiment nommer héros, traîne son existence comme un poids dont il ne connaît ni l’origine ni la fin. Tout en lui évoque l’angoisse de la mutation : ses pensées se tordent, ses impulsions le consument, et le monde autour de lui devient étrangement abstrait, hostile. La violence qui éclate de lui n’est ni cathartique, ni explicable. Elle est une force brute, aveugle, comme si son corps, dépouillé de sa volonté propre, était devenu l'instrument d’une loi obscure et immuable.
La lumière crue de la ville, éparse et indifférente, n’éclaire rien ; elle souligne l’inanité des vies cloisonnées dans des appartements étriqués, des vidéoclubs désertés, des rêves mutilés. Chez Nicolas Winding Refn, chaque dialogue résonne comme un coup porté à la communication elle-même. Les mots échappés semblent mourir dans l’air, ne laissant qu’un écho sourd, un vide plus grand encore que leur absence.
Mais c’est peut-être Lenny, l’ami timide, fasciné par le cinéma, qui incarne la véritable tragédie kafkaïenne. Sa passion pour les films, ces récits qui promettent une évasion, se révèle être un autre labyrinthe, une autre forme d'enfermement. Sa collection de VHS n’est pas une fenêtre sur d’autres mondes, mais un mausolée d’images mortes, figées, incapables de le libérer de sa solitude.
Le film lui-même, à travers sa mise en scène fragmentée, implacable, évoque une lettre sans réponse, une quête sans issue. La caméra de Refn, tel un observateur impassible, traque ses personnages comme un juge silencieux, refusant toute échappatoire. L'éclatement soudain de la violence, lorsqu’il surgit, ne sert qu’à révéler le caractère absurde de leur lutte contre une destinée qu’ils ne peuvent ni comprendre, ni défier.
Bleeder est une œuvre qui ne cherche pas à apaiser son spectateur, mais à lui imposer le poids insupportable de l'existence. À travers ce film, on ne sort pas indemne : on en ressort alourdi, avec l’impression que, comme Léo, nous portons tous en nous une tache invisible, un fardeau irrémédiable, et qu’en dernière instance, le monde n’a pas plus de sens que ce couloir interminable où il s’achève.
C’est là que réside le véritable vertige : Bleeder ne parle pas de rédemption. Il parle de ce moment terrifiant où l'on comprend que l’on n’en cherchera peut-être jamais.