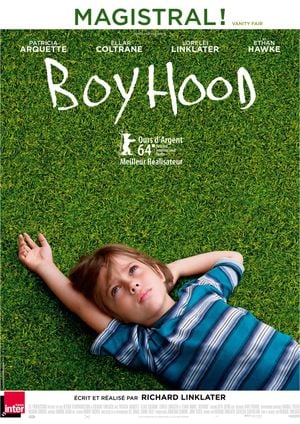Retenir l’option de tourner un film sur une période de 12 années surprend et lui donne une certaine particularité à la mise en scène, ce n’est toutefois pas très innovant. Cela contribue par contre au plaisir qui nous accapare en découvrant ces anodins séquençages de vie, tenant presque du poncif. Le personnage de Mason, évolue sous nos yeux du stade de gamin à celui de l’adulte de manière saisissante, lui conférant authenticité et empathie. C’est là que réside l’intérêt profond du film et justifie cet anecdotique artifice de mise en scène. La vision de Richard Linklater , à travers le prisme du réel, provoque une lecture en tryptique, une sorte de split screen qui s’instaure dans l’esprit, où l’on cherche à connaitre d’abord la suite d’un récit qui se veut classique (noyau familial type américain) où l’on se remémore en les voyant vieillir, le parcours de vie des acteurs (Arquette et Hawke et ce qu’ont vécu les gamins entre chaque prise annuelle) et l’on s’interroge sur soi-même, en replaçant sa propre vie au gré de cette chronologie marquée de chansons, d’objets ou d’actualités spécifiques. On égrène le temps passé. D’où cette puissance émotive des scènes qui fait que les 2h45 passent aussi vite que sur un format standard de 1h30. Boy Hood est une œuvre irradiante d’humanité, au style épuré que l’on rencontre chez les grands maîtres du cinéma indépendant américain (Van Sant, Payne, Nichols…). C’est un film d’exception, au contenu qui n’a rien d’exceptionnel mais dont le contenant nous parle par son universalité, son réalisme et sa beauté formelle.