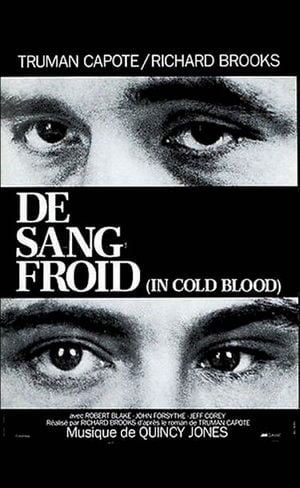Si Richard Brooks a débuté comme scénariste et a su retoucher avec habileté le roman éponyme de Truman Capote (j'y reviendrai), c’est par son art du montage que le film brille avant tout. On pense souvent que le cinéma est avant tout inspiré du théâtre ou de la littérature (raconter une histoire, Hawks, Ford), voire de la peinture (les cadres, les couleurs, Rohmer). Brooks nous prouve que la théorie de Michael Haneke a du vrai : un film est comme une partition - le sens du rythme, du montage donc est comme la pulsation, le coeur du film, sa musique propre. Plan séquence dans la maison vide, coupes nerveuses quand l'enquête s'accélère, transitions osées aussi, souvent jouées sur le son ou des repères visuels comme le faisait Lang du temps de sa superbe (M en particulier). La splendide photo noir et blanc ne gâche rien à vrai dire. On pense film noir et on a raison.
Et puis le film bénéficie forcément un peu de sa caution "faits réels" (le casting est parfait, il paraît d´ailleurs que les acteurs sont physiquement très ressemblants...). Mais ce qu'il perd dans l´adaptation du magnifique roman c´est la relation ambigüe qui se noue entre Capote et Perry dans la dernière partie du livre. Ici le parti pris est de ne pas faire apparaître l'auteur et de regarder tout d´un oeil extérieur. Dommage. En revanche le scénario j'y reviens, j´ai promis, est osé dans le sens où on nous sert deux fois l'assassinat de la famille. Une première fois en passant grâce à une ellipse au lendemain matin, maison vide, tension maximum. Une deuxième, bien plus tard, plus direct cette fois où l'on voit enfin les faits et où l´on comprend qui a fait quoi. C´est pas l´invention du siècle, guère qu´un petit flashback des familles mais Brooks tient le spectateur par cet artifice. Finalement donc, jolie surprise pour un film pas si conventionnel qu'il en a l´air et qui travaille avec des vrais outils de cinéma là où filmer paresseusement le scénario aurait presque suffi.