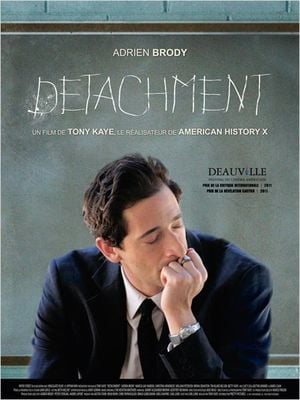Osons la comparaison pour faire couiner dans les chaumières : ce film est une pute, une pute vulgaire, laide et racoleuse, exerçant de bien médiocres prestations quand elle n’est pas à nous refiler une blennorragie dans le meilleur des cas. Detachment (à ne pas confondre avec détachant, détartrant, déprimant ou défécation) n’est même pas mauvais, c’est pire : il est détestable et lamentable (comme cette critique, vous êtes prévenus). Ça dégorge de clichés et de poncifs comme un caniveau refluant de la fange, c’est d’une atroce lourdeur et d’un pathétique si brillant que ça en devient inversement exceptionnel.
Un exemple parmi tant d’autres : sur 1h40 de film, dix minutes à peine ne sont pas accompagnées d’une musique proprement dégoulinante où un piano sirupeux vient surligner le moindre regard, la moindre phrase et le moindre élan, prenant au piège le spectateur d’une émotion factice, vile et rampante, spectateur qui, du coup, a l’impression qu’on lui vomit constamment en plein dans la gueule. Le must reste quand même cette scène affligeante où Adrien Brody prend la voix de sa mère défunte (Norman, c’est toi là-bas dans le noir ?) pour rassurer son grand-père en train de mourir sur son lit d’hôpital avec, évidemment, une petite mélodie sucrée au piano en fond sonore ; un véritable supplice cinématographique qui donne envie de ne plus J-A-M-A-I-S aimer le septième art et de se lancer éventuellement dans la proctologie.
Que vous sachiez deux choses : Henry se débarrasse d’Erica, la jeune paumée qu’il a recueilli chez lui, en appelant les services sociaux, et Meredith, l’étudiante grosse, incomprise, mal dans sa peau et artiste dans l’âme, finit par se foutre en l’air (on voit le truc arriver à des kilomètres) en bouffant un mini-muffin empoisonné. Je spoile à mort la fin du film pour éviter qu’un grand nombre de personnes aille voir cette daube. Toutes les situations se vautrent avec une rare complaisance dans un pathos épais, renforcé par une mise en scène faussement arty, clinquante et finalement sans aucune originalité (format Super 8 pour exprimer les souvenirs, noir et blanc impromptu, Brody déambulant la nuit, seul avec son vague à l’âme en bandoulière : trop stylé pour être crédible).
Ce pathos fait qu’on ne croit à rien de chez rien (en plus de faire soupirer jusqu’à ce que mort s’ensuive, regarder sa montre toutes les deux minutes, s’arracher les cheveux quand il en reste et/ou un esclandre à base de biiiip, de biiiip et de biiiip), de chez rien disais-je malgré le sérieux risible, voire moralisateur, que gourou Tony Kaye (non mais t’as vu sa tête ?) cherche à donner à sa grosse merde, sauf peut-être la scène où Lucy Liu pète les plombs face à une étudiante, et celle aussi où Henry arrive pour la première fois dans la classe où il va effectuer son remplacement.
L’observation, l’analyse et la remise en question du système éducatif américain (aussi déficient que le nôtre) sont grossières, superficielles, enfonçant des portes ouvertes sans aucune pertinence ni intelligence, et plombées par des à-côtés narratifs bidons, au-delà de l’indigence. Et quand, dans le dossier de presse, Kaye balance, à propos de son pensum bouffi et prétentieux, "J’essaie seulement de faire en sorte que les choses aient l’air vraies… Je cherche à saisir des émotions réelles, je déteste le fait de jouer, je déteste les choses qui n’ont pas l’air authentiques", on se prend soudain à rêver de tenailles, de plumes et de goudron brûlant.
Cet utilisateur l'a également ajouté à sa liste Flop 2012