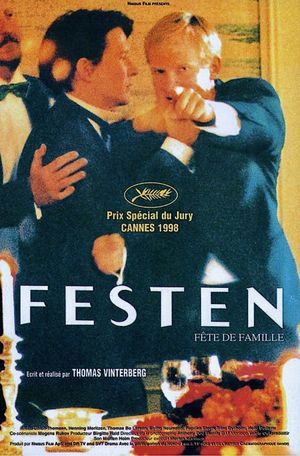Avec Festen, le danois Vinterberg frappe très fort. Jouant avec des symboliques bibliques, par trois tapotages de verre, le fils Christian renie trois fois son père. Puisant dans un pathos insoupçonné au début, le film devient comme un Truman Show, où seul Christian a l’air d’être au courant des atrocités de son père. Ou plutôt, est le seul à ne pas faire comme si rien ne s’était passé. On dirait presque l’aristocratie Hanekienne, de Happy End notamment, fière et pédante, capable de passer outre des scandales pour ne pas entacher sa réputation. C’est l’œuf doré rempli de moisissure putride.
Mais l’aristocratie a ses limites. Vinterberg nous montre aussi les méfaits de l’alcool, entre le vieil oncle qui tombe de sa chaise, les visions d’horreurs de porcins Rabelaisiens se gavant de venaison et de vin rouge à s’en tâcher la chemise, ou l’atroce chant raciste entonné par cette triste communauté. Et avec l’alcool, le chaos s’affirme, tout le film finit par baigner dans une atmosphère surréaliste qui m’a rappelé L’Ange Exterminateur de Buñuel, ou Climax de Noé. Et qui soutient Christian dans sa quête de vérité ? L’aide. Les domestiques, les valets qui se font peloter, gifler, ignorer, insulter, jeter des verres dessus par la famille Klingenfeldt. On passe le film à soutenir en pensée Christian, que l’on sent enclavé dans une alerte émotionnelle constante, incapable de parler pendant un moment, au bord des larmes. Et seuls les domestiques ont l’air de ne pas jouer au petit jeu du secret de polichinelle, réservé à la haute. Comme The Square d’Östlund, avec la scène de la performance, le film joue avec les réactions des convives, qui semblent ignorer allègrement une réalité qui pourtant s’impose à eux. L'artiste est un gorille. Le père est un violeur. L’homme est un animal. Et finalement, le sceau est brisé, la vérité éclate. C'est comme si la lettre de la défunte soeur jouait le rôle d'un déclencheur, offrant à la fratrie de Christian l'accès à des souvenirs-écrans Freudiens des atrocités commises par le père, refoulés par pur souci de protection de psyché. Et jusqu’à la fin le doute subsiste, seul le discours du père nous affirme que la famille est au courant des horreurs commises par le patriarche. Et jusqu’au générique de fin, le brouhaha du small talk ignare étouffe le drame familial.
Le Dogme 95. Créé, entres autres, par Von Trier, et ensuite copieusement renié par ses soins, que ce soit avec les ralentis apocalyptiques de Melancholia sur fond de Wagner, ou les éclairages oniriques d’Antichrist, il est ici pleinement exploité (ou presque, car tourné en vidéo et non en 35mm) par Vinterberg. Il use de ralentis techniquement simplets pour créer une ambiance surréaliste, ou ose des plans fantasques, un zoom à la Kubrick, à 90°, sur un visage alité, des plans rapprochés, un travelling en fisheye, ou encore des prises de vues à l’épaule donnant un côté documentaire Nouvelle Vague à l’ensemble. Mais tout cela garde une cohérence émotionnelle, tantôt plongeant le spectateur dans l’action, tantôt le plaçant sur le banc, en simple observateur de cette montée en enfer.
Festen est comme une mise en abîme d’un théâtre pervers, un cauchemar remettant en cause notre perception de la réalité, un tour de force iconoclaste brisant les névroses d'une famille qui n'en a que le titre.