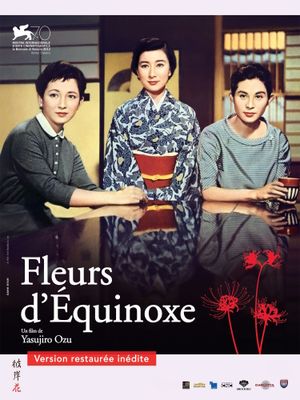La couleur fait son apparition dans le cinéma d'Ozu et dans ses cadrages géométriques bien identifiables. Le cinéaste réussit de belles compositions visuelles tout en restant fidèle à ses plans fixes -pour l'essentiel des intérieurs- avec la caméra au sol, comme pour mieux filmer les conversations agenouillées, ainsi que c'est l'usage dans les maisons japonaises; sa façon de filmer, caméra à terre, les couloirs et allées en enfilade fait aussi partie du style formel qui n'appartient qu'à Ozu.
Observant les mutations du Japon de l'après-guerre (on ne sait pas si la propension des hommes japonais à boire de la bière dans le film est une des mutations importées de l'Occident), Ozu aborde dans ce film la question du mariage arrangé (par les parents), tradition, si l'on en croit le cinéaste, que refusent désormais les jeunes japonaises, en l'occurrence trois d'entre elles dans le sujet de comédie qui illustre le sujet. Ou comment faire changer d'avis un père réfractaire au choix de sa fille. Avec une certaine ironie, Ozu fait jouer à Monsieur Hirayama, mandaté par des parents amis, le rôle de conciliateur auprès de deux jeunes filles avec lesquelles il montre une compréhension qu'il n'a pas avec sa propre fille. Sans éclats (de voix), Ozu remet en cause le modèle patriarcal ancestral. Au-delà, il nous fait entrer une fois de plus dans la mystérieuse culture japonaise des années 50 et ses rituels. Le sujet, qui peut paraitre anodin aujourd'hui, n'en prend que plus d'intérêt.