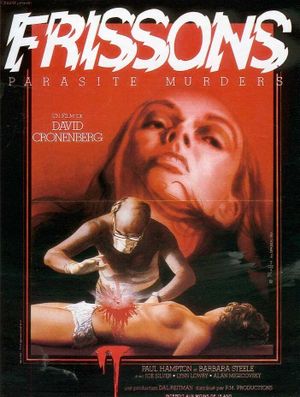Dès les premières images, on est avec ce bourgeon balbutiant dans la définition de ce que sera définitivement le cinéma de Cronenberg. Sang, barbaque, bistouri barbouillé et atmosphère orga-nique dans une mise en scène glaciale et chirurgicale.
Les plans se succèdent et placent dans une suite de notes sourdes et sobres des personnages désincarnés, pantins errants sortant d'une toile de Hopper, élançant leurs silhouettes dans les architectures épurées d'un Mondrian, le tout retouché par le pinceau orgiaque de Lucian Freud.
Ces décors polaires et ces ombres sans présence qui feront la substance de la montagne de bidoche que s'apprête gentiment à sublimer le canadien, trimbalent leurs carcasses dans ce tableau évidé, reflet inquiétant d'un Munch et trace osseuse d'un Klimt, les chairs du Caravage croisant les formes flottantes du cubisme, structure angoissante d'une mer encore bien trop calme.
Et puis sur sa toile, le moment venu, le furieux éructe sa bile suintante, dégouline ses viscères, bave son glaire pourpre. Les viandes trouvent leurs tourments, les boyaux dansent, les orbites se veinent d'écarlate. La précision expérimentale laisse la place au délire grouillant, la froideur immaculée au moucheté de sang.
Dans l'emportement, Klimt, Freud ou Kandinsky croisent Pollock, Bacon ou Pei-Ming et la tornade à peine enfantée s'évade pour gerber. L'écran se balafre, les erres s'entrelacent.
Dans une définition brutalement crue, délicieusement grossière et violente de ce qui suivra, Crocro livre une autopsie de ses obsessions : une nuit des porcs vivants, finement tracée de pinceau de maître et salement tailladée d'un hachoir difficile à repaître.