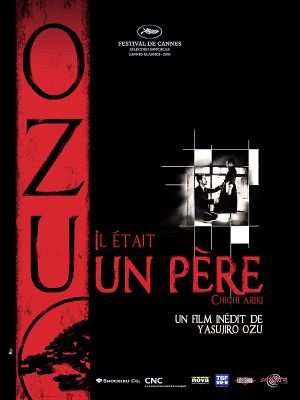Son titre l’érige fièrement, c’est la figure de père qui intéresse Ozu, ici. Au point que les femmes seront quasi absentes du récit, fantômes (épouse et mère) parmi les fantômes (le père du père, l’écolier) reléguées dans une confession, un souvenir ou in-extrémis dans la promesse d’un relais. Cette épure de l’entourage s’en ressent aussi au sein de l’histoire de cet homme et son fils, comme si Ozu avait uniquement procédé par soustraction, ôtant oripeaux et ornements pour ne garder que l’essentiel. L’os.
Enseignant dans une ville de province, le père se sent responsable de la mort accidentelle d’un élève lors d’une sortie scolaire. Il ne le supporte pas et démissionne. Dès lors il choisit de retourner dans sa ville natale mais confronté au manque d’argent et souhaitant les meilleures études pour son garçon, il part pour Tokyo, place son fils dans un internat et s’éloigne donc géographiquement de lui. Irrémédiablement, puisqu’ils ne se reverront que lors de brèves retrouvailles. Ici dans un week-end au hammam, là lors d’une partie de pêche qui fait écho à celle qui scellait leur séparation à venir, avec ces mouvements de canne à pêches parfaitement symétriques qui soudain, dès l’annonce brutale, se dissociaient.
Maniant l’ellipse à merveille, au moyen de séquences se répondant en écho, objets réapparaissant autrement, Ozu brosse une délicate relation entre un père et son fils et en particulier l’histoire d’une absence et du rêve ultime d’un fils exaucé au seuil de la mort d’un père. C’est magnifique. Et quelque part, pas si éloigné de trois films qui me tiennent à cœur à savoir ceux formant la trilogie d’Apu, de Satyajit Ray. Il y a là aussi cette idée de transmission et d’ambitions qui convergent. Et là aussi le film se ferme sur un départ, sur un train, qui à l’instar de la pêche joue un rôle majeur, asymétrique et cyclique.