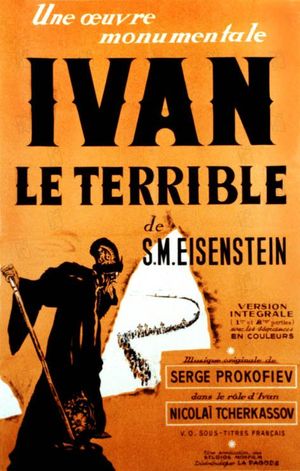Si terrible que ça, Ivan ?
On pense évidemment au Macbeth d’Orson Welles, tourné à la même période, tant l’éclairage expressionniste, le sur jeu constant des comédiens et la trame Shakespearienne faite de complots en tout genre font des deux œuvres des miroirs inversés.
La critique du stalinisme n’est pas encore explicite, et pourtant l’univers quasi horrifique que dresse Eisenstein aurait dû mettre plus tôt la puce à l’oreille au dirigeant russe. Alors même qu’il est constamment victime des coups du sort, tentative d’assassinat, meurtre de sa femme, maladie, Ivan demeure tout du long le personnage le plus inquiétant. Sa puissance, caractérisée par son ombre envahissant les murs de son château troglodytique (encore un point commun avec le film de Welles) associé à son regard de vautour et son allure générale de vieux sorcier, ne permettent jamais de le prendre totalement en pitié.
Malgré ces qualités esthétiques indéniables, ce sens de la dramaturgie ténu, le film peine à convaincre pleinement. Le huis clos paranoïaque en devient poussif par ses partis pris mêmes, le jeu continuellement outré des acteurs devenant à plus d’une reprise à la limite du ridicule. Le rythme est également bien moins soutenu que dans la période muette du cinéaste ; Le travail sur le son n’est pas assez poussé pour que les silences et les dialogues puissent réellement concurrencer les moments purement opératiques qu’avaient pu offrir l’alliance mise en scène-musique de ses précédents films, Que viva mexico ou Le cuirassé Potemkine en tête.
Pour autant, on ne peut pas en vouloir au cinéaste de n’avoir jamais cherché à glorifier les actions du chef d'État comme il aurait pu le faire avec le peuple dans ses précédentes œuvres : ce n’est pas ici la lutte d’un peuple comme un système mais celle d’un homme contre son propre système, qui le ronge de l’intérieur et finira par le condamner à la folie.