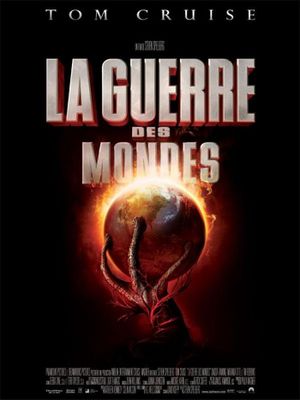En 1898, le socialiste H.G. Wells avait voulu que son roman résonne comme un avertissement à l’Empire Britannique ; quinze ans plus tard, le monde entier basculait dans la guerre et lui apportait un écho douloureusement prémonitoire. En 1938, terrorisant les populations avec son adaptation radiophonique, le jeune prodige Orson Welles ne pensait pas seulement au présage glorieux incrusté dans son homonymie avec l’écrivain ; sans doute avait-il aussi et d’abord en tête le danger nazi. En 1953, lorsqu’il portait cette même histoire à l’écran, Byron Haskin filait évidemment la métaphore du péril communiste. Livre, émission, film, La Guerre des Mondes apparaît toujours en période de crise grave. Tout cela est bien connu et Steven Spielberg en a retenu l’exemple, qui entend venir à la fois avant et après, prévenir autant que guérir. Artiste maniaco-dépressif, il passe de l’euphorie à l’anxiété la plus profonde, de l’optimisme proactif (Le Terminal) au funeste pressentiment que la fin des temps est proche. Pour lui, l’époque est révolue où tout ce qui venait du ciel manifestait de bienveillantes intentions à l’égard de l’espèce humaine. De nouveaux ennemis ont formé leurs bataillons à l’assaut de la citadelle Amérique. Le film emprunte à son modèle littéraire un certain nombre de données, de la structure à trois pieds des engins annihilateurs au dénouement voulant que ce soit l’ordre naturel, et non le sort des armes, qui décide de l’issue du conflit. Prologue et épilogue affirment ainsi une confiance en les voies impénétrables de la transcendance et du déterminisme mêlés. Lorsqu’ils interprètent comme de la bigoterie une phrase (pourtant reprise ipsis verbis du roman) louant la sagesse de Dieu, les détracteurs ne perçoivent pas la distance que ce texte prend avec l’intrigue, replacée dans une perspective cosmique. Ils s’empêchent par-là même de jauger la singularité de cette œuvre visionnaire et tourmentée, qui marque pour son auteur l’apogée d’une expression inquiète, viscérale, simultanément hantée par la barbarie de notre histoire et nourrie aux miasmes les plus contemporains d’un présent brouillé.
https://www.zupimages.net/up/23/39/4bie.jpg
Si La Guerre des Mondes est un grand film, sa première heure est, pour le dire simplement, monumentale, époustouflante. Ray Ferrier, docker divorcé, récupère sans entrain ses deux enfants, Robbie et Rachel, que son ex-femme lui confie le temps d’un week-end. Tandis que l’aîné se réjouit mollement d’une rédaction à finir pour lundi (portant sur l’occupation française en Algérie) et que la cadette, étonnamment précoce, explique à son père le principe d’un phénomène biologique (le rejet d’un corps étranger par le système immunitaire), le ciel se couvre, la menace gronde, un étrange orage fait zébrer d’impressionnants arcs électriques avant de lâcher des éclairs si effrayants qu’ils poussent instinctivement à se réfugier sous la table. Quelques instants plus tard, le cataclysme surgit, non pas des airs mais des entrailles de la terre. Séquence proprement hallucinante que cette auto-extraction d’un gigantesque insecte d’acier au beau milieu d’une ville du New Jersey, que cette apparition mécanique se dressant lentement dans un nuage de poussière et de fumée, devant des spectateurs médusés, abasourdis, pétrifiés par la terreur et la fascination. À peine frémissent-ils lorsque la chose laisse échapper un "cri" tétanisant, quelque part entre la corne de brume et la sirène de paquebot. Il faut attendre le foudroiement des premiers rayons pour que la panique s’empare de la foule. Hommes et femmes sont instantanément vaporisés, les bâtiments transformés en ruines calcinées. Seul recours possible : la fuite, sans jamais avoir l’idée de se retourner. Lorsque Ray, les yeux dans le vague, hagard comme un zombie, revient à la maison, il a vieilli de dix ans. Son regard donne à penser qu’il a soudain pris conscience d’une sorte de rupture dans l’ordre du monde. Il lui faut un moment pour intégrer ce qu’il a vu, pour digérer une expérience qui dépasse l’entendement.
La dynamique est donc simple : les aliens attaquent, les terriens détalent. Toute résistance est inutile tant la supériorité extraterrestre est écrasante, tant le conflit relève plutôt de l’anéantissement, du génocide. Ray n’est pas un Schindler qui protégerait l’humanité de l’extermination : son devoir est de déguerpir en protégeant sa fille, préservée au point qu’elle ne doit rien apercevoir de ces atrocités. Les évènements du 11 septembre sont bien sûr inauguraux. Pour la stupeur des témoins qui contemplent en l’air une tornade sans y croire, pour la fine pellicule grise qui, comme à Manhattan, se dépose sur le visage hébété du protagoniste, pour les décombres d’un avion de ligne écrasé dans un jardin, pour l’évaporation littérale de victimes réduites à des vêtements voltigeant au vent. L’état de paranoïa intégrale dont furent saisis les USA annule toute possibilité de réaction et révèle moins la peur d’une menace terroriste que celle, plus sourde encore, de l’impuissance. Regards aimantés vers le haut, caméra tombée à terre qui continue de filmer le désastre, murs tapissés d’avis de recherche : le traumatisme des tours jumelles est partout. Et devant ces images d’exode, ces humains parqués dans les nacelles comme du bétail, ce train en flammes qui fuse à travers une plaine dans la nuit, réminiscence du passé le plus brûlant sous une pluie de neige et d’étincelles, c’est toute la mémoire des catastrophes du XXème et du début du XXIème siècle qui est sollicitée. La destruction des hommes par le feu convoque les fantômes de l’Holocauste et d’Hiroshima, déborde le discours d’actualité. Davantage qu’à la science-fiction hollywoodienne classique, avec ses dispositifs conventionnels et ses accès d’héroïsme, cette errance crépusculaire et presque nihiliste au sein d’une guerre dont on ne distingue que les fragments terribles renvoie à La Honte de Bergman.
https://www.zupimages.net/up/23/39/2ls6.jpg
Avec La Guerre des Mondes, Spielberg invente le film-catastrophe intimiste : famille et chaos, chaos de la famille. Obsédé par sa promesse, Ray la tient au prix d’actes limites où la contrainte face à l’adversité le dispute à l’égoïsme, et ne reçoit en retour que des sourires distants et contrits. Ce périple grisâtre, peu porté sur l’emphase pyrotechnique (malgré des effets visuels d’une beauté inouïe), interroge la place de l’homme dans l’univers, tiraillé entre la nécessité du collectif et l’instinct de survie individuel. L’approche est tout sauf épique, il n’y a plus de hauteur de vue possible. On ne saura jamais ce qu’il y a de l’autre côté de la colline. Si les attaques sont si saisissantes, c’est précisément parce que la mise en scène refuse toute balance des points de vue pour ne les restituer que dans la rétine des assiégés. Ce récit est à la première personne, mené avec des œillères et du bouche-à-oreille, sans un gramme de graisse. Par sa recherche de compression, il se refuse constamment à l’amplitude et à la démesure qu’appelle son sujet. Tout ce qui ne figure pas dans le champ de vision des personnages n’est pas représenté. Ou alors c’est insoutenable, comme lorsque Rachel se dérobe un instant à la vue de Ray et tombe sur une rivière qui charrie des tombereaux de cadavres. L’élimination d’Ogilvie porte cette logique jusqu’au point de non-retour : recourir à l’imagination plutôt qu’à la monstration, c’est surtout éviter à la fillette d’affronter l’inimaginable, l’accompagner dans sa cécité et sa surdité forcées pour en éprouver le caractère tragiquement dérisoire. Elle a besoin de croire plutôt que de voir pour se rassurer de ses crises d’angoisse, mais il y a fort à parier que, cette fois-ci, elle n’est plus dupe. Robbie, au contraire, décide d’échapper à cette protection du regard : avec son attitude cocardière, il a envie d’en découdre, il veut combattre. En lui résonne l’écho de ces va-t-en-guerre bushistes qui envoyaient les enfants de l’Amérique au casse-pipe irakien, sans que les pères ne puissent rien faire pour les retenir. À peine a-t-il disparu derrière la colline, justement, qu’elle s’embrase. Se soustraire du cadre, c’est mourir.
Le cinéaste sait que la frontalité des allégories a toujours servi l’intelligence de son art. Le politique ne transite chez lui que par l’œil, surpuissante machine à ingurgiter le monde. Le motif récurrent du trou percé au milieu de la vitre donne à cette obsession une forme littérale et renouvelée, tandis que le nombre de reflets et de miroirs déplace une question familière vers des enjeux inédits. Le style formel accentue les textures, les flares, les effets de trame, de réverbération, de flou. Rencontres du Troisième Type et E.T. exaltaient l’émerveillement des lumières irradiant la nuit. Cet éclat aveuglant n’est plus ici qu’émanation de cauchemar. Les lueurs blanches des tripodes transpercent comme des projecteurs de miradors, leurs faisceaux désintégrants labourent le sol tandis que s’élève la rumeur épouvantée des massacres. Sidérantes visions d’apocalypse, à la fois éthérées et très concrètes. Le son est à lui seul un paysage organique, travaillé de grondements, de chuintements, de grincements venus d’ailleurs qui témoignent de cet inexorable programme de mort. Suspendue, la musique de John Williams se prive pratiquement de mélodie, consent un fragment élégiaque malade, alterne rythmes agressifs, cellules minimales et plages bruitistes. Quant à l’émulsion délavée et charbonneuse de la photographie, elle fait apparaître l’image même des hommes à l’écran plus ténue que jamais. "On est encore vivants ?" murmure Rachel dans l’obscurité. Cette perception presque incorporelle est comme une intuition de passage, de l’au-delà, découverte au milieu du tumulte. Dans cette traversée du désastre qui rappelle la fragilité de nos existences, tout est ramené à l’essentiel : courir, se terrer, fermer les yeux pour se prémunir de l’insupportable. La palette chromatique culmine avec les pourpres d’une forêt de conte qui se convertit à l’horreur. Un paysage rougeoie à perte de vue du sang des hommes vidé, aspiré par les machines. Des racines monstrueuses étouffent la terre, des squelettes d’arbres noirs se découpent sur des horizons écarlates et dévastés. Que le film s’achève avec de fausses retrouvailles heureuses, consacrant en bout de course une logique familialiste, relève d’un ultime trompe-l’œil. Après avoir ramené ses enfants au bercail, Ray reste sur le seuil de la porte, comme Edwards à la fin de La Prisonnière du Désert. Ne lui reste plus qu’à pleurer la perte de son innocence, loin de cette catharsis où les images s’évaporent pour laisser la conscience au repos.
https://www.zupimages.net/up/23/39/c52h.jpg