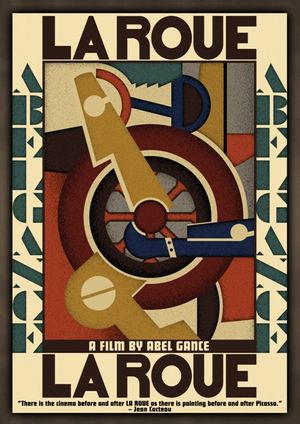La découverte de La Roue, projet monumental de plus de 7 heures réalisé par Abel Gance en 1923, a tout d’un événement dans l’univers des cinéphiles. Fruit d’un long et minutieux travail de reconstruction pour rétablir le montage original d’un film qui comporta de nombreuses versions, oscillant entre huit heures et 1h30, d’une superbe restauration de l’image, c’est un accès privilégié à une œuvre majeure mutilée et éparpillée de par le monde entre ses négatifs originaux et ses copies conservées dans des états parfois désastreux ; c’est la découverte d’un élément charnière de l’histoire du cinéma, qui témoigne d’une période d’audace sans mesure, où l’ambition le disputait à l’inventivité la plus folle.
Après sa déjà imposante diatribe de 3 heures contre la guerre (J’accuse, en 1919), Abel Gance s’essaie à la tragédie. Sur une base qui exploitera toutes les composantes du mélo, il imagine une romance coupable, un nœud familial aux colorations incestueuses, à la faveur d’une adoption cachée, qui voit le père et le fils tomber amoureux de celle qui doit rester pour eux une fille ou une sœur. Bien entendu, on retrouvera le jeu propre au cinéma muet, dans la gestuelle expressionniste ou les faciès souvent exorbités de personnages le plus souvent en proie aux passions les plus exacerbées. Mais dès le départ, les visages et la présence extraordinaire des comédiens s’impose : en tête de proue, c’est évidemment Severin-Mars qui se détache, déjà présent dans J’accuse, et qui joue parfaitement de l’alliance entre un corps massif et une sensibilité à fleur de peau, homme de contraste rivé à sa tâche et déchiré par des sentiments qu’il s’interdit. Face à lui, la jeune fille qui deviendra femme dans la douleur, et le fils rêveur, luthier et lui aussi entraîné dans la fameuse roue tragique du destin, opérant sur la durée une perte de la jeunesse, de l’insouciance et des élans spontanés vers la tendresse.
L’une des grandes originalités du récit et de situer le récit dans le monde du travail, dont l’exploration a beaucoup à voir avec le naturalisme. Gance explore le monde du rail avec un regard fasciné, dans cette bicoque encerclée par les rails, ou cohabitent une balançoire, des roses trémières et le passage incessant des wagons. Les pistons, la cadence, l’omniprésence de la machine et du métal influent considérablement sur l’esthétique du film, son montage, sa dimension proprement industrielle. Mais le récit est si vaste qu’il se permettra lui-même d’évoluer, notamment dans les deux dernières époques qui déplacent les protagonistes sur le massif du Mont Blanc, conférant une majesté toute romantique aux enjeux passionnels, sous la neige, les terrains accidentés, les falaises abruptes ou les glaciers monumentaux.
Sur ce canevas encore assez conventionnel, l’intérêt est déjà suffisant : l’émotion est présente, la durée prend en charge avec pertinence le combat entre raison et passion, les renoncements et les conséquences inéluctables du silence originel sur des destinées condamnées à subir. Mais ce qui fait de La Roue une œuvre d’exception tient à sa forme : terrain expérimental hors-norme, à une époque où presque tout est à construire, c’est un manifeste du génie d’Abel Gance, qui, avec Eisenstein et Griffith, définit ce que pourrait être le langage cinématographique. Ses audaces en termes de montage nourrissent ainsi des séquences majeures, qui montrent la course folle des machines tout autant que l’obsession mentale pour un amour ineffaçable, lequel se manifeste aussi par le recours aux superpositions, aux teintes allouées à certaines périodes heureuses, voire à la colorisation de certaines parties (la rose, le sang des blessés dans l’accident du prologue…). Il est d’ailleurs passionnant de voir le réalisateur tenter des formes qui ne lui survivront pas, comme ce recours très fréquent aux caches qui isolent une partie de l’image, encadrent des figures, des motifs et resserrent et contorsionnent le cadre, écrins stylistiques très évocateurs dans un récit où la restriction est constante.
Il ne s’agit pas pour autant de s’en tenir à un formalisme échevelé : l’équilibre entre les émotions, la narration et l’image est permanent. Gance ose quelques incursions comiques (le personnage attachant de Mâchefer), s’attarde avec tendresse sur les gueules noires, ces mécaniciens du rail, et soigne particulièrement l’écriture, résolument littéraire, de ses cartons. Quand il ne cite pas Baudelaire, Hugo ou Sophocle, il accompagne la poésie inspirée de son image, qui le rapproche clairement du réalisme poétique. Les jeux de lumières dans la vapeur ou la neige, l’importance accordée aux matières (le fer, donc, mais aussi le bois du luthier, le charbon, la pluie, les hautes herbes...) composent un monde vibrant qui rejoint la vision panthéiste de Victor Hugo, où tout vibre et tout vit. L’anthropomorphisme de certains « personnages » en atteste : la chèvre, d’abord, véritable comparse des jeux de la jeune enfant, puis le chien, compagnon du Sisif esseulé, et bien évidemment les deux locomotives, personnifications de Norma qui aimantent tout l’amour inexprimé du père, reprenant le motif exactement semblable dans La Bête Humaine de Zola.
La symbolique permet ainsi de sublimer les impasses morales de son récit : alors que la possible résolution du mélo (à savoir la révélation de la vérité et la fin d’un mariage arrangé pour des motifs financiers) est toujours à disposition, Gance opte pour une élévation plus ambitieuse. L’aveuglement de Sisif succède à celui de ses sentiments, et lui offre après une superbe montée de croix une forme de sagesse résignée par le deuil de son fils, tandis que Norma pourra retrouver sa place auprès de lui sous la forme d’un ange gardien d’abord secret, permettant une tendresse désincarnée qui redonnera ses droits à la relation filiale. La roue, motif graphique constant dans de nombreuses séquences, et explicitement présent sur chaque carton, se déplace aussi sur la ronde faite par les villageois qui célèbrent avec allégresse leur rapport à la nature, et qui convient Norma, inscrivant dans un cadre apaisé une passion néfaste qui, si elle ne peut se résoudre qu’avec la mort du protagoniste, se dilue aussi avec sérénité dans un paysage bienveillant ; Norma n’est pas gaie, explique-t-elle : « Je suis heureuse ! Ce n’est pas la même chose…C’est plus doux et plus triste ! » : une lucidité salutaire qui reflète la profondeur inépuisable de ce jalon de l’histoire cinématographique, qui ne se limite pas à ses innovations formelles.