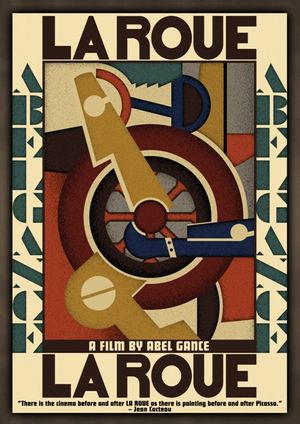Abel Gance, toutes considérations chronologiques mises de côté, pourrait constituer avec son impressionnante fresque de 7 heures La Roue une sorte de chaînon manquant, un trait d'union entre le cinéma soviétique des années 20 et 30 (pour toute sa puissance expérimentale et symbolique) et le cinéma français des années 30 (dans la veine du réalisme poétique). Sauf que l'on est ici à l'orée des années 20, et que le protagoniste n'est pas Jean Gabin dans le rôle de Jacques Lantier du côté de Zola mais Séverin-Mars dans le rôle d'un mécanicien ferroviaire nommé Sisif au cœur d'un mélodrame familial qui diffusera son venin mélancolique jusqu'à la toute dernière image.
La pellicule semble être pour Gance un incroyable terrain de jeu, notamment au cours de la première partie, au sein duquel il expérimente follement. Avec une multitude d'effets d'ouverture, de colorisations et de surimpressions variées, le portrait de Sisif qu'il brosse en l'espace de quelques dizaines de minutes ne peut laisser indifférent. Le nœud de la tragédie se formera dès les premiers instants, suite à un accident de train et à la découverte d'une jeune orpheline que Sisif élèvera comme une fille aux côtés de son propre fils. Les envolées lyriques, l'exaltation des sentiments, et les accès d’expressionnisme (qui peuvent évoquer en germes un certain cinéma allemand) font de ce premier temps un ancrage très marquant. La prestance de Séverin-Mars n'y est pas étrangère, tant l'acteur dégage quelque chose de très fort et singulier, avec son visage buriné et son regard intimidant, dans la lignée de son interprétation dans J'accuse — un film qui se livrait déjà trois ans auparavant à une série d'expérimentations graphiques renversantes. Il me semble qu'on peut difficilement nier la modernité des graphismes et de la narration chez Gance.
On le comprend très vite lorsque Sisif recueille l'orpheline : en déposant Norma dans le même lit qu'Elie, la matrice de la tragédie amoureuse est déjà annoncée. De ce point de vue, La Roue développe un tissu dense de complications passionnelles autour de la thématique de l'inceste. Les frontières entre différents types d'amours seront régulièrement franchies, et de ces antagonismes sous-jacents naîtront toute une série de tourments qui donneront au film différentes couleurs, différents rythmes, différentes atmosphères, avec chacune son propre univers cinématographique : la diversité en termes de techniques de narration et de procédés de mise en scène impressionne, et permet une alternance parfois folle entre montage accéléré très suggestif et long plans purement descriptifs. Et dans cette apparence profondément protéiforme, La Roue parvient à conserver une unité très appréciable sur la durée, bien au-delà du symbole de la roue du destin qui ne s'arrête pas de routourner en connectant les êtres du bout de ses rayons.
Des chemins de fer de Nice, la dernière époque déplace l'action vers les décors montagnards du Mont Blanc (Gance fit démolir la gare du funiculaire et déplacer des poteaux électriques), au magnifique col de Voza situé un peu en-dessous des deux mille mètres d'altitude. Si le film prend de la hauteur, Gance se garde bien de modifier la perspective très intimiste : la fin de la trajectoire se négocie dans une très belle continuité, en suivant l'évolution de chacun des trois personnages principaux, chacun souffrant d'une forme de solitude, persécuté par ses secrets ou ses sentiments. À mesure que Sisif s'enfonce dans la cécité, le mélodrame prend le pas sur la démonstration de force technique et les espaces alpins (autant que les intérieurs composés avec une incroyable minutie) confèrent à certains temps fort une ampleur émotionnelle renversante. Le temps a fait son œuvre, les couples se sont à demi faits puis totalement défaits, et les cœurs meurtris ont cicatrisé dans la neige éternelle des glaciers.
Et tout plein de vieux photogrammes sélectionnés avec soin : http://je-mattarde.com/index.php?post/La-Roue-de-Abel-Gance-1923