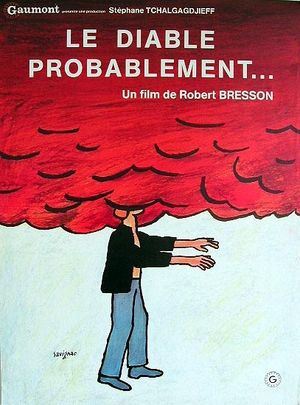Robert Bresson est décidément un cinéaste qui m'étonne ; je me souviens encore l'effet que m'avait fait le premier film que j'ai vu de lui. J'ai été décontenancé, c'est rien de le dire, en premier lieu et principalement par la direction d'acteurs. Mais passé la surprise initiale, et quelques-uns de ses long-métrages plus tard, ne reste plus qu'à mon sens ce qui fait le cœur de son cinéma : l'émotion. Son travail sur l'épure absolue, autant dans la réalisation, pour le moins minimaliste la plupart du temps (aucun artifice de mise en scène, peu de mouvements de caméra, la plupart du temps aucune musique extradiégétique), l'écriture et la direction d'acteur (aucun sentiment exprimé par le jeu, dialogues assez nombreux mais brefs et succincts), parvient, paradoxalement, en faisant ressortir aussi visiblement l'artificialité du cinéma, à capter l'émotion des séquences de manière presque brute... Une démarche déroutante, dont j'ai souvent du mal à croire qu'elle n'est pas en partie accidentelle tant elle me paraît génialement risquée (ses excellentes Notes sur le cinématographe tendent cela dit à prouver le contraire), mais qui fonctionne à la perfection, et en font sans doute possible un des plus grands...
Un cinéaste étonnant, donc, et dans le cas de ce film - le terme est galvaudé mais ici approprié : visionnaire.
En effet le premier point qui choque pendant le visionnage – qui m'a en tous cas choqué – c'est l'actualité du sujet. Bresson traite ici de la jeunesse des années 70, tiraillée entre une société de consommation qui pousse aux instincts les plus bassement matériels (le perso principal, qui dit que son seul désir est de baiser toutes les femmes qu'il pourra), et le désespoir face à la crise climatique qui en est la directe conséquence.
Bresson ne nous laisse pas le moindre espoir : dès le début, il nous annonce la mort du protagoniste, et le film en retraçant ses derniers jours nous dressent un portrait de son entourage
Sujet casse-gueule par excellence s'il en est, tant il est facile de tomber dans la facilité, soit en se laissant glisser en plein dedans, soit en se permettant des raccourcis infantilistes, peu de films peuvent se vanter de traiter avec pertinence du nihilisme (le premier exemple qui peut nous venir à l'esprit d'un film y parvenant intelligemment, ce serait bien sûr Fight Club, même si son côté complaisant, dans un premier temps, le fait souvent la cible de critiques un peu injuste) ; ici, comme toujours avec notre bon Robert, c'est sobre et pudique, c'est intelligent.
On ne subit jamais un misérabilisme outrancier, en aucun cas on ne ressent de mépris pour ces personnages pourtant parfois difficilement appréciables (ce protagoniste, espèce de bourgeois tête à claque qui irrite souvent).
Et cette fin – quelle fin ! À l'image de toute l’intelligence du film...
« J'avais cru que dans un moment aussi grave, j'aurai des pensées sublimes. Tu veux que je te dise à quoi je pense... » le dernier mot se mêlant à la détonation du flingue avec lequel on l'abat, pour une poignée de francs...
Bresson ne sur-explique rien, n'explicite rien ; tout repose dans le non-dit, dans le choix comme toujours brillant des acteurs, dans les personnages eux-mêmes, qui expriment malgré eux ce mal-être possèdant, comme un diable invisible.