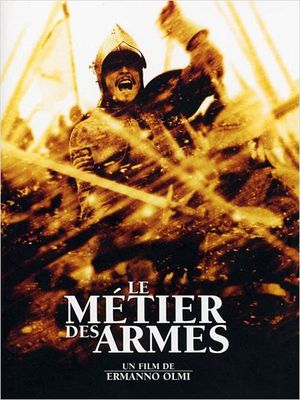La guerre en armure a rarement été traitée, du moins sérieusement, au cinéma. Nous sommes projetés en 1526. Suite au désastre de Pavie, François Ier a été contraint de renoncer à la Bourgogne, à Milan et à Naples. Sitôt libéré, il se rétracte. Furieux, Charles Quint lance Georg von Frundsberg, un soudard luthérien, sur Rome. Confiée à Jean de Médicis (Hristo Jivkov), l’avant-garde pontificale tente de ralentir sa marche.
Les Médicis ont donné des papes, des reines de France, des banquiers, des princes et un condottiere. Jean (1498-1526) est précoce. À 16 ans, il commande cent cavaliers et conquiert Urbino et Fermo. Quatre ans plus tard, à Vaprio d'Adda, il franchit le fleuve tenu par les Français et les met en fuite, ouvrant la route de Pavie. Sa fortune est faite. À la mort de son cousin le pape Léon X, il fait noircir ses bannières blanches et violettes, gagnant le surnom Giovanni dalle Bande Nere.
L’époque est troublée. Un condottiere est un professionnel qui a besoin d’or pour tenir ses troupes. Il est donc admis, qu’en fin de contrat, il se vende au plus offrant. En 1516, il est au service du pape contre Urbino, puis il passe en 1521 à celui de Florence contre la France et Venise. En 1522, il est aux ordres de la France contre les Impériaux ; en 1523 de Milan contre la France ; en 1524 de la France. En juillet 1526, il rejoint l’Église et Florence, puis, en novembre 1526, passe au service de la France contre les Impériaux.
De combats, il ne sera pourtant que rarement question. Les hommes de Médicis et de son alter ego Frundsberg marchent, franchissent des fleuves, des portes, bivouaquent à la nuit tombée. Le tintamarre des cavaliers lourdement armés dans les rues pavées résonne dans la citée apeurée. Il fait froid et il neige. L’hiver, la guerre n’est pas belle. Ermanno Olmi s’arrête sur les trognes patibulaires des vieux reitres. La troupe vit sur le pays. Elle vole, force, viole sans scrupules. Médicis est tout de volonté. Il écoute, réfléchit, ordonne et passe à l’action. La tension est visible dans ses yeux qui ont hâte de combattre et de forcer le destin. Hélas, ses alliés, Alphonse d’Este, duc de Ferrare et Frédéric de Gonzague, marquis de Mantoue, le trahissent, trop heureux de pousser les lansquenets loin de leurs possessions. Machiavel affirmait que la politique compte plus que les armes ; Médicis ajouterait qu’elle s’affranchit des alliances et des serments.
Les décors bulgares, les costumes et les armures sonnent juste. De nombreuses scènes semblent tombées de tableaux de Bruegel, Uccelo, Le Titien ou Holbein. L’influence du Andreï Tarkovski d’Andreï Roublev ou du Valerio Zurlin du Désert des Tartares est manifeste. Olmi ne craint pas d’accentuer la mise à distance entre son héros et ses spectateurs. Les officiers sont figés dans l’obéissance, les lettres sont lues par leurs auteurs et Pierre l’Arétin récite ses chroniques. La caméra s’attarde sur les repas, les campements, les conseils de guerre et les corvées de ravitaillement. Elle dévoile la peur des paysans et la fascination des enfants face à ce déploiement de puissance. Les scènes d’actions sont rares. L’affiche est trompeuse : la guerre est maintenue hors champ.
Dès les premières images, nous savons que Jean de Médicis va mourir. Le narrateur déplore l’apparition des armes à feu qui, lâchement, tuent de loin. Ce vieux débat s’était déjà posé avec l’arc et l’arbalète. Pour autant, le jeune Médicis ne se révolte pas. Au contraire, en professionnel de la guerre et en bon chrétien, celui qui fut un cavalier intrépide et passionné accueille sereinement la mort, telle une vieille compagne qui serait partie intégrante de sa vocation. N’est-ce point la meilleure réponse au prêtre errant qui, hier encore, apostrophait les soldats : « Vous n’êtes que des ombres, de creux simulacres ! » ?