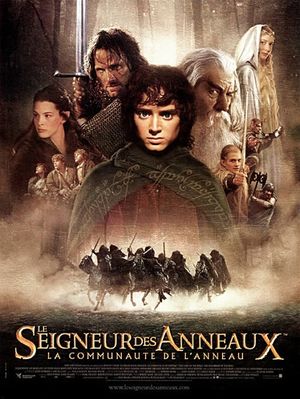Ce qui est bien avec « The Lord of the Rings », c’est que l’expérience s’avère tellement exceptionnelle et relativement unique dans sa conception, son développement et sa distribution, que même sans faire preuve de subjectivité, il est difficile de reprocher quoi que ce soit à ces trois films. Alors bien entendu, on peut ne pas aimer, là n’est pas la question, et bien entendu les trois opus ont leurs défauts, la question n’est pas là non plus.
Cette trilogie demeure une aventure extraordinaire, par ce qu’elle incarne à la fois dans la filmographie de Peter Jackson, le cinéma international (le film vient de Nouvelle-Zélande) et à Hollywood (c’est co-produit avec les U.S.A). Il s’agit certainement du meilleur rendu cinématographique d’un univers de Fantasy, du jamais vu avant 2001 et plus vu depuis… 2003. Trois mois après les attentats du 11 septembre (dont l’impact sur la production se percevra par la suite), débarquait ainsi sur les écrans le premier volet de l’adaptation d’une œuvre littéraire réputée inadaptable. Mais puisqu’il n’existe pas vraiment de livres inadaptables, le tour de force de « The Fellowship of the Ring » réside ailleurs.
Par un sens du détail incroyable (un point sur lequel il est important d’insister) et une authenticité qui donne toute sa texture à l’ensemble, Peter Jackson apparaît avec ce film comme un cinéaste plus qu’accompli. Suite à « The Frighteners », sa précédente réalisation, cela peut étonner, tellement il opte pour une tonalité sombre et sérieuse. Cependant, non dénuée d’humour et transmise par une mise en scène imaginative. En fin technicien, Peter Jackson n’oublie pas d’où il vient, et en ce sens il ne cesse de rendre hommage au travail énorme de ses équipes, ayant permis de mettre en image la Terre du Milieu.
Le métrage ressemble à plus d’un égard à une reconstitution historique fiable, plus qu’à l’adaptation d’un monde imaginaire sur grand écran. Il tire en cela sa force d’un tournage en décors naturels, qui met en avant les paysages de la Nouvelle-Zélande comme jamais, traduisant tout l’épique de l’œuvre de Tolkien, qui se perçoit dans les livres par d’innombrables passages de descriptions de paysages.
Visuellement splendide, des passages particulièrement sombres témoignent d’une Dark fantasy horrifique, issue de l’expérience de cinéaste extrême de Peter Jackson. Tout comme sa passion de l’Histoire, perceptible dans la méticulosité employée pour proposer un tableau visuel absolu, riche, cohérent et détaillé. Puisque de toute façon l’univers existe déjà dans les écrits de J.R.R Tolkien, la démarche n’était pas de le développer plus que de raison. Il fallait parvenir à proposer un visuel et un réalisme qui invitent l’audience en Terre du Milieu. C’est en cela que « The Fellowship of the Ring » se démarque, tout paraît vrai et crédible, palpable même. À partir de là, une fois que les spéctateurices sont embarqués dans l’univers, il n’y a plus qu’à raconter l’histoire.
Sans tomber dans un cinéma-branlette contemplatif, vide et sans intérêt, Peter Jackson ne perd pas de temps et enchaîne les péripéties du livre, en sacrifiant quelques passages, qui firent frémir les fanatiques de l’œuvre de Tolkien. Mais là, c’est du cinéma, et Peter Jackson en maîtrise son langage. Il ne propose donc pas une refonte du roman de Tolkien, mais établit sa propre vision de lecteur, par l’expression de sa passion pour le septième art.
Dès lors, les deux œuvres se dissocient totalement, et c’est une nouvelle aventure qui démarre. D’une richesse inouïe et infinie, il suffit de prendre le temps de se perdre dans l’arrière-plan pour constater à quel point la reconstitution se montre minutieuse. D’ailleurs, pour les décors, mais aussi en tant que consultants, il fut fait appel à John Howe et Alan Lee. Reconnus pour leurs travaux d’illustrateurs sur l’univers de Tolkien, ils participent à donner vie à la Terre du Milieu, marquant ici une continuité visuelle de la Littérature vers le Cinéma.
« The Fellowship of the Ring » n’existe que par la somme de plusieurs talents. Certes le film est réalisé par Peter Jackson, mais en solitaire il n’aurait pu livrer une telle œuvre. Pour s’en convaincre, c’est assez simple, il suffit de revoir « Bad taste », où il a (presque) tout fait tout seul. Si tel est le cas pour quasiment toutes les productions, des films comme cette trilogie viennent rappeler que le cinéma est avant tout un travail d’équipe. Une association de talent individuel dont la somme, assemblée par une personne, permet d’apercevoir toute la vasteté artistique que comporte cette discipline. Des sculptures sur bois dans la demeure d’Elrond, aux Statues numériques colossales de l’Argonat, il se cache derrière cela plein de cerveaux et de petites mains. Appartenant à tout autant d’inconnus (tous ces noms qui figurent au générique de fin) dont la contribution permet une multitude de détails, dans lesquels réside toute la réussite de cette création virtuose.
Au scénario se retrouve à nouveau Fran Walsh, dont la complémentarité dans l’œuvre de Peter Jackson n’est plus à démontrer. Elle occupe également le poste de productrice, puisque « The Lord of the Rings » c’est avant tout une histoire de famille. Une tierce personne s’ajoute au duo, Philippa Boyens, dont l’apport peut se retrouver dans des dialogues qui diffèrent des précédentes productions de Walsh et Jackson. L’entreprise se présente colossale, le recours à une troisième scénariste apparaît donc totalement logique, puisqu’adapter Tolkien, ça doit pas forcément représenter une mince affaire.
« The Fellowship of the Ring » c’est avant tout une œuvre d’aventure dans le sens le plus noble et le plus pur du terme. En reprenant le principe du monomythe, et sa narration peu originale, dans un univers ultra-codifié (apte à faire fuir quiconque y demeure étranger), le film parvient à réinventer un genre cinématographique qui n’a jamais vraiment brillé.
Si les années 1980 se montrèrent généreuses en Heroic fantasy, c’était souvent des séries Z italiennes cheap (avec des bodybuilders tout en sueurs et en peaux de bêtes), tournées dans des carrières faisant office de déserts. Cette description sied certes à « Conan the Barbarian » de John Milius en 1982, un échec lors de son exploitation, mais qui quarante ans reste un monument de la Fantasy de Cinéma (et ce qui se rapproche le plus de la qualité de l’œuvre de Peter Jackson).
Tout en prenant son temps, le film file à toute vitesse, par un rythme soutenu tout en fluidité, grâce à sa structure narrative qui échappe au littéraire, pour répondre aux attentes cinématographiques. À tel point, cette adaptation opte pour une identité définie, distincte du matériel de base, tout en y restant plus que fidèle. C’est comme si Peter Jackson jouait le rôle d’un disciple spirituel de Tolkien, égalant l’impact du livre lors de sa publication, mais par un médium différent, à une époque différente et pour un public différent. Là réside tout le génie de cette production et sa capacité à dépasser les limites que pose la littérature, comblée par l’imaginaire en ébullition d’un cinéaste à l’enthousiasme communicatif.
Il est possible de déceler dans le film toute l’expérience de spectateur de Peter Jackson, depuis son enfance, mais aussi son héritage de metteur en scène autodidacte. Lorsque « The Fellowship of the Ring » sort, « Bad Taste » est sorti depuis 14 ans, mais son tournage avait débuté 20 ans avant. Il y a là un tournant très clair, une véritable ascension dans une filmographie particulièrement marquée par l’atypisme de ses sujets et l’audace de ses traitements.
L’horreur, et plus principalement le gore, avec lequel Peter Jackson s’est imposé dans le monde du cinéma, se retrouve ici par petites touches, tout au long du film. Là encore, c’est dans une myriade de détails, parfois furtifs, que cela se perçoit. Mais dans une œuvre mainstream, destiné au grand public, une telle violence graphique demeurait relativement nouveau, alors que les Blockbusters proposaient des fictions de plus en plus aseptisées.
Le film bouscule ainsi un bon nombre de conventions, par une manière de faire du cinéma qui ne répond pas à une codification institutionnalisée par le Hollywood de l’époque. Entièrement développé en Nouvelle-Zélande (bien que ce soit une co-production) et en toute indépendance, forcément le produit fini diffère d’une production américano-hollywoodienne classique. Et ce qui arrivera après démontre parfaitement toute la grâce singulière du métrage, qui ne se retrouvera nulle part ailleurs.
Son impact sur le cinéma occidental s’avère absolument phénoménal, non seulement par sa réussite financière (près de 900 millions de $ de recette, sur un budget de 93 millions…), mais aussi par le fait que cette œuvre sort des sentiers battus. Forte d’une véritable audace, elle est renforcée par cette frontière que Peter Jackson aime longer dangereusement, entre le génial et le grotesque. Plus d’une séquence joue avec cette limite, sans jamais sombrer dans le kitsch ringard, et c’est là que réside une partie importante de sa force.
Reprenant pour lui les grandes thématiques du roman, le film décline ainsi sa nature pamphlétaire (dont l’héritage punk de Fran Walsh est peu éloigné), bien intégrée dans une narration mainstream (fruit de la culture pop’ de Peter Jackson). Le tout est emballé dans un blockbuster qui, au premier abord, peut sembler classique, mais constitue une œuvre populaire inestimable. Dans son ensemble, « The Lord of the Rings » évoque la fin d’une époque, la transition d’un monde vers un autre, par une nature absolument eschatologique qui règne en permanence en toile fond.
Le plus probant dans cette lecture réside certainement dans la dimension écologique de l’œuvre, à travers la destruction des forêts d’Isengard par Saroumane. D’un bel endroit verdoyant, il détruit absolument tout pour faire place à une industrie outrancière, qui exploite toutes les ressources et matières premières à sa disposition, pour alimenter l’effort d’une guerre totale. Ne pas oublier que J.R.R Tolkien, ancien combattant de la Guerre 14-18, publie son livre durant l’après-Seconde Guerre mondiale. Il ne venait donc pas ici prévenir en jouant les clairvoyants, mais délivrait plutôt un constat de ce qu’était jusque-là le XXe siècle, et son industrialisation de la mort.
Le livre ne prétend pas deviner l’avenir, bien au contraire, c’est une métaphore contemporaine qui regarde son temps sans livrer de réponses. Ainsi, il en va de même pour l’œuvre de Peter Jackson, qui se révèle malgré elle d’actualité, puisque le début du IIIe millénaire est marqué par les questionnements qui se retrouvent dans les récits de Tolkien. La fin d’un monde, un cycle qui se termine, une lutte entre l’industrialisation dramatique de l’anthropocène et une conscience éclairée sur les problèmes écologiques, qui ne détruisent pas tant la planète, que l’espèce humaine. Cette autodestruction est évoquée ici à travers un seigneur des ténèbres, qui corrompt quiconque pour pouvoir récupérer son pouvoir et donc sa place. Inutile de préciser qui est visé par un tel biais allégorique…
Deux décennies après sa sortie, « The Fellowship of the Ring » demeure un tour de force inégalé. Si, bien sûr, des effets spéciaux ont un peu vieilli (le film, sorti seulement deux ans après « The Matrix », date des balbutiements du tout numérique), ils possèdent une sorte de charme, semblable à ceux des années 1980, témoins d’une évolution d’un cinéma vers un autre. Et ce film, en particulier, marque une jonction parfaite entre un cinéma d’aventure daté du Hollywood de l’âge d’or, et un cinéma particulièrement moderne et internationalisé.
La nature d’aventure met en exergue des valeurs de courage, d’humilité, d’altruisme et d’abstraction. Frodo ne veut pas plus que les autres aller se balader en Mordor pour détruire l’anneau. Il accepte cette quête, car, à ce moment-là, il semble le plus apte, car il est le seul à n’avoir aucun intérêt envers l’anneau. C’est à la fois ce qui le rend un peu fade (cette volonté de toujours bien agir, sans se soucier de lui), et ce qui permet de véhiculer la nature initiatique du récit. Au travers de ce héros parfaitement calibré et sans surprises, ce sont les autres personnages qui l’entourent, plus complexes, qui gagnent en texture, Boromir en tête.
Dans ce premier volet, il n’y a pas un, mais neuf personnages principaux, qui servent par leur développement à fractionner le récit classique (de ce film) en différente partie (les deux suivants), et mener le public là où il ne s’y attend pas. C’est sans doute pour ça que « The Fellowship of the Ring » possède aussi ce charme si particulier : c’est le moment où l’on fait connaissance avec l’univers et tous les personnages, primaires comme secondaires. Cette démarche permet ainsi aux suites de gagner du temps (et de l’énergie), pour se concentrer sur un récit multiple dont les protagonistes sont déjà parfaitement délimités.
Le casting se révèle absolument parfait, même si les protagonistes apparaissent peu faciles à incarner, puisqu’ils incarnent eux-mêmes les fonctions attribuées par les mythologies diverses sur lesquelles s’est basé Tolkien. Pourtant, le scénario parvient à rendre chaque personnage aussi intéressant, sans les multiples pages utilisées par Tolkien pour les développer, ce qui aurait pu se présenter comme un piège.
« The Fellowship of the Ring » constitue ainsi le premier chef-d’œuvre d’une trilogie virtuose. En tant que film indépendant, il fonctionne également parfaitement, avec un début, un milieu et une fin construite comme un ensemble. Pas de « To be continued… » ou de « The Hobbit will be back… », le final reste ouverte, et invite à la possibilité d’une nouvelle aventure. Elle prend cependant tout le soin de clore le destin de la Communauté de l’Anneau, dissoute en fin de récit.
En reprenant la structure de Tolkien, Peter Jackson s’inscrit humblement dans l’héritage de son aîné, et ne cherche pas à briser quoi que ce soit pour se montrer plus malin qu’il ne l’est. En soi, ce premier challenge permet de poser l’univers et ses personnages, tout en prévenant que ce que l’on regarde n’est pas la même expérience que le livre. Le challenge suivant réside dans ce qui arrive ensuite, et prend une tournure bien différente, qui donne à ce premier film une singularité, qui ne peut forcément plus se percevoir dans les deux suites.
En tant que premier volet (comme en tant que premier tome), ce métrage marque les esprits et les rétines en ouvrant la porte de la Terre du Milieu à quiconque souhaite se laisser conquérir par cet univers passionnant. D’une grande richesse, on ne le répétera jamais suffisamment, il en devient également une parfaite occasion pour aller découvrir qui est ce Peter Jackson et ce qu’il a pu proposer avant cette excursion dans l’imaginaire d’un auteur majeur de la Fantasy du XXe siècle.
Ce n’est qu’en revoyant cette œuvre à la lumière de sa filmographie que l’on peut prendre vraiment toute la mesure de ce que représente « The Fellowship of the Ring » : une expérience de cinéma extraordinaire et magnifique, de laquelle il est difficile de revenir. Même vingt ans après, la magie opère toujours, puisque finalement ce que raconte le film est universel et indémodable, et la mise en scène hors du temps de Peter Jackson, lui permet de traverser les années, en prenant très peu de rides.
-Stork_