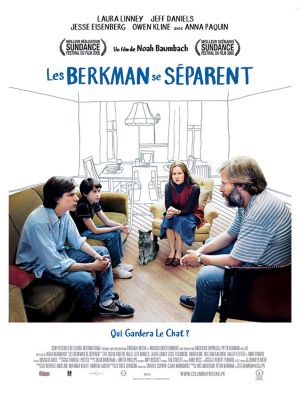Baumbach ne s'embarrasse pas de préliminaires superfétatoires car on rentre très vite dans le vif du sujet. Le film commence par un match de Tennis préfigurant les antagonismes à venir : le père et l'aîné contre la mère et le cadet, dualités qui s'affronteront tout au long de l'histoire, au point d'en constituer la structure du film. Une rivalité plus insidieuse fait aussi son apparition au cœur du match : celle entre la mère et le fils. Bien évidemment, il est ici avant tout question du conflit constituant la « clé de voûte » de ces fractures intra-familiales : celui entre le père et la mère, qui apparaît amèrement dans le match de tennis à travers un point marqué par le père suggérant bien des choses. Le coup semble assez agressif, et même si cela reste « dans le jeu », on sent le père peu enclin à s'excuser d'un coup bas semblant celui de trop pour la mère qui décide de rompre là un match dont l'intérêt pour les uns semble un peu trop de gagner, sans réellement jouer, et sans panache. Le tennis et le ping-pong constituent finalement assez souvent la métaphore de bien des combats dans cette œuvre : en particulier celui entre deux entités qui malgré le lien du sang semblent bien distinctes (le père et le plus jeune fils), ou encore celui, plus sourd et « pacifique », entre le père et la nouvelle figure paternelle incarnée par le professeur de tennis (inénarrable William Baldwin).
De cette séparation des parents découle un inexorable bouleversement chez les deux enfants : à l'annonce solennelle et officielle de la rupture, le plus petit pleure sans retenue. Le plus grand semble prendre sur lui de manière aisée, assurée, mature. Les carences éducatives et la philosophie de vie inappropriée pour un adolescent à la sexualité en herbe, résultats d'une éducation paternelle approximative révélant une trop lourde responsabilité pour un homme égocentrique et fat bien que fort attachant, auront raison de l'aîné, qui au bout de quelques péripéties de cœur, finissant par découvrir que le père se révèle plus colocataire que père, finira par retourner dans les jupons de sa mère qu'il aura pourtant rejetée au préalable. Plus inquiétant est la consommation d'alcool précoce du petit, qui bien évidemment constitue là l'un des symptômes fort symbolisant les failles de cette cacophonique éducation à deux têtes née de la déstructuration de la famille. Mais le problème ne sera pas traité au-delà des faits, et les parents en sembleront tout au long du film complètement étrangers. Ce qui est dommage, car il y aurait eu, à travers cette urgence à traiter par les parents, matière à symboliser une paix temporaire entre eux deux, certes factice, mais qui se serait peut-être révélée apaisante. Une nouvelle union en somme, association résultant de l'amour commun porté à leur fils, et de l'obligation du devoir parental. Et c'est un peu ce qui pêche dans le film de Baumbach qui bien que très juste et brillamment interprété n'est pas pour autant un chef-d'oeuvre : l'impression que, malgré la justesse de ton d'ensemble, certains propos et thématiques auraient pu être mieux traités en profondeur, un peu plus développés, afin de faire gagner au film un peu d'épaisseur.
Le film montre en grande partie à quel point les enfants trinquent, et non pas qu'ils aient un choix à faire entre « papa ou maman ». Et bien que le grand frère, qui veut grandir trop vite en s'identifiant sciemment à son père, semble garder la tête froide face à la séparation de ses parents, la fin du film laisse progressivement entrevoir les signes de sa rupture à lui, inévitable (plongeon incontrôlable dans un étang, retour chez la mère pour partager un moment inoubliable de son enfance qui le rend subitement nostalgique et par là-même le fait pacifier ses rapports avec sa génitrice). Cassure intérieure d'une tension trop forte, trop intense émotionnellement, le fils fini (enfin) par ne plus écouter son père alors que celui-ci se trouve à l'hôpital, ne pouvant plus contrôler son désir intérieur. Il court au Musée d'histoire naturelle de New York, pour se confronter alors à ce qui lui faisait peur étant enfant : un tableau pictural représentant l'un des combats les plus mythiques des océans, le calamar et le cachalot. Magnifique scène montrant l'adolescent planté tel un piquet, véritable bambin hagard, riquiqui devant le tableau gigantesque qu'il se retrouve un peu malgré lui, prêt à affronter.
Mais ne s'agit-il pas moins d'un courage à défier une toile en rompant ainsi symboliquement avec ce qui lui faisait peur étant enfant, que la capacité à affronter ce qui en réalité ne se révèle être rien de plus que la lutte acharnée que se sont livrés jusqu'à alors ses deux parents ? - le réalisateur laisse une fin ouverte et plus heureuse qu'elle n'y paraît, ne donnant pas d'issue à un combat dont on ne veut de toute façon voir sortir aucun « vainqueur », en parfaite synchronisation avec ce que montre le tableau : l'action est comme suspendue ou mise sur pause. Les deux bestiaux, emberlificotés de tentacules, sont au corps à corps, et étrangement aussi, en un sens, plus rapprochés et donc moins séparés qu'il ne veulent bien l'admettre.