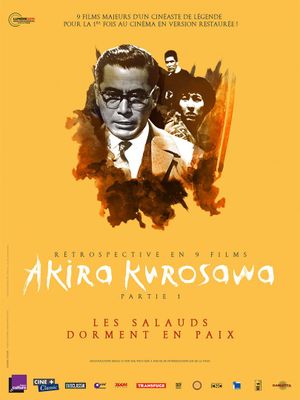Un coeur de pierre en guise de Prozac®
Au moyen d’une scène d’exposition remarquable, Kurosawa présente tous les enjeux de Les salauds dorment en paix. 25 minutes d’introduction pendant lesquelles il invite le spectateur dans son film, en l’intégrant parmi un groupe de journalistes qui assistent, selon leurs propres mots, au « prologue » d’une tragédie nippone tirant son essence du Hamlet de Shakespeare. La preuve en est la précision presque mathématique du propos qu’y déroule un cinéaste remonté, bien décidé à mettre en lumière la corruption maladive qui gangrène les hautes sphères de l’économie japonaise.
Plus que le réalisme des situations qu’il dépeint, de leur déroulement en tout cas, c’est leur portée symbolique qui intéresse Kurosawa. Si pour faire avancer son intrigue, il doit user de quelques ficelles parfois faciles, cela importe peu du moment qu’elles permettent à son message de monter en puissance. C’est d’ailleurs dans le côté convenu de certaines révélations, comme marquées par un coup de projecteur et d’un gong retentissant, que l’on remarque l’inspiration théâtrale à l’origine du film, qui marque de son empreinte chacune de ses composantes.
Les salauds dorment en paix est en effet porté par une narration rappelant l’exercice des planches, qu’il soit question de son histoire découpée en actes bien distincts (Présentation des personnages, première révélation, mise en place de la vengeance, réaction du camp adverse, conclusion tragique), ou de ses personnages dont les rôles sont très fortement typés. Mis à part Nishi dont l’écriture est moins tranchée, chacun d’eux véhicule un message bien précis. Le père est une ordure de la pire espèce, son bras droit lui voue un respect à sa hauteur, leur sous-fifre est une petite frappe intéressée dépourvue de tout courage, la fille malchanceuse est aussi kawaï qu’elle manque de tempérament, et le clan des victimes est représenté par ce haut cadre prêt à faire don de sa vie parce qu’il est totalement soumis.
L’objectif de Kurosawa est clair, porter sa critique à bout de bras, de manière à la rendre aussi cristalline que possible : la portée de son coup s'en trouve être aussi prévisible qu’imparable. Et finalement, un coup n’est jamais aussi destructeur que lorsqu’il n’emprunte aucun chemin détourné. Pour preuve, les quelques coups de mou qu’accuse Les salauds dorment en paix, dont la durée n’est à mon avis pas forcément justifiée, concernent des storyline parallèles, qui ne servent pas de manière directe le propos critique de leur auteur. La relation entre Nishi et sa femme est, à ce titre, un peu maladroite. Et si l’on comprend cette volonté de tempérer une forte dénonciation par une histoire d’amour porteuse d’espoir, cela paraît un peu hors contexte et trop rapidement traité pour fonctionner pleinement.
Bien entendu, cela n’écorne en rien la puissance de son film, Kurosawa étant tellement généreux dans sa mise en scène, que même lorsqu’il la met au service d’un passage un peu plus laborieux, il y a toujours quelque chose à y déguster. Laissant parler son œil terrible pour les compositions de plan ingénieuses et sa maîtrise virtuose de la lumière, il donne pleine expression aux visages qu’il sort tour à tour de l’obscurité pour faire des Salauds dorment une oeuvre graphique d'une puissance formelle indéniable. Peuvent alors s’y mouvoir à loisir les talentueux acteurs qu’il dirige d’une main de maître : de Toshiro Mifune qui kidnappe les yeux de l’audience chaque fois qu’il apparaît à l’image à Masayuki Mori, parfait en salaud dépourvu de toute conscience, tous portent le propos du cinéaste avec un investissement total.
Si les salauds dorment en paix ne se hisse pas parmi mes favoris du cinéaste —je lui préfère Entre le ciel et l’enfer pour n’en citer qu’un—, la faute à son rythme en dent de scie qui le pare de quelques longueurs, il reste une oeuvre phare de l'auteur, un uppercut critique sincère qui marque au fer rouge celui qui sait rester attentif jusqu’à son ultime respiration. Jusqu’à ce point final au fort potentiel dévastateur parce qu’il confirme que le salopard aux manettes du jeu de pouvoir auquel nous venons d’assister, n’est, lui-même, qu’un soldat sous la botte du détenteur des terribles boutons qui lui permettent de manipuler, peuple et fonctionnaires haut placés, comme de simples pions sur un échiquier dont il est le seul maître du jeu.
-----
Pour les zimages, c'est par ici ↓