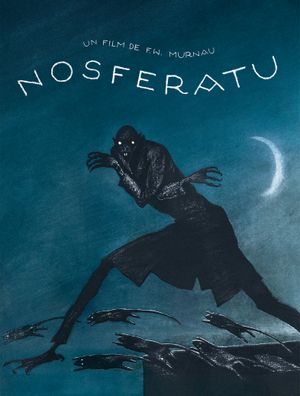Je vois ce film à rebours, après la sortie de la version d'Eggers qui m'a franchement déçu, bien que je n'en connaissais point son modèle (regardant lui même le Dracula de Bram Stoker). Je peux maintenant l'affirmer, Eggers ne parvient pas à se hisser à la hauteur de Murnau, en vrai maître du haut château.
Tout ce que je reprochais à la nouvelle version se trouve parfaitement maitrisé dans celui-ci :
Tout d'abord, les sciences naturelles se substituent aux "sciences" occultes qui tiraient plutôt du côté de l'exorcisme, voire de la chasse aux sorcières (cohérent puisque Eggers opte pour l'épouvante, mais dissonante selon moi). Cette métaphore se révèle bien plus féconde en ce qu'elle dit l'emprise animale du comte Orlok sur Ellen, suscitant une peur primitive (l'araignée comme métaphore de nos peurs instinctives) face à l'apparition d'un mal millénaire et d'un ennemi héréditaire de l'espèce humaine. Elle ancre aussi le propos dans la question plus large de la confrontation entre l'Homme et les forces naturelles (mal naturel ?) mais aussi entre "nature" et civilisation. En effet, le personnage de Schnock est riche de sens : présenté sous les traits d'un homme vicieux, véreux et avide dès le départ, il est le premier acteur du pacte Faustien qui liera Nosferatu à Ellen. L'arrivée de Nosferatu, magistrale, apparaît alors comme une sentence (littéralement une prophétie) exprimée envers l'avarice et le rationalisme optu des citadins bourgeois (qui devra aboutir au rite sacrificiel). C'est dans les ruines du capitalisme (manoir de Nosferatu à Wisburg) que doit éclore le mal nécessaire.
Cette idée est servie par des effets spéciaux de haute tenue, usant de surimpressions pour marquer la hantise et le vertige que génère Nosferatu (Murnau en chef de file du cinéma expressionniste allemand est un des précurseurs de cette technique), d'accélérés parfaitement maîtrisés : je pense notamment à la scène canonique durant laquelle Nosferatu rejoint Ellen chez elle qui joue sur la vitesse et la lumière. Les plans sont également très léchés, avec des jeux de verticalité vertigineux qui teintent l'élévation dévoyée de la civilisation d'une inquiétante menace (tour de Babel ?). C'est sans compter le travail sur les lumières qui donne lieu à de magnifiques clair-obscurs ... La scène de l'épouvantail est également très réussie. La musique quant à elle donne un aspect magistral à l'oeuvre.
Le film est également à la croisée des inspirations, déployant un syncrétisme enlevé fort de légendes médiévales et de résonances homériques. Murnau y fait planer, bien évidemment, l'ombre de Faust en vrai thuriféraire de la tradition germanique, mais donne aussi à entendre en sourdine les échos d'Ulysse, Ellen transfigurée en Pénélope (attendant le retour de son mari), Hutter en Ulysse romantique (s'attachant au mat du bateau). Murnau donne naissance à une véritable mythologie du vampire.
Un classique qui mérite vraiment son statut.