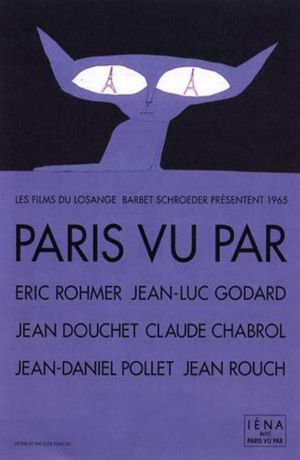Paris vu par... par Philistine
Ce court-métrage de Jean Rouch a l'heur de constituer un parfait échantillon, du moins selon moi, de ce à quoi peut ressembler un film de la Nouvelle Vague – pas celle de Godard, qui m'indiffère profondément, mais celle de Rohmer. Ainsi il peut faire office de test : si vous détestez, autant vous arrêter là avant de contracter une haine pour ce mouvement, qui vous fera autant de mal qu'elle en fera aux amateurs.
Je suis véritablement triste que tout le monde ne soit pas capable d'apprécier un pareil film ; pour moi, non seulement il est plaisant à regarder, mais en plus il contribue à adoucir ma vision du monde, il m'éloigne un peu du sinistre, et cela me fait un bien fou – beaucoup plus que d'autres films uniquement divertissants, vus avec plaisir mais trop vite oubliés.
L'image est loin d'être excellente, mais les plans-séquences audacieux et réussis. Pour tout dire, je me suis tellement laissée emporter par la fluidité de ces mouvements que j'ai dû lire dans un ouvrage que le film était composé en plans-séquences pour m'en rendre compte. C'est honteux, mais en même temps, ça en dit long sur le naturel obtenu et voulu par le réalisateur. La caméra se faufile, toujours à point de vue humain, ce qui fait que jamais on ne vient à se demander : comment est-elle arrivée là ? Cela permet une entrée très neutre dans la vie quotidienne des personnages : contrairement à chez Bresson, ici, le montage est évité, et Rouch, conformément à son travail documentaire, crée un point de vue flottant, à l'écart du jugement.
Et voilà une des choses que, me semble-t-il, les détracteurs des films de la Nouvelle Vague ont du mal à saisir : les personnages à l'écran ne sont pas forcés d'avoir raison. Aimer ce court, aimer les films de Rohmer, ça ne veut pas dire être constamment en symbiose avec les personnages. Au contraire, ces réalisateurs nous montrent que chacun, si on le montre à l'écran assez longtemps dans des situations assez significatives, est compréhensible, et parviennent par là même à nous faire apprécier des personnages parfois très irritants (oui, MÊME Arielle Dombasle en aristocrate).
Dans la dispute du début de Gare du Nord, les deux personnages ont également tort : lui, parce qu'il n'a aucune ambition, elle parce qu'elle accepte ce manque d'ambition mais qu'elle passe son temps à le critiquer, ce qui crée une atmosphère de violence. Et c'est bien cela qui est passionnant, car voyant cette dispute, de l'extérieur, en comprenant les agacements de chacun à part égale, on se rappelle toutes nos propres querelles. C'est véritablement la dispute de couple universelle qui est jouée sous nos yeux. Et elle est bel et bien jouée : si cela apparaît si vrai, c'est bien parce qu'il y a un scénario, parce que cela est condensé. Je crois beaucoup moins au « naturel » dû à l'improvisation – souvent ennuyeux ou embarrassant, dans les documentaires de Rouch.
Finalement, en tant que court-métrage, ce film me paraît très bon, c'est quand même utile parfois de juger les choses pour ce qu'elles sont. Il y a une situation de départ, puis une rencontre, et le tout laisse songeur, pour moi c'est exactement ce qu'on peut attendre d'un court.
En fait, je me demande parfois si ce qui ne dérange pas la plupart des détracteurs, c'est le fait de devoir se mettre dans la tête de femmes, comme souvent chez Rohmer (et comme ici – puisque malgré la neutralité du début, c'est tout de même Odile que l'on finit par suivre et que l'on voit affronter ses contradictions). Rien à voir en effet avec l'identification virile et transparente des westerns. En plus, il faut s'identifier à une femme qui a affaire à la médiocrité des hommes, la médiocrité de son petit ami en particulier (c'est également le thème des Nuits de la pleine Lune ou bien du Rayon vert). Ce n'est peut-être pas un sujet que tous les hommes affrontent aussi librement, en fin de compte...