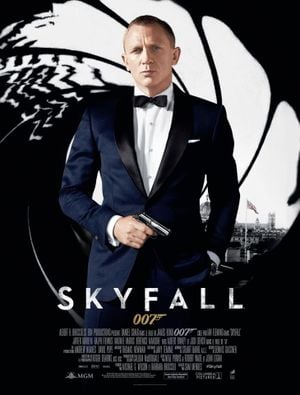Sam Mendes réussit la prouesse de s’attacher à la mythologie de Bond et de renouveler le genre. Il remplit son contrat (nous divertir) et va même au-delà (il nous surprend par ses audaces et par la majesté de sa mise en scène) ; il parvient à jouer sur des effets de puissance et de grandeur sans jamais entraîner une quelconque balourdise. Oui, le film est un blockbuster (de par son financement, son lancement et son existence même – c’est le 23ème opus d’une série de films très profitables), mais le soin apporté à sa confection lui donne une légitimité immédiate. Mendes triomphe là où Christopher Nolan a échoué avec sa trilogie consacrée à Batman : il revisite un personnage (Bond), un univers (l’espionnage) et un concept (la survivance) connus mais en garde toute la dimension spectaculaire, palpitante et réjouissante. Il s’agit d’un pop-corn movie réalisé avec savoir-faire, qui ne laisse pas les mains grasses après dégustation et qui ne s’engage pas dans un traitement sinistre et nébuleux d’une figure familière.
.
Le générique est un éblouissement, peut-être le plus beau de toute l’histoire des Bond (oui, encore meilleur que ceux de Maurice Binder) ; c’est une mise en abyme captivante de tout le film et une œuvre d’art à part entière. La chanson titre, composée et interprétée par Adèle, lui donne du souffle et de la beauté ; la musique est totalement en accord avec les images qu’elle illustre.
.
"Skyfall" opère un retour à une sensibilité très british ; les scènes se déroulant à Londres sont extrêmement réussies : elles révèlent quelque chose de différent, un mélange réussi d’action, de thriller et d’intelligence (on passe d’une citation de Tennyson à une fusillade musclée sans aucun problème). Les enjeux et les problématiques politiques dans lesquels baignent les personnages sont limpides mais jamais simplistes (ce qui est rare dans un film d’espionnage). Les relations entre Bond (Daniel Craig), son ennemi Silva (Javier Bardem) et M (Judi Dench) ont donné lieu à des théories psychanalytiques vaseuses ; la dynamique qui s’instaure entre eux n’a pas besoin de ces délires d’interprétation pour s’apprécier à sa juste valeur.
Le film est constamment exaltant. Il est moderne tout en revenant en permanence à des réflexes et des "trucs" de cinéma qui ont fait leurs preuves ; Mendes combine nostalgie et variations. Le rythme est constant (ce qui est un exploit dans la mesure où le film alterne des moments de tension frénétique et des scènes plus intimes, moins "spectaculaires").
Le casting est un succès total : Bardem est mémorable en ancien agent du MI16 tombé en disgrâce ; Craig, qui n’avait pas complètement convaincu jusqu’ici, trouve sa place et conquiert une autorité très percutante (il a perdu l’anachronisme et l’étrangeté que faisait naître son casting à ses débuts dans le rôle). Judi Dench tient le premier rôle féminin à ses côtés (c’est bien sûr elle, la vraie James Bond Girl du film), et Ben Winshaw est un bonheur dans le rôle de Q.
On peut compter sur Mendes pour s’entourer de collaborateurs d’exception. Il faut mettre en avant le travail somptueux de Roger Deakins : le chef-opérateur s’est surpassé. Il s’est attaqué avec gourmandise au projet et a adapté sa photo aux différentes séquences géographiques du film (chacune est éclairée différemment selon sa position sur le globe : le passage se déroulant à Shangaï s’enrobe de bleus lumineux et de noirs profonds ; la visite de Bond au casino de Macao nous enveloppe de teintes dorées, presque sensuelles ; le déplacement de l’action en Ecosse s’accompagne d’un changement du traitement l’image). Les décors de Dennis Gassner sont magnifiquement mis en valeur par le génie visuel de Deakins. Il accomplit un travail réellement extraordinaire : il ajuste sa photo à la situation sans jamais perdre son style ou créer des ruptures de ton…tout n’est qu’harmonie, élégance, équilibre.
Thomas Newman, le compositeur fétiche de Mendes (qui avait signé des partitions superbes pour "American Beauty" et pour "Les Chemins de la perdition") part sur des routes qu’il n’avait encore jamais emprunté : on reconnaît sa patte et pourtant, on a l’impression de le voir innover, se frotter à un nouvel univers.
Seul faux pas en 2h23 de projection : la scène de confrontation dans l’église, un ratage complet qui, l’espace de cinq minutes, fait retomber le film comme un soufflé. On pardonne cette faute de goût à Sam Mendes car l’épilogue qui vient juste après retrouve toute la classe et le brio auxquels nous étions habitués jusque là.
Vivement Bond n°24.