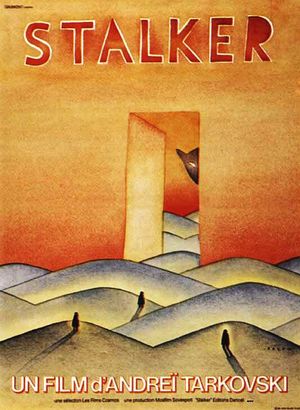Stalker est un film difficile. Le moins averti des cinéphiles plongera vite dans l’aspect le plus rébarbatif du cinéma contemplatif. Mais il suffit de plonger du bon côté du film pour éviter l’ennui, et tomber de tout son être dans une œuvre que je ne pourrais même pas qualifier d’intelligente sans être sûr d’être bien en dessous de la vérité.
Et quand bien même vous réussiriez à plonger du bon côté, Stalker reste un film dur à appréhender. Les 165 minutes, même s’ils n’en paraissent que 90, sont avant tout un défi, se rapprochant cependant plus de l’invitation que de la compétition.
La lenteur du film n’est évidemment pas là par hasard. Stalker fait d’ailleurs parti de ces rares exemples où le fond s’adapte parfaitement au style formel bien marqué d’un réalisateur. La froideur grandiose de Kubrick sur 2001, les souvenirs d’une autre vie de Malick dans La Ligne Rouge, la mise en scène classieuse et calculée de Coppola dans Le Parrain… Et la contemplation poétique de Tarkovski sur Stalker donc.
Sur ce film, le fond absorbe donc la forme. Mais pas que. Il absorbe son spectateur. Et c’est de là que le film tient tout son génie. Celui qui regarde est mis en abyme par la forme contemplative, qui vous aspire jusqu’à vous mettre à la place des personnages, et nez à nez avec le fond. Ces trois personnages qui passent leur temps à tourner en rond, à éviter les pièges, à chercher plus loin leur but, c’est le spectateur devant Stalker. Ces plans à la longueur indéfinissable laissent parfaitement le temps à la pensée de se balader à sa guise dans la Zone qu’est notre esprit : un espace gardé, dangereux, d’où jaillissent de nombreux fantasmes, mais surtout à la recherche d’une vérité absolue commune à tout être. Une vérité évidemment inatteignable, tel le bout de la pensée.
Cet exercice de style est un véritable coup de génie. Tout y est : la force d’un objet abstrait, l’intelligence d’un essai philosophique, l’évanescence d’une œuvre d’art inscrite dans l’éternité.
Tarkovski prend le mot introspection au pied de la lettre, et l’applique comme peu ont pu le faire. Il en fait même le message de son film. Si l’on considère le deuxième plan du film (aller et retour au dessus de la famille endormie du stalker), le son nous fait ressentir de la manière la plus cinématographique qui soit l’envie d’échapper au quotidien. Un bruit de train, une Marseillaise, tout est dit. À ce moment, l’envie du stalker est bien de s’échapper (envie peu surprenante quand on regarde le contexte soviétique de l’époque durant laquelle a été réalisé le film), ce qu’il fera grâce à la Zone. Le dernier plan du film, quant à lui, prend les mêmes ingrédients pour un résultat tout autre. En remplaçant la Marseillaise par l’Ode à la Joie, et en faisant lire le personnage plutôt que dormir, Tarkovski délivre un message simple : le bonheur ultime s’atteint non pas par son environnement, mais bien par l’introspection.
Et lorsque je regarde ce film, que je laisse mon esprit vagabonder, que je laisse les idées abstraites de la littérature rencontrer celles matérielles de la physique, je ne peux que mesurer la puissance d’une pensée qui se construit doucement, en avançant comme un lent travelling sur des images au symbolisme et au pouvoir d’évocation sans pareils.
Stalker est une description de l’esprit qui sait pertinemment que, tout comme la vérité est inatteignable, cette description sera toujours incomplète.