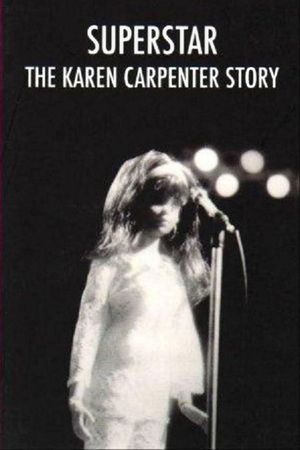Avant l'original et plutôt réussi I'm not there, biopic de 2006 sur Bob Dylan, Todd Haynes s'était déjà essayé au biopic. Il a d'ailleurs commencé sa carrière cinématographique par ce moyen métrage mais ayant l'ampleur d'un long. Comme son nom l'indique, le film raconte "l'histoire" de Karen Carpenter, batteuse et chanteuse du groupe eponyme des années 70.
Mais loin de faire une fiction classique du genre, il se montre déjà particulièrement inventif, sans doute plus qu'il ne l'a jamais été. En effet, il prend à contrepieds tous les poncifs du genre en représentant la famille Carpenter par des... poupées Barbie. Choix surprenant mais fabuleux, déjà pour son éthique de mise en scène : ici, pas de tentatives d'imitations par des acteurs, les véritables personnes de la famille Carpenter sont laissés là où ils sont, l'icône de célébrité n'est pas grimée, prouvant son caractère unique. Et puis bien sûr, pas de reconstitution coûteuse d'une société d'époque, Haynes ayant sûrement aussi profité d'un manque de budget pour inventer une manière de raconter ce pan de vie.
Ce décalage de figuration crée ainsi une émotion rarement ressentie devant un biopic et même un film, lors des scènes de famille ou lorsque Karen chante en concert. Chaque passage obligé du biopic devient alors transfiguré, ces moments de vie ne sonnent pas faux mais au contraire encore plus vrai. Todd Haynes assume complètement le côté factice d'une reconstitution fictionnelle et l'expose avec force au spectateur.
Mais une réflexion plus profonde s'ajoute à ce choix, celui de montrer le façonnage de la société de consommation, qui fabrique des stars à la chaîne pour mieux les laisser pourrir derrière. Souvent, des extraits de publicités ou de show télévisés sont montrés, des travellings exposent des boîtes de conserves entassées, d'autres des pavillons de banlieue se ressemblant tous. Quoi de meilleur choix donc que de représenter les Carpenter par des poupées Barbie, symbole même de cette surproduction fatiguant et dangereuse. Preuve supplémentaire de l'intelligence d'un tel choix, on apprend que Karen souffrait d'une anorexie mentale, était obsédée par la nourriture et le fait de rester mince.
Et puis, rarement une vie aussi difficile n'avait été aussi bien illustrée par les chansons du groupe et la voix douce et mystique de Karen, d'une mélancolie bouleversante. Leur utilisation démontre le talent de Haynes en matière de storytelling, mêlant scènes de concerts (reconstituées là aussi), scènes familiales, vraies images d'archives de la société de l'époque, voix-off cynique et textes très critiques envers la société son traitement de l'anorexie à l'époque. Pour s'en persuader, il n'y a qu'à voir ce travelling glissant de la droite vers la gauche au début du film, pendant que la voix-off annonce un retour en arrière chronologique. Le temps est comme la rue pavillonnaire d'une banlieue américaine, une suite de tranches de vies, sans fin et similaires.
Et puis il y a la fin, ultime preuve du côté expérimental de Superstar, figurant la mise à mort de Karen (que nous savons depuis le début) de manière magnifiquement chaotique. Le personnage devient spectateur, agressé de la même façon par ce médicament, puis vient la mort : rapide, presque épileptique, mais finissant par une image dont on ne peut se défaire, celle, pour la première fois, du visage de la vraie Karen Carpenter.
Enterrement, retour en arrière, images d'archives ou non de son enfance (on n'en sait rien), puis la fin.
Those good old dreams.