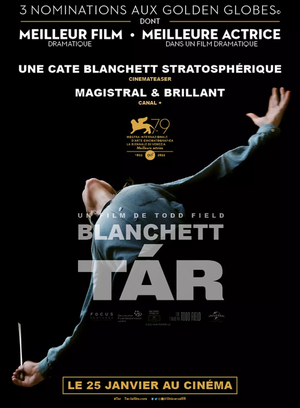Je suis perplexe. Parce que Cate Blanchett, j’avais envie, très envie d’aimer ce film. J’avais vu passer la polémique sans trop m’y plonger pour garder l’esprit ouvert avant la projection. Je m’attendais à être troublée, peut-être pas convaincue par le propos, mais en tout cas transportée dans un film riche. Bon. Et bien ce n’est même pas très joli. Ce n’est pas palpitant. C’est long. C’est classiste. C’est froid.
Cate Blanchett joue parfaitement bien. J’ai souvent baillé, mais, grâce à elle, je ne me suis pas endormie (j’ai un peu lutté). Le début est prometteur : un écran de téléphone et des messages acerbes dont on ne sait pas de qui ils proviennent, une discussion à bâtons rompus dans un amphithéâtre et la chevelure d’une femme filmée de dos, un premier flirt, le début d’une tension, une cheffe d’orchestre prises de gestes nerveux avant d’entrer sur scène. Quel mystère va-t-on devoir percer ? Quels secrets vont être dévoilés ?
Je n’aime pas le didactisme. J’aime les parts d’ombre. J’aime la place laissée à la libre interprétation. J’aime les fins en suspend. Mais il faut quand même donner quelque chose à saon spectateurice. Ici, de minuscules morceaux d’intrigues sont jetés en l’air et ne retombent jamais. Les références obscures pour quiconque n’a pas fait 8 ans de conservatoire s’enchainent. L’image n’est pas laide, mais elle n’est ni spécialement belle ni particulièrement marquante non plus. Et le message qui semble être suggéré par le film est déplaisant au possible : les jeunes sont assujettis aux réseaux sociaux, iels ne comprennent pas la réalité du monde, leurs combats sont absurdes, les jeunes filles sont des allumeuses, les accusations de violences sexistes et sexuelles brisent des carrières. Le fait de faire porter ces intentions à un personnage de femme lesbienne rend le tout franchement odieux, comme une sorte de caution diversité hypocrite, de relativisme absolu qui s’affranchit des savoirs sociologiques.
Pendant tout le film, j’ai en plus eu l’impression que Cate Blanchett était filmée exactement comme les sempiternels hommes cis hétéros blancs habitués des premiers rôles. La colère sublimée, la figure du parent absent, du séducteur aussi, l’excellence de celui qui part de rien, l’artiste génial incompris… Le fait que l’on colle les poncifs de la masculinité (toxique) à une femme lesbienne relève à mon sens du cliché, voire d’une forme de lesbophobie, et met mal à l’aise.
La toute dernière séquence m’a fait passer de l’agacement à la colère. Attention, spoilers : après être tombée de son pied d'estale, la « maestro » (ne vous avisez pas de l’appeler « maestra ») se retrouve au fond du trou. Quel genre de trou ? Figurez-vous que la déchéance ultime c’est de vivre en Asie (du Sud apparement ? Thaïlande ou Vietnam peut-être ?). Les habitant·es de la région apprécieront. Mais plus dramatique encore : c’est pour y jouer la musique de bande son de jeux vidéos POPULAIRES devant des JEUNES. Pourrait-on imaginer destin plus tragique ? Le mépris de ce choix scénaristique, ce retournement de situation volontairement mis en scène pour faire rire au dépend de l’assemblée costumée, me laisse sans voix.
Par soucis d’honnêteté, la lecture d’une autre critique m’a fait me dire qu’une autre interprétation du film était peut-être possible. Voici donc un lien vers l’intéressant papier de Marie Telling : https://slate.com/culture/2022/12/tar-cate-blanchett-movie-ending-explained-analyzed.html