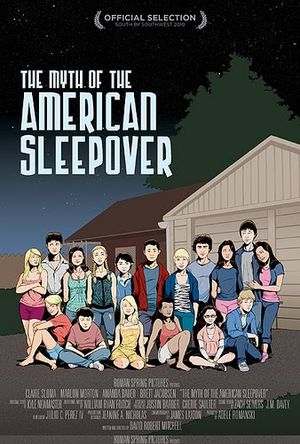S’il fallait trouver des référents à ce coup d’essai ils seraient à chercher du côté de Sixteen candles et Dazed and confused. Un mélange de Hugues et de Linklater, oui tiens, pourquoi pas, auxquels on pourrait adjoindre le American graffiti de Lucas ainsi que le Adventureland de Mottola. Quatre films, quatre décennies différentes. Je n’y avais même pas prêté attention. Néanmoins, le cinéma de David Robert Mitchell ne ressemble à aucun de ces teen movies, dans le fond. Il ne partage ni leur ancrage nostalgique ni leur pendant comique, burlesque ou très dialogué. Il y a quelque chose chez lui qui sonne presque européen. Pas étonnant qu’il cite Truffaut comme étant sa principale source d’inspiration. Et pas étonnant non plus que son approche me parle infiniment, jusqu’à l’hypnose, telle que je voudrais le voir s’étirer à l’infini.
Le cinéaste raconte qu’il a construit The myth comme un rêve et It follows comme un cauchemar. L’un étant finalement le versant fantasmé de l’autre, suivant le fantasme qu’on lui prête. A chaud, je ne saurais pas dire lequel je préfère, je pense que cela dépend de l’humeur. Mais ce sont les mêmes films, à mon avis. C’est un peu comme lorsque Demy fait Les parapluies de Cherbourg et Les demoiselles de Rochefort. Si le tragique et la lumière s’invitent dans les deux, il y a deux danses : l’une terrible, l’autre merveilleuse. On pourra toujours se dire qu’It follows témoigne d’une consécration narrative et plastique mais cela n’enlèvera rien à ce premier film, moins maitrisé certes, mais accompagné tout du long par une singularité d’une grâce folle.
Toujours est-il qu’il est le seul aujourd’hui à filmer l’adolescence ainsi, sous le joug de la fixation charnelle, de l’angoisse de la sexualité, de la tentative maladroite. C’est ici un garçon qui cherche la fille à la robe jaune dont il a croisé le regard au supermarché, là un autre dans son désir de retrouver deux sœurs jumelles dont il était tombé amoureux lors d’une soirée ultérieure. Il y a aussi Maggie en plein imbroglio sentimental partagé entre son emprise sur un camarade de classe et son attirance pour le garçon de la piscine. Tous déambulent dans une sorte d’impasse, entre leur solitude affective et le plaisir de la découverte, à l’image de Claudia qui vient d’emménager et fait la connaissance de ceux qu’elle côtoiera quotidiennement lors de la prochaine année scolaire. C’est une impasse, mais une belle impasse, tant Mitchell capte ce spleen avec une infinie tendresse. On a envie d’être avec eux, de partager leur loose. J’ai aussi beaucoup pensé au film de Matthew Porterfield, I used to be darker, qui partage avec lui cette même approche sensible, aérienne.
C’est une nuit où rien ne bascule concrètement, mais où tous les souvenirs se jouent. Une nuit, rien qu’une nuit, entre soirée pyjama, errance entre les quartiers anonymes, baignade dans le lac. A l’image de son titre, Mitchell se situe moins dans le réalisme que dans le mythe. Au-delà de son aspect cruel – toutefois moins cruel que dans It follows – on navigue dans une version fantasmée de l’adolescence. Et The myth est comme cela parcouru d’une ambiance mystérieuse (pas encore fantastique, mais presque) et ouatée où les plus doux moments sont captés comme des caresses, on pense notamment à ce « baiser respiratoire » dans un sous-sol ou à cette évasion nocturne sur un toboggan ou encore à cet étrange immeuble en ruines – que l’on retrouvera aussi dans le film suivant, lors d’une séquence inversée, terrifiante – où semblent être pratiquées des rencontres anonymes, jusqu’au baiser langoureux, sinon plus.
Comme je le disais précédemment, ça pourrait être sans fin. Il n’y a pas vraiment de règles dans ce teen movie de poète, le jour ne pourrait jamais supplanter la nuit que l’on s’y ferait. En ce sens ça évoque aussi beaucoup le Deep end de Skolimowski, ode passionnée à la fuite des corps. Et les frontières y sont toutes abolies : Scott rejoint une fac de l’autre ôté d’un pont, Rob ne cesse de croiser sa mystérieuse déesse sans la voir, tout le monde entre chez tout le monde, les garçons sont autorisés à pénétrer dans une soirée pyjama fille. Cette idée de frontière est d’ailleurs le cœur du cinéma de Mitchell tant il symbolise autant l’ouverture que la peur. Le bonheur et la torture, à la fois. Comme l’avoue Scott à Ady et Anna, quand il reconnait ne pas pouvoir choisir entre les deux. Tous sont maladroits dans le moindre geste, la moindre des paroles. Garçons comme filles. Ils ne savent pas choisir. C’est en somme leur première expérience avec le choix, à travers le poids de leur virginité.
Et puis il y a le Michigan, tout particulièrement Détroit, déjà, avant qu’il ne soit encore au cœur de It follows. Mais The myth est entièrement lesté de toute notion d’espace-temps. On est en banlieue, peut-être dans les années 70, attendant un éventuel crush avec le Halloween de Carpenter, comme on est aujourd’hui, dans un Détroit fantôme. C’est comme pour It follows, où les voitures sont actuelles mais les téléviseurs dans les maisons datent des années 80 et le cinéma du quartier projette Charade, de Stanley Donen. Il n’y a pas pour autant volonté de faire quelque chose d’universel et de le placarder comme tel, mais d’entrer dans le mythe de manière à creuser les personnages dans leur intimité, en nous ôtant par la même tous nos repères habituels. Les parents sont par ailleurs absents du film, entièrement. La mère de Rob apparait dans le supermarché poussant son caddie, les parents de Sean sont de retour un moment, hors champ. C’est tout. Comme si la métamorphose de leurs enfants paissait inévitablement par leur absence commune.