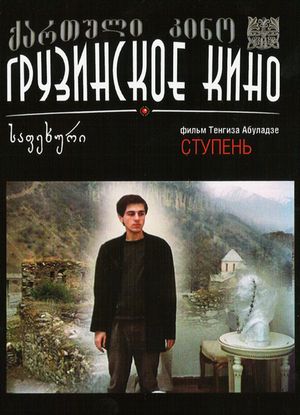Un film impressionnant, qui prend le parti du champ/contrechamp permanent, pour marquer des séparations, des frontières et des oppositions, et permettre aux personnages d'apparaître et de s'inscrire à leur façon dans des cadres qui ne les contiennent pas tout à fait, qui ne les représentent pas totalement, mais où quelque chose d'une relation (entre l'être et le monde) essaie de s'articuler.
Il s'agit essentiellement de plans d'intérieurs, saturés d'objets, de formes et de couleurs (quelque part entre Sergei Paradjanov et Wes Anderson ; Paradjanov pour la tentation de l'enchevêtrement plus que celle de l'ordre, Wes Anderson pour la mélancolie des personnages), mais aussi de recoins et de rideaux avec lesquels organiser des fuites et des surgissements. C'est ça qui est très spécial : aucun des plans n'est tout à fait fixe, il y a toujours un travelling avant ou arrière en cours, et quand on revient vers un personnage l'axe est légèrement décalé, le film préférant créer des secousses ou des tremblements plutôt que de la continuité logique. Le père du héros, à chacune de ses répliques, sort de son bureau, même si ses répliques s'inscrivent dans une même conversation.
L'atmosphère est spéciale, flottante, pleine de répétitions loufoques, de surgissements invraisemblables que personne ne remet en question. Le héros très gentil, qui aime ses amis et les plantes (mais pas trop son père), et attend d'obtenir un poste de botaniste en ville, est soudain victime d'un coup de froid au coeur de l'été. Rien n'est parfaitement normal, toute la réalité semble rejouée autrement. Sans folie non plus, mais avec une fantaisie existentielle assez profonde. J'ai adoré la scène où le héros note sa nouvelle adresse directement sur le mur du salon de son amie.
On dirait que chaque plan raconte une tentative d'habiter - habiter chez soi sans s'amoindrir - entrer chez l'autre sans se perdre - ou vivre avec lui, dans ses recoins, ses caves, ses dédales. La mise en scène tient en quelques mots : avec, contre, sans.