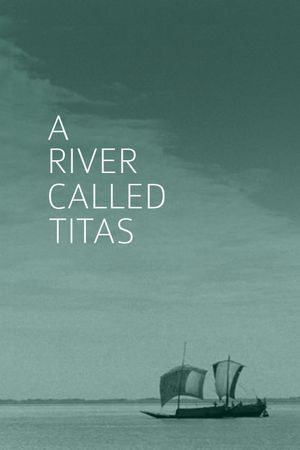La rivière Titash, découvert dans le cadre de la programmation du Festival Lumière en compagnie du compagnon d'infortune @SeigneuAo, était l'ovni des films de la semaine. Restauré par la Film Foundation, on mesurait bien l'absence d'enthousiasme que sa programmation avait suscité à Lyon au vu d'une (petite) salle remplie au maigre tiers, avec une file d'attente préalable inexistante, quand tout autre film nécessitait d'arriver une heure minimum à l'avance pour espérer avoir des places décentes.
Il y a de fait quelque chose d'absurde à écrire une critique sur ce film que personne ne verra mais - quoique ne pouvant pas dire, loin de là (!), que j'ai passé un bon moment - je dois bien admettre que cette pellicule est celle qui m'a le plus marqué.
La rivière Titash est un film bangladais. Tourné en noir et blanc. Dédié aux laborieux travailleurs d'un pays encore sous la coupe d'une organisation multi-séculaire de castes et de préceptes millénaires quant au rôle soumis de la femme. On suit - plus ou moins - les "aventures" de familles de pêcheurs en proie aux vicissitudes de leurs destinées ternes au sillon tracé depuis la naissance.
Comprenez bien que j'essaye dans le paragraphe précédent de dresser le portrait d'un fil narratif cohérent mais, confronté à La rivière Titash, on est constamment déboussolé, paumé, égaré dans une expérience cinématographique qui ne propose rien de palpable pour un occidental.
Sur la forme, on a à faire à une réalisation d'une naïveté confondante, comme refusant les codes les plus basiques du cinéma tel qu'il s'est développé ailleurs (Europe, Etats-Unis, Japon, etc). Quoique certains plans sont superbes, l'essentiel de la réalisation se résume à des mouvements de caméra paresseux, des scénettes en plan large fixe, et un montage absurde ne prenant même pas la peine de souligner les nombreuses ellipses parsemant le film.
Sur le fond, tenter de résumer le scénario relève d'une gageure. Si on croit pouvoir s'accrocher à une histoire de femme perdue et d'homme fou, le panel des personnages s'élargit sans cesse, leurs aventures finissent par êtres complètement décorrélées, jusqu'à des sorties de route incompréhensibles ou le film semble redémarrer à quarante minutes de la fin. Et les comportements, les réactions, les dialogues... On se croirait plongé dans une transposition misérable d'un mélange d'Ubu Roi sans la farce et d'En attendant Godot sans la structure rassurante des codes théâtraux.
Et c'est là qu'en fait j'admets une défaite en rase campagne en tant que spectateur face à La rivière Titash. Il y a, confusément, un propos politique puissant qui jaillit de ce film. Une peinture acérée de la gabegie que le système de castes fait peser sur les Bangladais. Une réflexion profonde sur le rôle de la femme à réinventer dans une société percluse de tradition misogynes. Mais je n'ai pas le clefs. Je ne vois même pas les portes qui me sont fermées.
La rivière Titash est ailleurs. C'est film d'un autre monde. Celui du continent Indien. Un univers que je pensais avoir un jour au moins appréhendé avec Loin de Chandigarh (Quelle prétention !). Que nenni.
La rivière Titash mérite certainement d'avoir été restauré par la Film Foundation. Quelques illustres historiens du cinéma ont certainement compris son importance pour décrire une société à ce point "autre" en profonde mutation. La seule chose que je pense avoir à peu près perçu, c'est que ce film était pour eux. Et que je n'avais aucune légitimé à le juger.