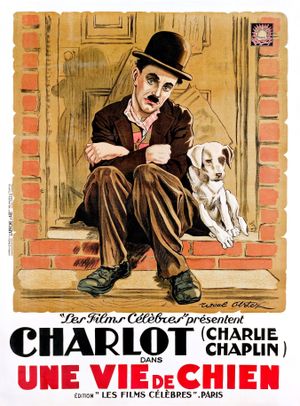Pour apprécier Une vie de chien à sa juste valeur, il convient de le regarder concurremment avec The Kid réalisé l'année suivante. Les rapprochements sont en effet nombreux : le couple (Chaplin et un compagnon de misère), la description réaliste et juste de la misère sociale et de l'exploitation (la foule qui sa bat pour trouver n'importe quel travail au début du film ; la jeune femme, chanteuse, contrainte par son patron à jouer aux entraîneuses, les habitations ou les locaux sordides...), la fondation d'une famille au terme des péripéties.
Ce dernier point permet de placer le film sous les auspices de l'optimisme (L'amour permet de réunir les êtres, là où la misère engendre la désunion, le rejet), bien qu'il soit parcouru par la mélancolie.
La scène comique la plus réussie : le vagabond utilise l'un des deux voyous comme marionnette (au sens littéral du terme), l'autre étant éberlué par le comportement plus qu'étrange de son compagnon. Un grand moment de pantomime et d'humour.
Si Chaplin dépeint de manière réaliste et sans concession la misère urbaine, la campagne fait l'objet d'un tout autre discours. Elle n'est visible qu'à la fin du film : elle symbolise le bonheur familial, organisé autour d'une vie de labeur, un travail digne et épanouissant. La campagne apparaît sous une forme idéalisée, à l'instar des romans bucoliques.
Un film matriciel qui annonce aussi The Kid que Les temps modernes voire Les lumières de la ville (puisque nous y retrouvons un autre couple, a priori improbable : le vagabond et le millionnaire).