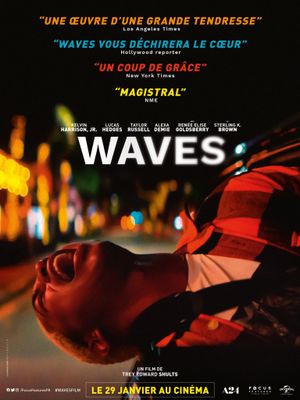Waves travaille son récit par vagues sonores et chromatiques, les destinées individuelles fluctuant au gré du vent, au fil des révélations et des bouleversements qui soufflent dans le film une vitalité de chaque instant. La caméra saisit une urgence, le montage l’articule à une autre, à des autres par le biais de fondus magnifiques avec noir ou jeux de couleurs, superposition de motifs. Trey Edward Shults signe une œuvre chorale à la fois fluide et heurtée, pensée comme un diptyque dont chacune des parties se reflète en miroir inversé l’une de l’autre : de mêmes mouvements de caméra accentuent ces phénomènes d’échos, telle la rotation à 360 degrés dans la voiture. C’est le flux et le reflux des vagues, la destruction et la reconstruction d’une identité individuelle et familiale : comment retrouver une harmonie ? combler l’absence ? être la sœur d’un monstre ? comment aimer ainsi souillée ? qui aimer ?
Le long métrage s’ouvre sur une liberté qui se conditionne peu à peu ; il se referme sur une ouverture du champ de perception du monde, évolution traduite à l’image par un rétrécissement puis un élargissement du cadre. Entre ces deux mouvements, des êtres se croisent, se heurtent, chutent et se séparent. S’aiment aussi. Car Waves est avant tout un grand, très grand film d’amour. Un amour de dernier instant, un amour balbutiant, presque de débutant, qui explore un nouveau continent à chaque baiser donné ou ravi. Un amour plus fort que tout, capable de pardonner, capable de tuer. Voilà un thème éculé, certes, mais doté ici d’une puissance de mise en scène apte à le raccorder à sa vigueur première. Waves nous écrase et nous emporte pendant plus de deux heures ; ses eaux sont âpres, usées, colorées par le sang et le deuil ; ses eaux sont celles d’un baptême grâce auquel personnages et spectateurs recouvrent ensemble une humanité à fleur de peau, constamment sur le point de vaciller mais dont la force et le maintien touchent au sublime.