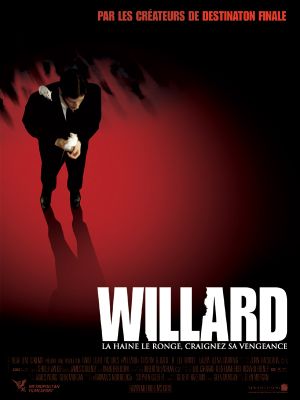Willard est un film d’une puissance rare. C’est essentiellement dû au fait qu’il dirige son histoire avec un manichéisme proche de l'autisme, entièrement tourné vers son personnage principal, au point de laisser de côté ses torts pour embrasser toujours ses sensations. Willard est enfantin. C’est un individu tellement frustré, tellement conditionné par son environnement extérieur proche qu’il a stoppé son évolution à 10 ans. Willard ne raisonne pas comme un homme de son âge, mais comme un gosse. Il est naïf, peu réaliste, terriblement attaché à son quotidien au point de ne jamais vouloir le changer. Son patron est un connard fini, mais pendant les engueulades où il humilie régulièrement Willard, il lui donne aussi des conseils. S’éloigner et refaire sa vie ailleurs serait effectivement la solution la plus saine (la question pécuniaire reste floue à ce sujet). Mais Willard l’exclue toujours d’office, préférant se focaliser sur sa petite haine du directeur Martin, qu’il désigne d’office comme bourreau de son existence. Mais si le film suit les évènements avec un regard enfantin, il en a aussi la sincérité. Il est incroyablement proche de Willard, et le moindre de ses sentiments passe immédiatement à travers l’image. Ressentant l’humiliation avec une hypersensibilité évidente, Willard n’est pas déprimé, puisqu’il a assimilé la situation actuelle, et ne veut rien faire pour la changer. A la longue, il s’est habitué à ses humiliations (il en rit même pendant une séquence, se délectant de la dernière insulte que Martin lui a concocté) et il s’y attache, car cela nourrit sa vision du monde. Cette vision, encore une fois enfantine, est que le monde entier est méchant. La peur du monde extérieur passe dans le film par la crainte monstrueuse de Willard pour tout ce qui est inhabituel, des inconnus, et de tout ce qui l’éloignerait de sa chère maison. Le film flirte régulièrement avec le malsain en montrant le quotidien délétère de Willard, entre les humiliations quotidiennes et les séquences où il s’occupe de sa mère, véritable épave qui le monopolise en l’accablant de sa non-réussite dans la vie. Dans cet océan de noirceur, Willard découvre son don et s’attache à un rat, qu’il nomme Socrate. En plein milieu de la noirceur, cette relation est le seul rayon de soleil qui pointe dans le récit. C’est une amitié zoophile au premier degré, vécue avec la passion d’un gosse, et un enthousiasme ingénue qui fonctionne. Alors, le basculement sur les envies de vengeances ne surprend pas, au contraire, il fait jubiler. Si Burton en avait saisi l’essence dans certains de ses films (Beetlejuice entre autres), Glen Morgan en fait ici un véritable exutoire, un assouvissement scandaleusement jubilatoire qui oublie l’infantilité de la chose pour épouser complètement le point de vue du personnage. Pareil pour ses fréquentes crises émotionnelles, souvent rapides et incontrôlables (hypersensibilité évidente à nouveau), jusque dans sa vengeance finale, parfaite démonstration de gestion émotionnelle qui parvient à humaniser les rongeurs à l’écran, petits soldats gérés par un Willard ivre d’une vengeance aussi personnelle qu’enflammée. Concluant d’une façon pessimiste attendue, logique et complètement satisfaisante, Willard est un film fantastique d’une trempe rarement égalée, dont la force émotionnelle bluffante suffit à chaque visionnage à m’emporter dans les remous du récit. Loin de tout effet choc (PG 13 oblige, le remake de Black Christmas sera autrement plus épicé), c’est un remake jubilatoire dont la portée émotionnelle a largement de quoi séduire.