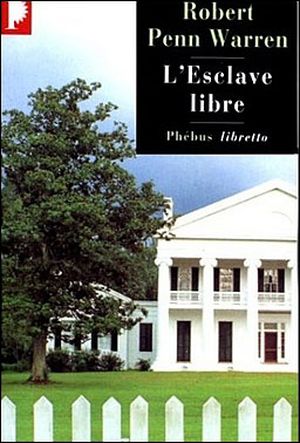« Oh, qui suis-je ?... Tel a été le cri de mon cœur pendant si longtemps ! » (P. 13) Et telle est en effet la question qui hante Amantha Starr tout au long de ce roman, et qui en vérité sourd au fond de chaque personnage et derrière chacun de leurs actes ; et toute relation humaine, et toute vie sociale, ne pourront jamais être envisagées qu’à travers le prisme de cette interrogation d’angoisse qui met tout homme face à l’absurdité de la vie, ou plus précisément, de sa vie parmi tant d’autres.
Et Robert Penn Warren montre des êtres brimbalés et malmenés par l’effrayante Histoire, qui perpétuellement poursuit sa marche en broyant indifféremment Noirs et Blancs, riches et pauvres, bons et mauvais. Mais de bons, au fond, il n’y a guère, à tel point sont vénéneuses les affres endurées par quiconque ignore son identité : incapable d’aimer personne, un tel individu recherche en vain la joie. Car s’il croit aimer les autres, ce n’est que pour découvrir bientôt qu’il ne les considère que comme un moyen de se définir dans le monde, que, donc, il ne les comprend ni ne les connaît aucunement. Amantha Starr s’aperçoit de cette réalité : « Je connaissais Hamish Bond depuis des mois, mais sans doute n’avait-il été pour moi qu’une masse, une voix, une chaleur protectrice dans l’ombre, un poids pesant sur mon corps. Il n’avait jamais été réel. Seulement un rêve que je faisais, un rêve qu’il fallait que je fasse et auquel je me cramponnais. » (P. 211) Qui donc est-elle ? À trop vouloir répondre à cette question, Amantha Starr abîme son être dans la solitude : elle croit aller vers un homme mais c’est à une ombre et une idée qu’elle s’attache, et lorsqu’elle constate n’avoir vu en Hamish Bond qu’un moyen de se trouver une place dans le monde, quoi de plus normal que de remarquer le contrepoint : « Et ceci était effrayant. Car si Hamish Bond n’avait été qu’un rêve pour moi, alors, c’était comme si je découvrais brusquement que, moi-même, je n’avais été qu’un rêve pour lui, un rêve qui lui était nécessaire. » (PP. 211-212) Qui donc est-elle ? L’être qu’elle avait cru révélé à elle était controuvé ; bien loin qu’il fût ancré dans la réalité, elle l’avait façonné de toute pièce et s’était fait accroire qu’il pouvait avoir quelque objectivité, une vie indépendante et ne reposant qu’en soi – mais elle ne reposait pas même en Hamish Bond. Alors, chacun n’étant rien pour autrui, nul n’est quelqu’un mais seulement : « solitaire au milieu du néant » (P. 212).
Or, rien ne réchappe au solipsisme, ni la force, ni hélas la faiblesse, car comme un homme mesure sa force pour écraser les autres, de même aussi mesure-t-il sa faiblesse. Ainsi de Hamish Bond qui, devenu vieux, laisse Amantha Starr, sa petite Manty, être courtisée par le jeune M. Prieur-Denis ; et de préparer un plan machiavélique pour les surprendre et punir l’impertinence du jeune homme, pour se prouver à lui-même la force de sa faiblesse ; et celle-ci de servir l’écrasante attraction du solipsisme et l’isolement où l’homme s’emmure : « Quand on se rend compte que la force ne sert plus à rien, on en arrive à penser que la faiblesse pourra peut-être servir… » (P. 212) Pourtant, la mise au jour de cette tare indissociable de la nature humaine suscite, chez lui la repentance et chez elle le pardon : « Oh, Manty, répéta-t-il – et on eut dit qu’il lançait un appel –, n’est-il pas effroyable, pour un homme, d’être fait de cette manière ? / Inopinément, mon cœur déborda de tendresse. Je me levai d’un bond, m’emparai des mains de Hamish et les baisai. » (P. 212) Qui donc est-elle ? Mais si le cœur de l’homme n’est rien d’autre que cette solitude, alors le remède n’est pas loin, quand on découvre la cause de cette tristesse et qu’il n’est rien pour y remédier qui ne se trouve en nous-mêmes. Se rendre compte de la solitude rompt le rêve de chimères et ouvre à l’empathie – à un espoir de communion.
Mais tout se répète, et narrée par Penn Warren la vie n’est que l’inlassable répétition des instants de solitude qui closent l’espoir entraperçu. Tout comme l’incompréhension plus haut évoquée entre Bond et Manty reproduisait celle qui se tenait entre cette dernière et son premier amour, Seth Parton, une troisième rappelle à sa conscience l’emprise du solipsisme lorsqu’Amantha, impuissante à soustraire son mari Tobias à la politique, qui accapare son attention et sa volonté, feint tristement d’écouter son projet d’écrire des lettres aux grands du pays : « J’écoute, chéri. / Mais le sénateur Sumner n’écoutait pas. Ni le président Johnson. Ni Thaddeus Stevens, membre du Congrès. Ni le père de Tobias. Ni les planteurs de Terrebone et de Féliciana. Ni le Dr Dostie. Ni les millions d’autres. / Et, moi, j’avais dit que j’écoutais, mais je n’écoutais pas non plus. / Nous étions tous enfermés en nous-mêmes. » (P. 336) Recroquevillé pour répondre à ses questions existentielles, chaque personnage s’éloigne des autres et se trouve ainsi de plus en plus seul face au néant : « Quant à moi, je continuais à regarder les visages des hommes qui venaient chez nous, j’entendais leurs paroles, mais on aurait dit que je vivais dans un monde ouaté. Les voix me parvenaient comme d’une grande distance et je tendais l’oreille pour comprendre ce qu’elles exprimaient. Et parfois même, quand Tobias me caressait et m’attirait contre lui, dans l’amour, j’avais toujours cette sensation de vivre dans un monde assourdi… » (P. 337)
Et si la faiblesse, plus encore que la force, isole, la vertu plus que le vice augmente la désolation de la solitude : car Amantha sait qu’elle convainquit Tobias de l’épouser en faisant jouer sa noblesse, ce qui l’affligera d’autant plus quand la grande âme de son mari le poussera à la tromper avec une autre femme dans le besoin : « En la voyant malheureuse, solitaire, désarmée, il s’était penché vers elle, dans sa noble magnanimité. / Cette pensée me terrifia tellement que je me mis à trembler dans le lit. Je n’avais rien été pour Tobias Sears, rien du tout. Rien qu’un prétexte lui servant à exercer sa magnanimité. Oh ! que ma vie est vide… » (P. 437) C’est la conscience renouvelée qu’on n’est rien pour autrui. Tobias, aux prises avec ses propres doutes, veut atteindre l’absolu, l’idéal qui donnera la joie ; ainsi de ses poèmes, mettant en scène des soldats morts au champ d’honneur, qui perdent leur apparent statut de commémoration et de fraternité sitôt qu’Amantha découvre la signification de l’anonymat qui entoure ces soldats, puisqu’aussi bien l’unique héros de ces poèmes est Tobias n’osant quitter le monde et la vie pour visiter sa mort rêvée, « Tobias mourant en s’éloignant de moi, mourant dans une perpétuelle fuite, sans cesse renouvelée, mourant dans un suicide, dans une infidélité constamment répétés, accomplissant en imagination ce que n’avaient pu faire le couteau et les coups du voyou de la Nouvelle-Orléans, lors de sa première fuite, mourant toujours subjugué par la beauté de l’Idée, par la noblesse de la Vérité, mourant dans la blancheur immaculée de l’image qu’il avait de lui-même. » (P. 438)
En un nouveau désespoir vient mourir aux pieds d’Amantha l’espérance d’une communion jadis entrevue, quand elle s’avoue finalement vaincue par l’adversité, inepte et sans plus de force qui la fasse tenir bon : « Je suis incapable de le suivre dans l’office, de serrer sa tête contre ma poitrine et de dire chéri, chéri, chéri, jusqu’à ce qu’il croie enfin ma voix et mon cœur, jusqu’à ce qu’il croie que la réussite ou l’échec ne comptent pas, que seule compte cette douce possibilité qui nous a été donnée d’être, de devenir nous-mêmes, d’exister ensemble, au-delà de la solitude, grâce à une charité qui est plus profondément enracinée en nous que l’amour puisqu’elle est la profonde, l’obscure source dont jaillit l’amour tel un brillant mais superficiel jet d’eau. » (P. 448) Mais si l’homme épuise les ressources de sa raison et tombe à genoux dans la peine, la grâce vient à lui dans sa faiblesse – cette faiblesse auparavant source de solitude encore plus que la force et mesurée comme elle, devient l’étonnante faiblesse chrétienne qui oblige la charité (si chrétienne encore, dans la définition qu’en donne Penn Warren) à porter son secours. Car quand le désespéré a trop réfléchi dans la tourmente, il abandonne ses pensées maussades et s’en va vivre dès qu’il entend l’appel – qui retentit ici dans la voix de Tobias : « Au diable les réflexions, reprit-il. Il fait un clair de lune magnifique. Tu ne vas tout de même pas rester ici à broyer du noir ? » (P. 475) Délaissant sa perpétuelle question, sa femme pleure de joie tandis qu’il lui caresse le dos au son de mots qu’il lui fut impossible, à elle, de prononcer et que la grâce met dans la bouche de Tobias : ma chérie, ma chérie, ma chérie… « Oui ! C’était ce qu’il disait. » (Ibid.)
- L’Esclave libre, 1998, éditions Phébus, collection « d’aujourd’hui/étranger », traduction de J.-G. Chauffeteau et G. Vivier (1957)
(Critique rédigée en plusieurs fois, à la fin de l’été 2018 – puis dernières retouches en octobre 2018.)