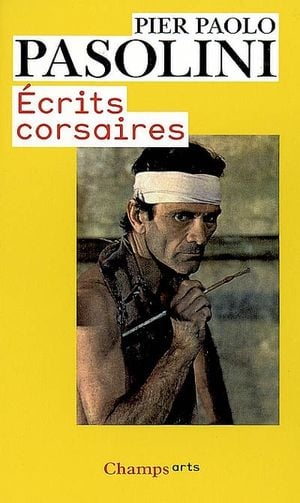(La numérotation des pages renvoie à l'édition de 1976 par Flammarion, traduction de Philippe Guilhon.)
Plus qu’une critique, le texte qui suit est une proposition de lecture, fondée sur un étonnement. Si, souvent, la tentation est forte de paraphraser le livre lu, dans le cas de Pasolini, il y a tant de ses phrases que j’aurais voulu citer telles quelles, que, plus qu’une paraphrase, c’est un modèle réduit du livre que je me serais borné à recopier. C’est qu’en dehors de tel ou tel exemple spécifiquement rattaché à l’Italie des années 70, d’où il parle, les considérations de Pasolini sont tout aussi pertinentes aujourd’hui qu’à son époque. En fait, elles le sont même encore plus : sur son navire corsaire, Pasolini attaquait sabre en main ce qui n’était que l’ossature de bâtiments en construction, encore entreposés dans les chantiers navals. Aujourd’hui, ces navires, arborant les couleurs de tous les conformismes, que malgré tous ses efforts il n’est pas parvenu à détruire dans l’œuf, sont bel et bien en circulation ; et plus que jamais il faudrait copier et recopier des citations de Pasolini, car c’est aujourd’hui que peut-être ses coups de sabre et ses tirs à bout portant feraient mouche.
Pasolini était un visionnaire, mutiné d’avance contre un millénaire qui s’annonçait miné par le consumérisme et dévorateur de sacralité. Nous qui le buvons jusqu’à la lie, ne pouvons que constater la justesse de ses mises en garde.
1. Le Nouveau pouvoir
« L’histoire des peuples qui ont une histoire est, dit-on, l’histoire de la lutte des classes. L’histoire des peuples sans histoire, c’est, dira-t-on avec autant de vérité au moins, l’histoire de leur lutte contre l’État. » (Pierre Clastres, La Société contre l’État)
Écrits corsaires regroupe des articles publiés par Pasolini dans diverses revues, de 1973 à 1975. Le livre de Pierre Clastres, cité ci-dessus, a paru en 1974. Je m’étonne qu’au même moment, Pasolini, poète et cinéaste revendiqué marxiste, analysant les actualités italiennes ; et Clastres, ethnologue et anthropologue anarchiste abhorrant les penseurs marxistes et étudiant les sociétés amérindiennes précolombiennes, tiennent un discours similaire sur la société occidentale de leur époque.
Clastres distingue, donc, les sociétés à État, qui ont une histoire et « progressent » vers un devenir soi-disant meilleur, et les sociétés sans État, sans histoire, comme la société des Indiens Guayaki, dont tous les efforts tendent selon Pierre Clastres à ne pas entrer dans l’engrenage du progrès, à empêcher l’émergence d’un État qui dépossèderait les membres de la société de leur pouvoir à diriger leur propre vie, et choisirait pour eux de « progresser ». Les Guayaki se satisfaisaient pleinement de la situation dans laquelle ils avaient toujours été. Tous étaient égaux dans la tribu, et au lieu de lutter les uns contre les autres, les Guayaki luttaient ensemble contre l’émergence d’un chef au pouvoir décisionnel. Mais l’arrivée des envahisseurs européens a changé la donne, les sociétés amérindiennes sans État se sont vu imposer l’État importé d’Europe.
Pasolini, lui, décrit avec nostalgie les différentes sociétés qui composaient l’Italie de sa jeunesse : chaque classe, selon son histoire et sa géographie, des paysans catholiques aux sous-prolétaires des banlieues, avait son propre dialecte, ses valeurs particulières. Et si l’histoire de l’Italie avait été celle de la lutte des classes, confirmant que ces peuples italiens n’avaient rien à voir avec les tribus amérindiennes, un véritable changement d’ère pourtant, comme il n’en arrive que tous les millénaires selon Pasolini, est venu bouleverser cette histoire : la société de consommation a rendu caduque la lutte des classes. Car la consommation rend les hommes « conformistes et tous égaux l’un à l’autre selon un code interclassiste » (p. 88, Pasolini souligne), nivelant toutes les anciennes oppositions qui existèrent de tous temps, accomplissant donc par-là une « ‟mutation” anthropologique » (ibid.). Si bien que les classes, absorbées par la société de consommation mondiale (ou occidentale), se retrouvent dans la même position que les sociétés précolombiennes face aux Européens : ce ne sont plus les classes d’un même pays, mais des sociétés indépendantes qui, faute de lutter pour leur survie, tombent, désormais uniformes, sous le joug de l’État : « L’Italie vit aujourd’hui, d’une façon dramatique, et pour la première fois, le phénomène suivant : de larges strates, qui étaient pour ainsi dire demeurées en dehors de l’histoire – l’histoire de la domination bourgeoise et de la révolution bourgeoise – ont subi ce génocide, à savoir cette assimilation au mode et à la qualité de vie de la bourgeoise. » (p. 261)
Or le mal, pour Pasolini, n’est pas la bourgeoisie en soi, ses valeurs ne sont pas mauvaises tant qu’elles restent dans leur milieu d’origine. Les valeurs du fascisme par exemple (Église, famille, patrie, ordre, discipline, obéissance, épargne, moralité) étaient ancrées dans une réalité historique, « c’est-à-dire qu’elles faisaient partie des cultures particulières et concrètes qui constituaient l’Italie archaïquement agricole et paléo-industrielle. » (pp. 182-183) Il est juste qu’une population ait ses propres valeurs, bien qu’elles ne soient pas forcément justes en soi. « Mais du moment où elles ont été érigées en ‟valeurs” nationales, elles n’ont pu que perdre toute réalité, pour devenir un atroce, stupide et répressif conformisme d’État : le conformisme du pouvoir fasciste et démocrate-chrétien. » (p. 183) N’importe quelles valeurs, pas seulement celles du fascisme, deviendraient haïssables si elles étaient imposées à un peuple qui, historiquement, a d’autres valeurs. L’absence de considération pour l’histoire d’un peuple, le déni de ses particularités au profit de son intégration monolithique à un système, est l’apanage de tous les totalitarismes.
Le mal résiderait donc, pour Pasolini, dans la volonté d’unification qui est celle du pouvoir. De même pour les Guayaki, selon Clastres : « Le Mal, c’est l’Un. Le Bien, ce n’est pas le multiple, c’est le deux, à la fois l’un et son autre, le deux qui désigne véridiquement les êtres complets. » Ce « deux », dans lequel Clastres voit le salut des Guayaki, on peut le retrouver, me semble-t-il, chez les Italiens tels que Pasolini les aimait, les Italiens d’avant la société de consommation. On peut même le retrouver chez les Italiens de la période fasciste, car le fascisme, s’il imposait les valeurs d’une classe à l’ensemble de la société italienne, ne réalisait pourtant pas pleinement l’unité dénoncée : « Le fascisme proposait un modèle, réactionnaire et monumental, mais qui restait lettre morte. Les différentes cultures particulières (paysannes, sous-prolétariennes, ouvrières) continuaient imperturbablement à s’identifier à leurs modèles, car la répression se limitait à obtenir leur adhésion en paroles. » (p. 49) Le fascisme fut une période « au cours de laquelle le comportement était totalement dissocié de la conscience. » (p. 185) On comprend, à lire Pasolini, que le peuple italien sous le fascisme était encore composé d’individus qui incarnaient le « deux » de Pierre Clastres : chacun était citoyen italien, et en même temps membre de son milieu ancestral : paysan, prolétaire, ouvrier. Chacun portait en lui l’histoire de l’Italie, et en même temps l’histoire de ses aïeux, de sa région, de sa classe. Ce n’est qu’avec l’hédonisme de la consommation que l’Un, tant redouté des Indiens de Pierre Clastres, s’est incarné pour de bon en Italie : « Aucun centralisme fasciste n’est parvenu à faire ce qu’a fait le centralisme de la société de consommation. […] On renie les véritables modèles culturels. L’abjuration est accomplie. On peut donc affirmer que la ‟tolérance” de l’idéologie hédoniste voulue par le nouveau pouvoir est la pire des répressions de toute l’histoire humaine. » (p. 42)
Ainsi, plus qu’au fascisme mussolinien, la société de consommation serait comparable, d’après Pasolini, au nazisme. En effet, dans l’Allemagne des années 30, « les valeurs des différentes cultures particularistes ont été détruites par l’homologation violente que fut l’industrialisation, avec pour conséquence la formation de ces gigantesques masses, non plus antiques (paysannes, artisanes) et pas encore modernes (bourgeoises), qui ont constitué le sauvage, l’aberrant, l’imprévisible corps des troupes nazies. » (p. 184) Les Allemands des années 30 étaient en somme, nous dit Pasolini, déracinés : l’industrialisation leur avait ôté leur identité de toujours, sans leur en donner de nouvelle. Ainsi la conscience des Allemands déboussolés n’avait-elle aucune possibilité d’être double : elle coïncidait exactement avec leurs actes. C’était l’Un et non le deux. C’est pourquoi Pasolini peut affirmer : « Quand je vois que les jeunes sont en train de perdre les vieilles valeurs populaires et d’absorber les nouveaux modèles imposés par le capitalisme, en courant le risque de se déshumaniser et d’être en proie à une forme d’abominable aphasie, à une brutale absence de capacité critique, à une factieuse passivité, je me souviens que telles étaient les caractéristiques des S. S. – et je vois s’étendre sur nos cités l’ombre horrible de la croix gammée. » (p. 266) À ceci près que la société de consommation s’impose, selon Pasolini, avec une violence encore plus grande, dans la mesure où l’industrialisation des années 60-70 a subi une transformation décisive par rapport à celle de l’Allemagne des années 30. L’industrialisation de la société de consommation repose sur la télévision et sur une nouvelle infrastructure (moyens de transports rapides) abolissant les distances. Toutes choses qui facilitent la centralisation.
Pasolini se fait finalement, diraient les journalistes de notre siècle, « complotiste », puisqu’il ose prétendre que l’assujettissement des masses au totalitarisme de la société de consommation, non seulement est voulu, mais même est orchestré par ceux qui y ont intérêt. Ainsi parle-t-il des attentats qui ont eu lieu entre 1969 et 1974 en Italie : le pouvoir en place, démocrate-chrétien, en avait tour à tour accusé les communistes et les fascistes. Mais pour Pasolini, ces massacres « ont été accomplis par les mêmes personnes » (p. 271), c’est-à-dire par « quelques-uns des hommes qui nous gouvernent depuis trente ans » (ibid.). « Ils ont d’abord fait le massacre de Piazza Fontana en accusant les extrémistes de gauche, puis ceux de Brescia et de Bologne en accusant les fascistes […] ». Il va jusqu’à affirmer que le pouvoir a mené ces opérations « avec l’aide et sous l’impulsion de la C.I.A. » (p. 132), prêtant à ce nouveau pouvoir une résonnance mondiale.
2. Des oppositions ringardes
« […] gouvernants et militants, intellectuels et engagés, investis d’une cause qu’ils relient rarement à de plus amples totalités, semblent dépassés, réduits à trouver dans les questions des mœurs […] leurs terrains de lutte […], accroissant la division et accélérant notre effondrement. » (Juan Branco, Abattre l’ennemi)
Le pouvoir de la consommation, par sa forme complètement nouvelle lors de son irruption à la fin des années 60, a bluffé aussi bien la droite que la gauche, en révélant à chacune une partie de son plan, mais en lui taisant l’autre : à lire Pasolini, c’est comme si la société de consommation avait dit aux représentants de la droite « clérico-fasciste » : Je vais détruire la gauche (et c’est vrai) ; comme si elle avait dit aux représentants de la gauche progressiste : Je vais détruire la droite (et c’est tout aussi vrai). La gauche ainsi, déjà dans les années 1970, croyait pouvoir bénéficier de la libération des mœurs, antienne de la société de consommation : « De là vient un optimisme général de la gauche, une tentative vitale pour s’annexer le nouveau monde – totalement différent de tous ceux qui l’ont précédé – créé par la civilisation technologique. Les gauchistes vont encore plus loin dans cette illusion (avec leur arrogance et leur triomphalisme habituels) en attribuant à cette nouvelle forme d’histoire créée par la civilisation technologique une capacité miraculeuse de rachat et de régénération. Ils sont persuadés que ce plan diabolique de la bourgeoisie qui tend à réduire à elle seule tout l’univers, y compris les ouvriers, finira par faire éclater l’entropie ainsi constituée, et que l’ultime étincelle de la conscience ouvrière sera capable alors de faire renaître de ses cendres ce monde éclaté (par sa propre faute) en une sorte de palingénésie […] » (p. 43) En d’autres termes, la gauche croit que la consommation, dont le but est de rendre consommateurs bourgeois même les pauvres, apportera à ceux-ci le bien-être physique, sans les corrompre, sans leur donner la mentalité de consommateurs : au dernier moment, ils se révolteront, leur âme ouvrière reprendra le dessus, et ils ne garderont de la consommation que les bienfaits. Mais qui a vu le documentaire de Pasolini La Rabbia, verra bien vite que cet espoir que Pasolini prête aux « gauchistes » est une illusion. Ces derniers, étant humains, ont la rabbia, la rage. Ils appellent de leurs vœux la liberté et se battent parfois pour elle, mais, comme le dit Pasolini, sans amour, sans humilité et sans le rire. « L’ironie et le mépris, par exemple, […] chez un étudiant qui conteste la société […], sont des sentiments en tout et pour tout dignes de la société qu’ils condamnent. Seuls les vrais enfants de cette société sont capables de nourrir ironie et mépris […] » (p. 223) C’est pourquoi toutes les révolutions qui ont fait tomber les régimes en place, ont donné naissance à d’autres systèmes imparfaits.
C’est aussi pourquoi les « gauchistes » se laissent dominer par l’instinct de consommation, qui les change ontologiquement. Ainsi de la mode pour les jeunes de porter les cheveux longs, mode importée des États-Unis et honnie de Pasolini, qui se voulait annonciatrice de jours de liberté, brisant le carcan et les conventions du vieux monde, mais qui finit par être adoptée par snobisme jusque dans les pays pauvres, par les enfants des riches, pour se démarquer et montrer qu’ils font partie du système de consommation occidental : « Le cycle s’est accompli ; la sous-culture du pouvoir a absorbé la sous-culture de l’opposition et l’a faite sienne : avec une diabolique habileté, elle en a patiemment fait une mode qui, si on ne peut pas la déclarer fasciste au sens propre du terme, est pourtant bel et bien de pure ‟extrême-droite”. » (p. 31) De nos jours, ce serait plutôt contre les cheveux roses, bleus ou violets que vitupérerait Pasolini. Dès lors que cela devient une mode, la liberté n’est plus de la partie. « La liberté qu’ils prennent de porter les cheveux comme ils le veulent n’est plus défendable, parce que ce n’est plus une liberté. Le moment est plutôt venu de dire aux jeunes que leur façon de se coiffer est horrible, parce que servile et vulgaire. Plus, le moment est venu pour eux de s’en apercevoir et de se libérer de la préoccupation coupable de se conformer à l’ordre dégradant de la horde. » (pp. 32-33) Quand tes convictions profondes, ce à quoi tu tiens (comme d’avoir les cheveux longs), sert le pouvoir, il convient, non pas de renier tes idéaux, mais de faire très attention à ne pas t’amalgamer au pouvoir, et cela peut impliquer de les mettre en veille. Pasolini lui-même, favorable à un certain nombre de réformes portées par la gauche, notamment sur la tolérance envers les minorités, précise : « Mais je sais aussi que si je pense et exprime cela aujourd’hui, cela a lieu dans le cadre d’un programme général de tolérance du pouvoir ; dans ce cas précis, il a besoin de mes pensées autonomes, de mon idéologie marxiste et de ma passion radicale, pour réaliser quelques réformes qu’il trouve nécessaires aujourd’hui […] » (pp. 246-247) Son rôle d’intellectuel l’oblige à donner toutes les raisons de ses convictions, et surtout, toutes les nuances le distinguant de la machine de la consommation, qui fait feu de tout bois et se nourrit de toute conviction, même la plus pure, pour augmenter sa puissance. On a vite fait de devenir l’idiot utile du pouvoir.
C’est le cas des « gauchistes » qui, du moins pour ceux qui sont de bonne foi (ce qui n’est pas le cas, selon Pasolini, de la plupart des chefs de file), font le jeu de la société de consommation : dans les années 70, sous prétexte de lutter contre le fascisme, aujourd’hui, sous… le même prétexte. Que disent les cheveux longs d’alors, les cheveux teints en fluo d’aujourd’hui ? Ils disent « les ‟choses” de la télévision, ou des réclames pour les biens de consommation, dans lesquelles il est désormais absolument inconcevable de présenter un jeune qui n’ait pas les cheveux longs ; le fait est qu’aujourd’hui, cela paraîtrait scandaleux au pouvoir. » (p. 32) Ce qui, dans nos années 2020, paraîtrait scandaleux au pouvoir, ne serait-ce pas des publicités dans lesquelles ne figurent pas des minorités ? C’est aujourd’hui, en effet, une cause pour laquelle luttent de nombreux militants de gauche : qu’apparaissent, dans les « réclames » pour les biens de consommation, autant sinon plus de transgenres, de noirs, d’obèses, et autres minorités, que de représentants de la majorité. N’est-ce pas un combat tout à fait au rebours de celui-ci qu’il aurait fallu mener ? Pour ma part, j’aime la musique classique : mais loin de m’en réjouir, je suis révolté chaque fois que j’entends un morceau classique accompagner une pub pour une voiture, un parfum ou quelque produit que ce soit que la société de consommation cherche à me fourguer pour en tirer profit. C’est la culture au service de l’argent. Est-ce donc faire honneur à Beethoven que d’utiliser sa musique pour écouler des stocks de marchandise ? De la même manière, au lieu de militer pour que les minorités soient montrées à l’écran, en espérant compenser l’effacement dont elles avaient été victimes, ne faudrait-il pas bénir cet oubli et souhaiter l’étendre à la majorité : exiger qu’on ne prenne plus aucun humain pour un argument de vente ? Les militants de gauche, comme dans les années 1970, se fourvoient du tout au tout, sacrifiant les minorités au pouvoir de l’argent sous prétexte de remédier à un effacement médiatique qui serait dû aux normes conservatrices d’un supposé pouvoir fasciste : « Il s’agit d’un antifascisme facile, qui a pour objet et objectif un fascisme archaïque qui n’existe plus et n’existera plus jamais. […] Voilà pourquoi une bonne partie de l’antifascisme d’aujourd’hui, ou, du moins, de ce que l’on appelle antifascisme, est soit naïf et stupide, soit prétextuel et de mauvaise foi ; en effet, il combat, ou fait semblant de combattre, un phénomène mort et enterré, archéologique, qui ne peut plus faire peur à personne. C’est, en somme, un antifascisme de tout confort et de tout repos. » (pp. 267-268)
Comme évoqué plus haut, si Pasolini consacre la plus grande partie de ses efforts à éreinter son propre camp, la gauche, il distribue tout de même quelques horions à ses adversaires de droite. Car ce qui est démontré avant tout dans ces articles, c’est l’ineptie de l’opposition droite-gauche, qui sert le nouveau pouvoir totalitaire, lequel, par la consommation, uniformise le monde : « La matrice qui donne naissance à tous les Italiens, est désormais unique ; il n’y a donc plus de différence notable – en dehors d’un choix politique comme schéma mort à remplir en gesticulant – entre un quelconque Italien fasciste et un quelconque Italien antifasciste ; ils sont culturellement, psychologiquement et, ce qui est plus impressionnant, physiquement, interchangeables. » (p. 72) Car c’est « l’idéologie massive, impénétrable et immense de la consommation, qui constitue l’idéologie ‟inconsciente mais réelle” des masses […] » (p. 111) Inconsciente car les partisans se croient encore fascistes ou antifascistes, sans s’apercevoir qu’ils ne le sont plus. Et de nos jours, si les vêtements permettent encore, parfois, de distinguer un droitiste d’un gauchiste, un examen approfondi démontre que Pasolini, pour le reste a vu juste. Il existe, chez les gens qui se disent de droite aujourd’hui, certains courants qui ont émergé récemment sous l’égide d’« influenceurs » de droite. De nombreux jeunes font des activités qui, suivant la mode, démontrent qu’ils sont de droite. Ils « vont à la salle », regardent des vidéos de droite sur Internet, vont sur des sites de rencontre de droite, ou bien cherchent, sur les sites de rencontre apolitiques, des « profils » prétendument réactionnaires. En fait, rien de cela n’est réactionnaire, ni de droite : la seule chose qui les distingue des gauchistes, c’est l’objet de leur choix. Mais le cadre, la toile de fond, sont exactement les mêmes : cela se passe sur Internet, sur les téléphones portables, avec les mêmes vocables, bref : avec les instruments mis en place par le pouvoir de la consommation. Ils consomment des produits de droite, comme les gauchistes consomment des produits de gauche ; ils sont tous consommateurs pour de vrai, c’est-à-dire dindons d’une farce qui n’est ni de droite ni de gauche.
Dans les années 1960-1970, en Italie, le parti de droite clérico-fasciste était au pouvoir, mais il s’est fait duper sans même s’en rendre compte, assène Pasolini. Réactionnaire, la droite ne fut plus qu’une « réaction seconde », détrônée par le mondialisme de la consommation devenu « réaction première » : « Tandis que la réaction première détruit […] toutes les vieilles institutions sociales – famille, culture, langue, Église –, la réaction seconde (dont la première se sert temporairement, pour pouvoir s’accomplir à l’écart de la lutte des classes directe) s’occupe de défendre ces institutions contre les attaques de la classe ouvrière et des intellectuels. Et c’est ainsi que nous vivons des années de fausse lutte, sur les vieux thèmes de la restauration classique à laquelle croient encore tant ses partisans que ses adversaires ; pendant ce temps, dans le dos de tout le monde, la ‟vraie tradition” humaniste (pas celle, fausse, des ministères, des académies, des tribunaux et des écoles) est détruite par la nouvelle culture de masse et par le nouveau rapport que la technologie a institué – avec des perspectives désormais séculaires – entre la production et la consommation. » (pp. 42-43) En d’autres termes, le pouvoir a agi masqué pour que la gauche continue de s’attaquer à la droite et la droite à la gauche. Cinquante ans plus tard, la gauche accuse encore la droite de vouloir restaurer un ordre fasciste, la droite accuse encore la gauche d’avoir détruit les valeurs traditionnelles. Mais c’est l’argent, la consommation, la mondialisation qui ont détruit l’ancien monde, et le nouveau monde instauré n’a rien à voir avec les vieux idéaux progressistes. Ce qui frappe, à la lecture des Écrits corsaires de Pasolini, ce qui pourrait désespérer le lecteur, c’est de voir que rien n’a changé pour les victimes de la société de consommation que nous sommes : toutes nos luttes sont usées, grotesques, dévoyées. Elles l’étaient déjà en 1970, elles le sont plus encore en 2020, car elles n’ont absolument pas changé. En France, la quasi-totalité de l’opposition est ringarde. Dès qu’on entend parler de droite et de gauche, l’une rendant l’autre responsable de nos malheurs, on peut être sûr que ce qui est dit était déjà ridicule et faux il y a un demi-siècle. La pétrification de ceux qui sont censés incarner l’opposition, a permis au nouveau pouvoir dont parlait Pasolini de progresser sans résistance aucune.
Conclusion. La chute de l’Église marque l'avènement du millénaire de la consommation
Symbole de la droite « clérico-fasciste » contre laquelle Pasolini se battait aussi, l’Église, soutien du fascisme mussolinien puis de sa continuation démocrate-chrétienne, a elle-même été selon lui, après des siècles de règne, battue à plate couture par le pouvoir de la consommation. De même que les jeunes, aujourd’hui, en suivant des effets de mode sur Internet, croient être de droite ou de gauche alors qu’ils ne sont que des consommateurs, de même l’Église avait cru opportun de faire la promotion de ses valeurs à la télévision. Mais la télévision, instrument du pouvoir de la société de consommation, sert son maître, au détriment de celui qui croit en tirer profit. La télévision n’est pas devenue chrétienne, mais l’Église s’est elle-même mise sous la coupe de la société de consommation en adoptant les moyens techniques de la télévision. De la sorte, elle a perdu son prestige et sa sacralité : « […] si les fautes de l’Église ont été nombreuses et graves dans sa longue histoire de pouvoir, la plus grave de toutes serait d’accepter passivement d’être liquidée par un pouvoir qui se moque de l’Évangile. […] un pouvoir qui l’a si cyniquement abandonnée en envisageant sans gêne de la réduire à du pur folklore. » (p. 121) Mais Pasolini, homme « religieux » comme il le dit lui-même (c’est-à-dire, non pas croyant, mais élevé dans une culture imprégnée de christianisme), voyait dans la défaite de l’Église comme puissance, la possibilité d’une victoire de l’Église comme héraut des valeurs humanistes du christianisme, guide de ceux qui refusent « le nouveau pouvoir de la consommation, qui est complètement irréligieux, totalitaire, corrupteur, dégradant ». En somme, sa seule possibilité de survie selon Pasolini, serait pour l’Église de retourner « à ses origines, c’est-à-dire à l’opposition et à la révolte » (p. 121) Vaincue, elle est « libre à l’égard d’elle-même, c’est-à-dire du pouvoir » (p. 127), comme Zorba le Grec et son patron qui, une fois lamentablement échouée leur entreprise pour s’enrichir, dansent de joie.
Mais si, comme l’annonçait Pasolini, l’Église a effectivement perdu la plus grande partie de son pouvoir politique aujourd’hui, il semble qu’elle n’ait pas voulu saisir l’opportunité du retour aux sources qui, d’après l’auteur des Écrits corsaires, aurait seul pu lui permettre de renaître : le Pape François multiplie les déclarations et les décisions allant dans le sens de la pensée majoritaire, comme si par cette attitude il quémandait le droit à ne pas être évincé complètement, attitude témoignant de la victoire écrasante et peut-être définitive de la société de consommation sur toute forme de spiritualité. L’ancien monde et les puissances qui, pour le meilleur ou le pire, le régentaient, ne sont plus que des coquilles vides qu’on gonfle et boursoufle avec de l’argent.
(Révision appréciable et conseils judicieux de Serge Rivron.)