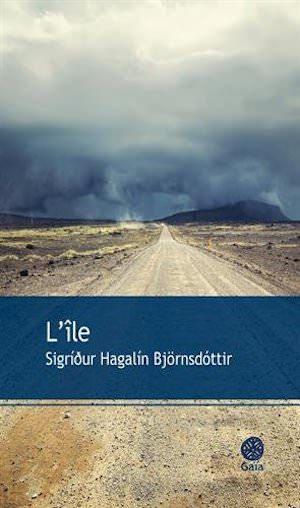L'Islande se trouve isolée après une coupure générale des communications avec le reste du monde et dont la cause en restera inexpliquée. Plus aucun avion et bateau ne volent ou naviguent. Le pays vit tout d'un coup en autarcie totale. Si au tout début l'inquiétude est moindre au moyen d'une adaptation positive, les Islandais plongent peu à peu dans l'angoisse du lendemain : les denrées alimentaires commencent à se faire plus rares, l'essence vient à manquer rapidement, des émeutes germent devant des établissements autant que des milices qui les contrent. Il fait moins bon vivre dans les villes, comme ici dans la capitale, Reykjavík, et beaucoup vont se réfugier à la campagne et renouer vers une vie à l'ancienne : agriculture, élevage, pêche et séchage du poisson.
Survivre individuellement ou collectivement.
Plus on avance dans le livre et plus la dystopie se développe, avec une politique restrictive et nationaliste, contrôlant les médias, devenant plus malodorante que le beurre moisi au fur et à mesure que le journaliste en cheville avec le gouvernement en place, Hjalti, ainsi que son ex femme d'origine latine, María, mère de deux enfants, découvrent et subissent les affres sélectifs vis à vis du peuple afin de régler le problème de surpopulation par rapport aux ressources alimentaires disponibles, mais aussi de régler le problème anthropologique. Les Islandais d'abord ! Les naturalisés, hélas, comme les touristes d'autres pays ne pouvant plus retourner chez eux, ne feront pas exception à la politique sélective du gouvernement..
La principale antagoniste du roman qui dirige tout ça, la politicienne nommée Elín, m'a donné envie de vomir.
L'Île de Sigriður Hagalín Björnsdóttir, bien que cela soit une fiction, fait réfléchir sur une éventuelle situation similaire qui pourrait arriver n'importe où, mais nous remet aussi le nez dans des tréfonds nauséabonds historiques pas si lointains de notre 20ème siècle.