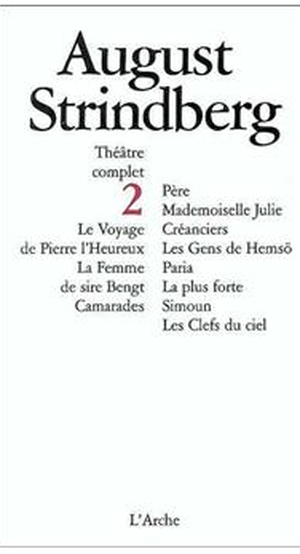Au succès du « Voyage de Pierre l’Heureux » va succéder pour Strindberg l’échec théâtral de « La Femme de sire Bengt ». Peu jouée en son temps, cette pièce est encore rarement mise en scène de nos jours. Il est vrai que l’optimisme qui prévalait dans « Pierre l’Heureux » tombe brutalement : à l’idéal d’une relation conjugale harmonieuse et sans heurts, Strindberg doit maintenant renoncer. Son mariage avec Siri van Essen commence à devenir une épreuve, qui oblige l’auteur à perdre ses illusions sur le mariage, pour accepter à contrecœur le réel déprimant et sordide d’une relation à deux : les illusions perdues ou à perdre, l’inharmonie entre les attentes de l’un et de l’autre au sein du couple, les tensions qui s’ensuivent, le poids accablant des contraintes sociales qui entendent dicter aux conjoints un rôle préfabriqué, les incompréhensions... « La Femme de sire Bengt » nous donne à voir la dissipation des aveuglements amoureux face à ces évidences incontournables du réel.
Ce n’est donc pas un hasard si cette pièce, pour mal connue qu’elle soit, inaugure une période de la création de Strindberg où il va mener plus ou moins en parallèle la mise en scène de deux thèmes : la cruauté du réel (donc, une tendance au réalisme), et la critique, souvent acide, des comportements féminins, critique d’autant plus active qu’elle se heurte au développement du mouvement féministe européen, dont les revendications allaient à l’encontre du désir de Strindberg : que les femmes fassent le moins de bruit possible au sein du couple, en échange d’une liberté d’action que Strindberg se vantait d’avoir instauré au sein de sa propre relation matrimoniale.
Le fil conducteur de la pièce valorise précisément l’évolution d’une relation de couple, dans son intemporalité (et donc son actualité). Ce qui frappe, en effet, c’est le manque d’intérêt dramatique du cadre historique de l’action : au XVIe siècle, en pleine Réforme religieuse, la suppression des monastères et des couvents en Suède. Cela sert tout juste à Strindberg à faire de son héroïne, Margrit, une femme libérée d’un couvent où on brime ses désirs, libération survenue grâce à son mariage avec sire Bengt. Le même filigrane dramatique aurait très bien pu s’insérer dans tout autre contexte historique.
Au départ, on est dans l’euphorie – l’illusion – d’un mariage harmonieux offrant à chacun des deux conjoints la satisfactions de ses désirs. Jusqu’au jour où sire Bengt est ruiné, mais n’ose pas le révéler à sa femme, pour la maintenir dans cette apparence de bonheur. Évidemment, Margrit va apprendre la vérité à un certain moment, et le réel va la rattraper.
Car Margrit n’est pas plus sympathique que Madame Bovary : rêveuse, romanesque, futile, perdue dans une conception étriquée de la vie ramenée à l’exigence de voir tous ses caprices satisfaits, Margrit n’a pas le beau rôle. Elle va descendre assez rapidement tous les échelons du bonheur auquel elle pensait être parvenue, entreprendre de haïr son mari, envisager de la quitter, pour finalement se résigner, en consentant à accepter les tourments et les lourdes imperfections d’une relation entre époux.
Le mariage est donc présenté ici sous un jour assez ambigu : clairement qualifié de prison qui tue l’amour entre deux êtres, il apparaît à la fin comme une institution propre à favoriser l’évolution spirituelle des deux conjoints, évolution consistant surtout à accepter les imperfections, les défauts, les précarités...
Les seconds rôles ne manquent pas d’intérêt : « Le Confesseur », supposé être le guide spirituel du couple, dans un contexte de fortes exigences morales luthériennes, est lui-même torturé par la question de vie amoureuse et de la sexualité, et on se demande longuement s’il ne va pas devenir l’amant de Margrit. Son rôle de conseiller psychologique devrait normalement être fondé sur un équilibre personnel perceptible par tous. Or, c’est un être fragile, torturé, en plein doute. À travers la personne du bailli, on devine un amoureux de jeunesse de Margrit, amoureux dont les galanteries cessent, avec un certain cynisme, dès lors qu’il voit que Margrit est liée à un autre. Certains hommes ne valent pas cher...
Le début de la pièce revêt un petit parfum « gothique » : cette fille battue et persécutée dans un monastère par des « bonnes » ( ?) sœurs sans pitié, et sauvée par sire Bengt, sorte de chevalier lumineux qui l’arrache au malheur, entrerait bien dans un roman noir fin XVIIIe siècle, tels que les Anglais se plaisaient à en construire.
On reconnaîtra dans cette pièce un portrait de femme fofolle et superficielle appelée à s’amender (souhait de Strindberg ?), et un portrait d’homme travailleur qui, par amour, cherche à préserver le plus longtemps possible les illusions de sa femme en lui dissimulant les difficultés matérielles auxquelles il cherche à remédier. Les difficultés de la vie de couple n’ont guère évolué depuis les questionnements de Strindberg. Et l’auteur, ici, accentuant à dessein la versatilité, la superficialité et les excès d’humeur de Margrit, a commencé à fonder sa réputation de misogyne.